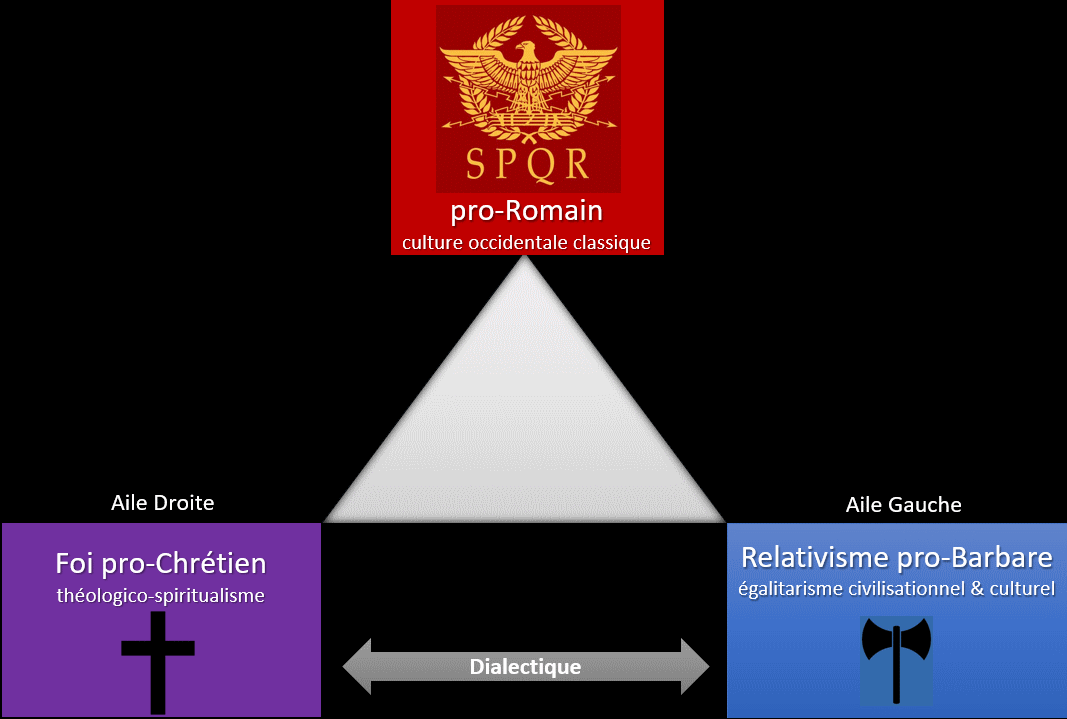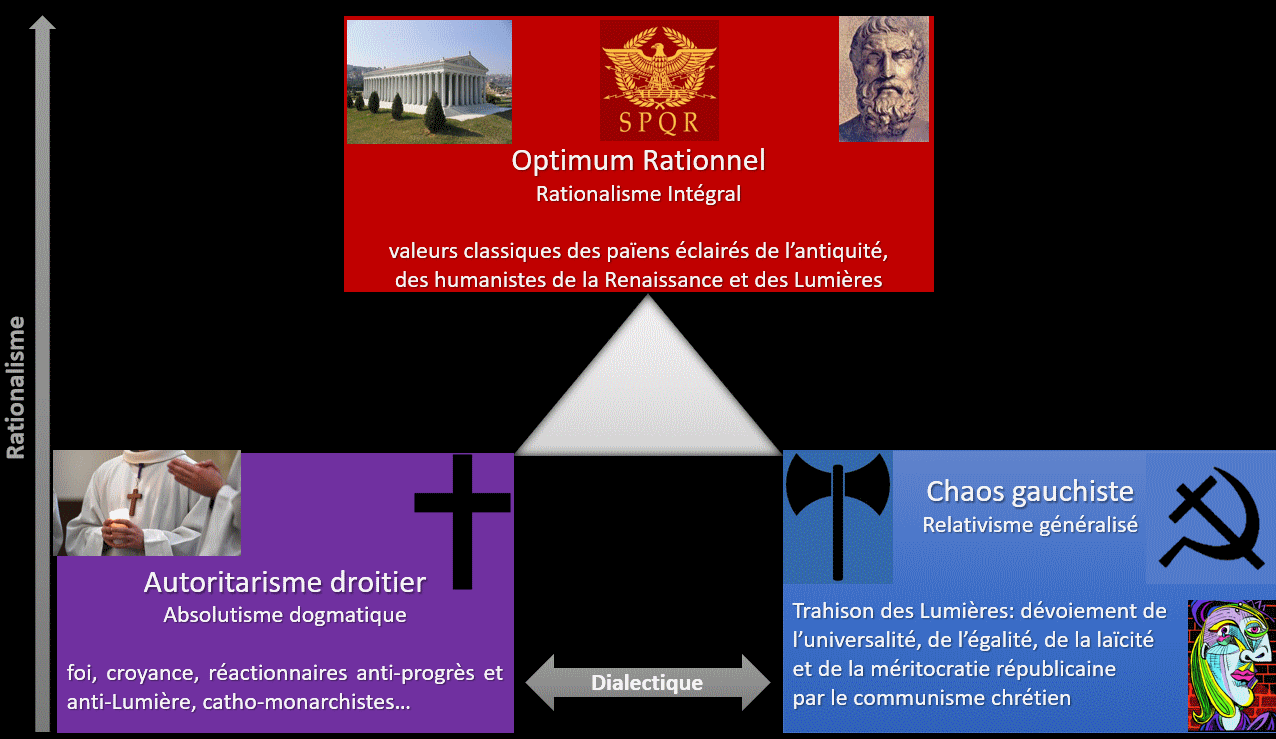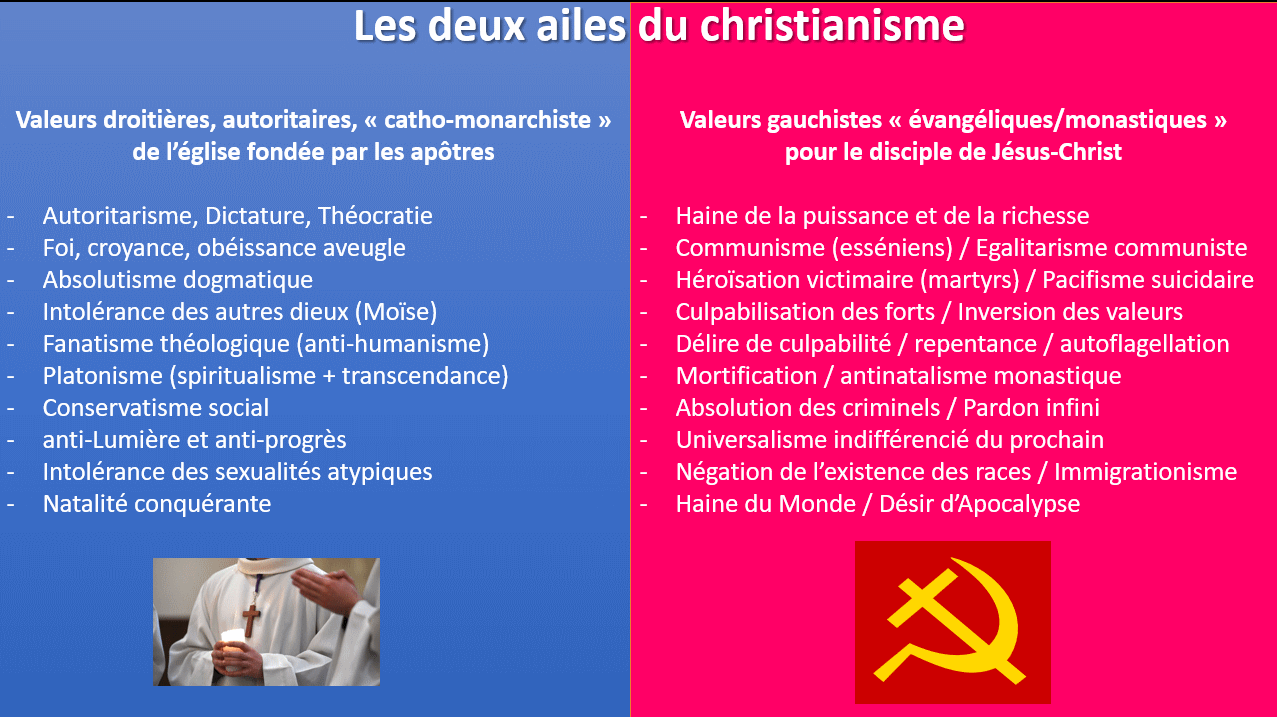La question de la responsabilité du christianisme dans l'effondrement de
l'empire romain d'Occident au Ve siècle ne peut pas être balayée comme étant
seulement la thèse de Voltaire, de Nietzsche et d'autres libre-penseur
anti-chrétiens. C'est la conclusion d'Edward Gibbon, le
plus célèbre historien sur la chute de l'empire Romain, et c'était aussi la prédiction du philosophe
païen Celse déjà au IIe siècle en cas de conversion de l'empire au
christianisme. Les contemporains du sac de Rome (en 410 par les
Wisigoths) jugèrent que l'adoption toute récente du christianisme (en 395)
était la cause directe de cette catastrophe. La polémique était telle
que Saint-Augustin écrivit justement son oeuvre majeure la cité de Dieu contre les païens pour répondre à cette accusation (le livre
le plus recopié au moyen-âge - voir
les chapitres 1-5 et chez son collègue Orose). On retrouve cette accusation contre le christianisme également chez le principal historien antique
pour cette période: Zosime.
L'histoire
de la chute de Rome est très liée à l'évolution de la philosophie et
aux transformations religieuses qui ont eu lieu et sans lesquelles il
n'est pas possible de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Nous
allons parler ici surtout d'histoire, mais avec un regard de philosophe qui est essentiel pour traiter réellement des
causes de la chute de Rome et comprendre l'implication majeure du christianisme.
Clarification: La chute
de Rome est-elle due à une cause interne ou une cause
externe. Dit
autrement, y a-t-il eu une décadence des romains ou ont-ils été balayé
par la puissance incontrôlable des envahisseurs barbares qui était
décuplée à ce moment là ? Les
armées barbares qui déferlent sur l'Occident à partir de 406 ne
représentent au total qu'une faible armée évaluée 120 000 combattants (voir la synthèse de
M. de Jaeghere p545), divisés entre eux et mal équipés. A titre de comparaison,
les gaulois coalisés et vaincus par Jules Caesar a Alésia étaient 3 fois plus
nombreux (80 000+ 240 000 = 320 000 Gaulois) et Jules Caesar ne commandait à
l'époque qu'un tiers de l'armée romaine (la plus grosse partie était en orient
étant commandée par Pompée le grand).
"il faut se représenter ces invasions comme des expéditions
de bandes de pillards qui ne rencontraient rien devant eux" "quelques
légions d'autrefois commandées par un chef de moyenne valeur auraient eu raison
sans trop d'efforts des bandes incohérentes contre lesquelles tremblaient les
sujets d'Honorius""
Piganiol, le sac de Rome, p96 p122
Les Barbares sont certes la cause instrumentale qui
a réalisé la destruction finale de Rome et de son empire (cause effectrice), mais la
véritable cause de la chute est
interne à l'empire romain. Ceci apparaît encore plus évident quand on
apprend
que 90% de l'armée a disparu en un siècle ! Juste avant
la
conversion de Constantin au christianisme, l'armée romaine
comptait un
demi-million d'hommes sous Dioclétien au début du IVe siècle (450 000 -
640 000
soldats). Alors que sous la régence de Stilicon, au début du Ve
siècle, celui-ci
ne parvient difficilement à mobiliser que 30 000 faibles soldats en
recrutant
parmi les esclaves. Il s'est donc produit un effondrement militaire. Il
nous faut rechercher
la cause de cet effondrement qui est à l'évidence la cause interne qui permet
ensuite la chute brutale de Rome et l'invasion de l'empire au début du Ve siècle.
https://www.youtube.com/@Maiorianus_Sebastian
version française: https://www.youtube.com/@LEssentieldelHistoire/videos

Chronologie
christianisation/réaction païenne et invasion
Barbare
L'interdiction du paganisme précède la chute : une simple coïncidence ? L'élément frappant lorsqu'on
étude la chronologie, c'est que l'interdiction du paganisme est presque
immédiatement suivie des invasions barbares. C'est notre point de départ qui
doit nous amener à nous demander s'il y existe des liens de causalité en la
christianisation de l'empire et les invasions. En guise d'introduction, je vous
propose de balayer la chronologie de la christianisation de l'empire romain car
celle-ci permet déjà à elle seule de faire des révélations explosives dont
presque personne ne parle.
- 313 Edit de Milan. L'empereur Constantin autorise le christianisme et accorde désormais des faveurs personnelles à cette religion.
- 324 Constantin établit le dogme catholique au concile de Nicée en 325.
- 346 Julius Firmicus Maternus écrit à
l'empereur pour réclamer la destruction du paganisme. Constance fils de
Constantin promulgue les premiers édits qui tentent d'interdire les pratiques
religieuses païennes. CT 16.10.3 CT 16.10.4 Probable
difficultés d'application.
-
350 Magnence un païen usurpateur du titre impérial soutenu
par des païens excédés par les mesures de l'empereur chrétien est
proclamé Empereur à Autun en Gaulle. Il prend le pouvoir en
Occident et fait abroger la législation
anti-païenne. Il élimine l'empereur Constant Ier (un des fils de Constantin), parvient à règner 3
ans, mais il échoue finalement à s'imposer. La
révolte de Magnence: "coûta à l’empire la perte de ses plus
grandes forces, avec lesquelles il aurait pu faire la guerre à toute puissance
étrangère, garantir ses frontières, et multiplier ses triomphes."
Eutrope, X, 12.
- 356 Incursions germanique dans
la Gaulle qui a été affaiblie par la révolte de Magnence. Julien envoyé pour rétablir la situation.
- 353-360 l'Empereur chrétien Constance continue sa politique de fermeture
des temples païens dont on a un témoignage d'application en Egypte (Sozomène, Histoire ecclésiastique,
IV, 10).
- 361 Restauration
païenne dans tout l'Empire. Révolte païenne contre Constance. L'Empereur Julien
l'apostat/le philosophe est proclamé Empereur à Lutèce et rétablit le paganisme, l'hôtel de la
victoire et condamne l'église chrétienne à restaurer tous les temples
qu'ils ont abîmés. L'église chrétienne est ruinée.
- 363 Mort de Julien - Annulation de ses
mesures pro-païennes. Le camp chrétien reprend le pouvoir. reprise de la christianisation et persécutions de l'élite païenne.
- 378 Acceuil de Wisigoths en phase de christianisation dans les
Balkans. Rebellion, puis défaite de l'armée romaine à Andrinople.
- 382 Traité de
paix avec les Wisigoths (Mercenaires
pour l'empereur chrétien pour matter les païens récalcitrants.
Politique suivie jusqu'au sac de Rome et peut-être le sac de Rome
compris).
- 380 Edit de Thessalonique (appel à
la conversion de tous au christianisme nicéen).
- 381 Ceux qui font des sacrifices païens ou des prières seront
pénalisés par la perte de leur propriété. CT 16.10.7
Avec Maxime statu quo de l'affrontement païen-chrétien jusqu'en 388
en Occident. Maxime ne prend plus de mesures antipaïenne mais sans annuler l'action de son prédécesseur.
- 383 [Orient] Loi contre l'apostasie: les chrétiens confirmés qui se sont tournés vers
le paganisme ne peuvent émettre de testament à personne. CT 16.7.2 (renforcée
en 391: Les personnes ayant un rang ou un statut hérité qui abandonnent le
christianisme perdront leur position et seront marquées d'infamie) CT 16.7.5.
- 386 [Orient] Destruction du temple de Zeus ordonné par l'évêque d'Apamée (Syrie).
- 388 [Orient] Aucune discussion ou débat public sur la religion ne peut avoir lieu. CT 16.4.2
- 388 Théodose débarrassé de Maxime fait irruption à
Rome en traînant les dieux de l'antiquité en triomphe derrière son char (Gibbon, chap XXVIII). Conversion forcée imposée au
Sénat de Rome sous la pression de l'empereur.
- 391 Arrêt de mort du paganisme. Edit d’interdiction de visiter
les temples païens. Interdiction du culte des images. (Dans la
citée de Dieu. St Augustin confirme que la religion est paienne est désormais
interdite)
Législation probablement obtenue par Ambroise de Milan qui
culpabilise l'empereur après le massacre de Thésallonique et manipule ce dévôt pour qu'il fasse la
politique que l'église veut pour l'empire. On est en train de basculer en théocratie.
- 392 La loi du 8 novembre 392 est
particulièrement répressive puisque les simples particuliers n’ont, en outre,
plus le droit d’honorer leurs pénates ou les dieux lares : la mesure s’applique
donc à la sphère privée, à l’intimité des foyers, et la police impériale est en
droit de perquisitionner afin d’arrêter les contrevenants dont les biens ainsi
que les demeures, dit la loi, peuvent être saisis. Les lois ne surveillent donc
pas seulement l’espace public mais aussi le domaine privé "Que personne,
absolument, ne sacrifie une victime innocente, ni, par un sacrilège plus
discret, adorant son dieu lare par du feu, son génie par du vin, ses pénates
par du parfum, n'allume des lampes, ne répande de l'encens, n'accroche de
guirlandes" CT 16.10.12.
- 392 Destruction du Sérapéum et de la grande
bibliothèque ordonné par l'évêque d'Alexandrie (Egypte). (Gibbon, chap XXVIII).
-
393 Nouvelle réaction païenne en Occident. Le général Arbogaste fait proclamer Eugène empereur
qui rétablit une dernière fois l'hôtel de la victoire et les cultes païens
à Rome et en Occident.
- 394 La guerre civile se
résout à bataille du Frigidus: défaite du camps païen.
- 395 Les Wisigoths profitent de l'affaiblissement de l'armée romaine dans cette guerre civile pour aller
ravager la Grèce (Athènes et Sparte).
- 394 Interdiction des jeux olympiques.
3000 ans d'antiquité gréco-romaine, mais aussi égyptienne disparaissent à ce
moment là.
- 395 Edit stipulant que chacun doit se hâter d'obéir aux
lois précédemment promulguées sur les hérétiques et les païens (en 391). Les
gouverneurs et autres fonctionnaires qui n'appliquent pas cette loi seront
punis et condamnés à une amende, et les gouverneurs en particulier. CT
16.10.13
- 395 Edit réclamant de retirer les hérétiques du service impériale CT
16.5.29
- 396 Tous les privilèges
accordés dans l'ancienne loi aux prêtres et chefs païens sont abolis. Ils ne
peuvent prétendre à des privilèges, car leur profession est aujourd'hui
condamnée. CT 10.10.14
- 397 Edit demandant la
réutilisation des pierres des temples païens détruits (édit de
déblayage en orient). CT.16.1.36. Les femmes païennes refusent de marcher sur
la route (Marc le
Diacre. Vie de Porphyre de Gaza, 76).
- 399 Les temples païens dans les zones rurales doivent être
démolis. CT 16.10.16
- 399 Les temples ne contenant pas d'objets illégaux [tels que des
statues et des autels] ne peuvent pas être détruits. Les ornements des
bâtiments publics ne doivent pas être détruits. Nul ne peut utiliser des lois
antérieures comme prétexte pour détruire des édifices publics. Si des
réparations sont nécessaires sur un bâtiment, l'autorisation est accordée
d'enlever les images des empereurs sans consultation préalable, à condition
qu'elles soient restaurées dès que les réparations sont terminées. CT
16.10.18 CT 16.10.15 CT 15.1.44
- Vers 400 Destruction de temples.
Le temple d'Artémis à Ephèse par les troupes de Jean Chrysostome et à
Gaza (Vie de Porphyre de Gaza. Marc le
Diacre).
- 401 Les Wisigoths entrent en
Italie du Nord. Ils sont vaincus par l'armée romaine mais on décide de les renvoyer libres dans
les Balkans au lieu de les soumettre. (politique des dirigeants chrétiens qui scandalise l'élite païenne)
- 403/405 le collège des vestales est aboli et le feu sacré est
éteint. Stilicon fait brûler les Livres sibyllins et son
épouse Serena, également nièce de Théodose, entre dans le temple de Vesta,
prend le collier de la statue de la déesse et le place à son propre cou
(Zosime, V, 38).
-
406 Les Ostrogoths pénètrent dans l'Empire Romain et ravagent l'Italie du
Nord. Ils font le siège de Florence (sauvé in extremis par Stilicon).
- 406 (31 dec) Franchissement du Rhin
glacé par les Vandales, Alains, Suèves qui ravagent la Gaulle.
- 407 Abandon de la Bretagne.
-
407 Edit ordonnant la destruction des idoles dans les
lieux de culte. Destruction des images qui reçoivent un culte. Tous les
autels païens doivent être démolis. Interdiction générale des pratiques païennes. Interdiction des cérémonies
païennes (banquets). CT 16.10.19. Emeutes
anti-chrétiennes à Calama.
- 408 Epuration du gouvernement. Interdiction aux "ennemis de
la religion catholique" de servir au palais impérial ou à tout poste
impérial CT 16.5.42 (Généride et
d'autres généraux païens "restent à la maison" Zosime). (Exception
autorisée en 410 CT 16.5.48 rétablissement en 416).
- 409 Les outrages contre les évêques
catholiques méritent la peine capitale. CT 16.5.46
- 409 réaction païenne sous
Attale préfet de Rome. L'empereur chrétien Honorius était disposé à prendre la
fuite à bord de sa flotte, quand il reçut un secours d'Orient. Echec d'Attale.
-
409 Les Vandales et d'autres Germains ravagent l'Espagne
- 410 Sac de Rome par les
Wisigoths
- 412 Les
esclaves et les métayers (agriculteurs serviles) seront
rappelés à la foi catholique par de fréquentes flagellations. CT
16.5.52
- 415 Toute place
autrefois consacrée au paganisme sera donnée à l'église. CT
16.10.20
- 415 Assassinat de la philosophe Hypatie par la milice de
l'évêque Cyrille à Alexandrie (reconnut comme un Saint par l'église).
- 416 Exclusion des païens de l'armée, de
l'administration, et de la justice. CT 16.10.21
- 416 Les Wisigoths (ceux-là même
qui ont pillés Rome, l'Italie et la Grèce !) sont
recrutés pour être
envoyés en Espagne à la solde l'empreur chrétien combattre d'autres
barbares. En échange, on leur accorde des terres en Aquitaine (dès 416). L'empereur chrétien préfère les
barbares aux romains païens !
- 431 "le
pape Célestin écrit que la cause de la foi (fide
causa) est plus importante que celle de l'état. L'empereur doit faire
passer la paix des églises avant la sécurité du monde (omnium securitas
terrarum)." André Piganiol, le mémorial des Siècles, le
sac de Rome, 1964. p121. L’aveu d'un conflit entre l’intérêt de
l'église et ceux de l'état et avoue la politique menée.
- 423 Les païens doivent être exilés et
leurs biens confisqués CT 16.10.23. Mais une
autre loi précise: les chrétiens ne peuvent pas attaquer ou piller les
juifs ou les païens. CT 16.10.24 (Loi révélatrice du climat de débordement
mais peut-être aussi une temporisation stratégique liée à la prise de
pouvoir d'un usurpateur païen Jean en Occident qui n'a pas les moyens de
s'imposer. L'Empire d'Orient intervient pour le balayer en 425 et le
remplacer par un chrétien qui fait annuler sa législation anti-chrétienne.
- 429 Les Vandales ravagent l'Afrique du Nord
- 435 Edit de rappel de destruction des temples "s'il en reste
d'intacts". Les temples et sanctuaires païens doivent être démolis et
remplacés par le symbole du christianisme : la croix. Quiconque se moque de
cette loi risque d'être exécuté. CT 16.10.25
- 449 Le livre du philosophe
Porphyre contre les chrétiens et les autres du même genre doivent être livrés
aux flammes. Il importe que des écrits propres à provoquer la colère de dieu et
à offenser les âmes pieuses ne puissent parvenir à l'oreille des hommes (CT.16.6.65/66)
(sur Porphyre voir aussi: Socrate, histoire e l'église, I,
9)
- 435 les Vandales (Genséric)
obtiennent le statut de fédérés de l'Empire (après avoir ravagé l'Afrique
!)
- 456/457 général
Marcellinus (païen), Empereur Majorien (chrétien avec une politique
pro-païen/anti-chrétien) & Anthémius (païen) à Rome. Anthémius prépare la réouverture du temple de Jupiter et des culte païens à Rome.
- 472 Olybrius rétablit
la législation anti-païenne qui avait été annulée
- 476
Dernier empereur Romain d'Occident
-
VIe siècle. Atteintes à la liberté de conscience. Baptème obligatoire
(Justinien en Orient).
- IXe siècle. Convertion des derniers
païens helléniques qui n'ont pas encore tous disparus en occident (exemples
en Gaulle, en Italie, en Grèce).
-XIe siècle Conversion des derniers païens helléniques
qui n'ont pas encore tous disparus en orient.
Source: CT Codex Theodosianus (latin) (english)
En conclusion, la volonté fanatique d'imposer de force le
christianisme à une masse païenne qui ne voulait pas se couvertir a provoqué une guerre civile qui a désagrégé la société, engendré des défections, brisé l'unité
de l'armée et provoqué la chute brutale de l'empire romain d'Occident.
Nous allons documenter cette thèse en nous appuyant sur le classique d'Edward
Gibbon historien le plus célèbre de la chute de Rome et qui incrimine
nettement
le christianisme. Nous allons exposer sa thèse mais également l'enrichir des vues
de nombreux autres historiens et découvertes
archéologiques plus récentes. Nous allons ainsi vous proposer les clefs
de compréhension des éléments qui expliquent le sac de Rome de 410, la
chute brutale de
l'Empire romain d'Occident, et plus largement la disparition de la
civilisation
gréco-romaine. Nous allons montrer les éléments qui pointent effectivement la
responsabilité du christianisme dans ces désastres.
La disparition de la civilisation gréco-romaine est à
l'évidence due à de multiples causes non exclusives (on compte plus de 210 théories)
mais qui aboutissent au final à son remplacement par la civilisation
judéo-chrétienne. En utilisant "Histoire du déclin et de la chute
de l'Empire romain : Rome de 96 à 582". Edward Gibbon comme
fils conducteur, complété d'autres sources plus récentes, nous allons voir que le déclin de l'empire romain d'Occident s'est
déroulé selon quatre grandes étapes que nous allons présenter dans la première grande partie:
1 - l'âge d'Or de
l'Empire Romain (IIe siècle)
2 - la déstabilisation:
mutation culturelle (IIIe
siècle)
3 - le basculement:
changement de religion et donc de civilisation (IVe siècle)
4 - l'effondrement:
les
invasions barbares (Ve
siècle)
Ensuite dans la deuxième grande partie, nous allons voir les opinions de célèbres historiens et philosophes et nous allons aussi confronter leurs opinions aux
réfutations qui ont été avancées par ceux qui au contraire affirment que
le christianisme n'est pas la cause de la chute de Rome.
PARTIE I
Etat
des Lieux: l'antiquité gréco-romaine un sommet de la civilisation
(Ve siècle avant JC - IIe siècle après JC)
- L'apogée
de l'antiquité gréco-romaine la civilisation gréco-romaine naît au
VIIIe siècle avant JC (époque d'Homère en Grèce et fondation de Rome en
Italie). Son apogée commence du Ve siècle après JC à la fin du IIe siècle
après JC. Cette civilisation atteint son sommet au IIe siècle après JC,
sous les Antonins, époque de paix, de prospérité et de bonheur presque
généralisé. Selon Gibbon, au IIe siècle, "Les plus riches
habitants de l'Italie avaient presque tous embrassés la philosophie d'Épicure"
(Gibbon, Chap III). Cicéron nous
dit que l'épicurisme a inondé l'Italie et été adopté en masse par la population
italienne (Tusculanes IV). On retrouvera des vers de Lucrèce à Pompei.
Note: 7 siècles centraux - Epicurisme et stoïcisme dominant. Epicurisme
grand courant philosophique qui représente à la frange la plus éclairée dans
les élites et les cercles du pouvoir qui démarre avec Démocrite (disciples
autour de Périclès et Alexandre le grand). Epicurisme à la cour des séleucides
; dans la famille de Jules Caesar et de l'empereur Auguste. Quand
Paul de Tarse va à Athènes ils voient des épicuriens et stoïciens (actes des
apôtres). Au IIe siècle l'impératrice Plotine. Chaires de philosophie créées
sous Marc-Aurèle. Les derniers épicuriens: Lucien. Diogène
d'Œnoanda sur pierre. Diogène Laerce début IIIe siècle histoire de la
philosophie qui se conclut sur Epicure système le plus abouti.
 - Le
IIe siècle romain: un sommet du développement humain. L'Empire romain
avait atteint au IIe siècle un niveau de développement humain et une prospérité
encore inégalée à son époque. Au XVIIIe siècle, Gibbon pouvait encore écrire
que la population de l'empire romain de cette époque "excède
peut-être celle de l’Europe moderne, et qui forme la société la plus nombreuse
que l’on ait jamais vue réunie sous un seul gouvernement" (Gibbon, Chap
II). En effet, Alexandrie comptait au moins un demi-million
d'habitant et Rome 1,2 million d'habitant, un niveau que Paris et Londres
n'atteignent qu'au XIXe siècle !
- Le
IIe siècle romain: un sommet du développement humain. L'Empire romain
avait atteint au IIe siècle un niveau de développement humain et une prospérité
encore inégalée à son époque. Au XVIIIe siècle, Gibbon pouvait encore écrire
que la population de l'empire romain de cette époque "excède
peut-être celle de l’Europe moderne, et qui forme la société la plus nombreuse
que l’on ait jamais vue réunie sous un seul gouvernement" (Gibbon, Chap
II). En effet, Alexandrie comptait au moins un demi-million
d'habitant et Rome 1,2 million d'habitant, un niveau que Paris et Londres
n'atteignent qu'au XIXe siècle !
Malgré la méconnaissance de découvertes
essentielles de la renaissance nécessaires au monde moderne (pomme de
terre, mécanisation...), le génie de l'organisation antique avait permis
un niveau de développement sans précédent, nettement visible dans les biens de
consommations. L'historien-archéologue Bryan Ward-perkins insiste que dans
l'empire romain ce développement des biens de consommation touche même les
classes modestes dans des provinces reculées comme la bretagne.
 - Félicité générale: "les
Romains et les habitants des provinces sentaient vivement et reconnaissaient de
bonne foi l’état heureux et tranquille dont ils jouissaient. « Ils conviennent
tous que les vrais principes de la loi sociale, les lois, l’agriculture, les
sciences, enseignées d’abord dans la Grèce par les sages Athéniens, ont pénétré
dans toute la terre avec la puissance de Rome, dont l’heureuse influence sait
enchaîner, par les liens d’une langue commune et d’un même gouvernement, les
Barbares les plus féroces. Ils affirment que le genre humain, éclairé par les
arts, leur est redevable de son bonheur et d’un accroissement visible : ils
célèbrent la beauté majestueuse des villes et l’aspect riant de la campagne,
ornée et cultivée comme un jardin immense : ils chantent ces jours de fêtes, où
tant de nations oublient leurs anciennes animosités au milieu des douceurs de
la paix, et ne sont plus exposées à aucun danger. » Quelque doute que puisse
faire naître le ton de rhéteur et l’air de déclamation que l’on aperçoit dans
ce passage, ces descriptions sont entièrement conformes à la vérité
historique." (Gibbon, Chap
II).
- Félicité générale: "les
Romains et les habitants des provinces sentaient vivement et reconnaissaient de
bonne foi l’état heureux et tranquille dont ils jouissaient. « Ils conviennent
tous que les vrais principes de la loi sociale, les lois, l’agriculture, les
sciences, enseignées d’abord dans la Grèce par les sages Athéniens, ont pénétré
dans toute la terre avec la puissance de Rome, dont l’heureuse influence sait
enchaîner, par les liens d’une langue commune et d’un même gouvernement, les
Barbares les plus féroces. Ils affirment que le genre humain, éclairé par les
arts, leur est redevable de son bonheur et d’un accroissement visible : ils
célèbrent la beauté majestueuse des villes et l’aspect riant de la campagne,
ornée et cultivée comme un jardin immense : ils chantent ces jours de fêtes, où
tant de nations oublient leurs anciennes animosités au milieu des douceurs de
la paix, et ne sont plus exposées à aucun danger. » Quelque doute que puisse
faire naître le ton de rhéteur et l’air de déclamation que l’on aperçoit dans
ce passage, ces descriptions sont entièrement conformes à la vérité
historique." (Gibbon, Chap
II).
"S’il fallait déterminer dans quelle période
de l’histoire du monde le genre humain a joui du sort le plus heureux et le
plus florissant, ce serait sans hésiter qu’on s’arrêterait à cet espace
de temps qui s’écoula depuis la mort de Domitien (en 96) jusqu’à
l’avènement de Commode (en 180). Un pouvoir absolu gouvernait l’étendue immense
de l’empire, sous la direction immédiate de la sagesse et de la vertu. Les
armées furent contenues par la main ferme de quatre empereurs successifs, dont
le caractère et la puissance imprimaient un respect involontaire, et qui
savaient se faire obéir, sans avoir recours à des moyens violents. Les formes
de l’administration civile furent soigneusement observées par Nerva, Trajan,
Adrien et les deux Antonins, qui, chérissant l’image de la liberté, se
glorifiaient de n’être que les dépositaires et les ministres de la loi. Gibbon
reprendre la thèse des "cinq bons empereurs" (expression inventée en 1503 par
Machiavel) et ceci est particulièrement
vrai pour les deux derniers: "Ces deux règnes sont
peut-être la seule période de l’histoire, dans laquelle le bonheur d’un peuple
immense ait été l’unique objet du gouvernement." (Gibbon, Chap
III).
Le
progrès morale et sociétal
 - La paix
(Pax Romana - une prospérité inédite). "Adrien et les
deux Antonins s’attachèrent également au système général embrassé par Auguste.
Ils persistèrent dans le projet de maintenir la dignité de l’empire, sans
entreprendre d’en reculer les bornes : on vit même ces princes employer toutes
sortes de moyens honorables pour gagner l’amitié des Barbares. Leur but
était de convaincre le genre humain que Rome, renonçant à toute idée de
conquête, n’était plus animée que par l’amour de l’ordre et de la justice." "Les
contrées soumises à Trajan et aux Antonins étaient étroitement unies entre
elles par les lois, et embellies par les arts. Il pouvait arriver qu’elles
eussent à souffrir occasionnellement de quelques abus du pouvoir confié aux
délégués du souverain ; mais en général le principe du gouvernement était
sage, simple et établi pour le bonheur des peuples. Les habitants des provinces
exerçaient paisiblement le culte de leurs ancêtres, et, confondus avec les
conquérants, ils jouissaient des mêmes avantages, et parcouraient d’un pas égal
la carrière des honneurs." (Gibbon, Chap
I). Pas une société militarisée, seulement 0,5% de soldats.
- La paix
(Pax Romana - une prospérité inédite). "Adrien et les
deux Antonins s’attachèrent également au système général embrassé par Auguste.
Ils persistèrent dans le projet de maintenir la dignité de l’empire, sans
entreprendre d’en reculer les bornes : on vit même ces princes employer toutes
sortes de moyens honorables pour gagner l’amitié des Barbares. Leur but
était de convaincre le genre humain que Rome, renonçant à toute idée de
conquête, n’était plus animée que par l’amour de l’ordre et de la justice." "Les
contrées soumises à Trajan et aux Antonins étaient étroitement unies entre
elles par les lois, et embellies par les arts. Il pouvait arriver qu’elles
eussent à souffrir occasionnellement de quelques abus du pouvoir confié aux
délégués du souverain ; mais en général le principe du gouvernement était
sage, simple et établi pour le bonheur des peuples. Les habitants des provinces
exerçaient paisiblement le culte de leurs ancêtres, et, confondus avec les
conquérants, ils jouissaient des mêmes avantages, et parcouraient d’un pas égal
la carrière des honneurs." (Gibbon, Chap
I). Pas une société militarisée, seulement 0,5% de soldats.
"La plupart des villes étaient, à des titres divers, de
petites républiques. L’esprit municipal y était très-fort; elles n’avaient
perdu que le droit de se déclarer la guerre, droit funeste qui avait fait du
monde un champ de carnage. « Les bienfaits du peuple romain envers le genre
humain » étaient le thème de déclamations parfois adulatrices, mais auxquelles
il serait injuste de dénier toute sincérité. Le culte de « la paix romaine ». L’idée
d’une grande démocratie, organisée sous la tutelle de Rome, était au fond de
toutes les pensées." "le monde, sous bien des rapports, n’avait pas
encore été aussi heureux." "l'Empire fut une ère de prospérité et de
bien-être comme on n’en avait jamais connu ; il est même permis d’ajouter sans
paradoxe, de liberté." "L’Empire inaugura une période de liberté, en
ce sens qu’il éteignit la souveraineté absolue de la famille, de la ville, de
la tribu, et remplaça ou tempéra ces souverainetés par celle de
l’État." Renan
-
L'Empereur Romain: un monarque républicain au service du bonheur du peuple. "L’aspect
de la cour répondait aux formes de l’administration. Si nous en exceptons ces
tyrans qui, emportés par leurs folles passions, foulaient aux pieds toutes les
lois de la nature et de la décence, les empereurs dédaignèrent une pompe dont
l’éclat aurait pu offenser leurs concitoyens, sans rien ajouter à leur
puissance réelle. Dans tous les détails de la vie, ils semblaient oublier la
supériorité de leur rang : souvent ils visitaient leurs sujets, et les
invitaient à venir partager leurs plaisirs ; leurs habits, leur table, leur
palais, n’avaient rien qui les distinguât d’un sénateur opulent : leur
maison, quoique nombreuse et brillante, n’était composée que d’esclaves et
d’affranchis. Auguste ou Trajan aurait rougi d’abaisser le dernier des citoyens
à ces emplois domestiques que les nobles les plus fiers de la Grande-Bretagne
sont aujourd’hui si ambitieux d’obtenir dans la maison et dans le service personnel
du chef d’une monarchie limitée."
"Dans
les républiques d’Athènes et de Rome, la modestie et la simplicité des maisons
particulières annonçaient l’égalité des conditions, tandis que la souveraineté
du peuple brillait avec éclat dans la majesté des édifices publics.
L’introduction des richesses et l’établissement de la monarchie n’éteignirent
pas tout-à-fait cet esprit républicain. Ce fut dans les ouvrages destinés à la
gloire et à l’utilité de la nation, que les plus vertueux empereurs déployèrent
leur magnificence. Le palais d’or de Néron avait excité à juste titre
l’indignation ; mais cette vaste étendue de terrain envahie par un luxe
effréné, servit bientôt à de plus nobles usages." Gibbon, Chap
II Marc-Aurèle honore Brutus qui avait participé à l'assassinat de
Caesar et tenter de restaurer la république (Jules Caesar qui était pourtant
très loin d'être un tyran).
- La méritocratie républicaine. "[L'Empereur]
Vespasien, né dans l’obscurité, ne tirait aucun lustre de ses ancêtres : son
aïeul avait été soldat, et son père possédait un emploi médiocre dans les
fermes de l’état." (Gibbon ChapIII). Egalité
juridique de tous les citoyens devant la loi (la loi des 12 tables en 451 avant
JC: voir cours en vidéo).
Pertinax et Dioclétien, sont des fils d'esclave, qui deviennent empereur
romain.
- Politique sociale. L'eau potable, les thermes, et distribution
pain gratuites à la population. Trajan créa l'aide alimentaire pour les enfants
démunis. De même, Marc-Aurèle créa un orphelinat pour jeunes filles
abandonnées. (Dumézil sur l'Evergétisme).
- Conditions des femmes. A partir
d'Auguste, les femmes sont émancipées de la tutelle de leur père ou mari après
leur troisième enfants (déjà levé sous Claude et le juriste Gaius ce n'est même
plus en pratique sous les antonins). Elles peuvent signer des actes juridiques
et gérer leurs affaires. Les filles vont à l'école. La place majeure
des Vestales dans la religion romaine montre également une différence notable
avec le catholicisme et l'islam ou aucune fonction religieuse d’importance
n’est occupée par des femmes. La situation est meilleure pour les femmes que
dans l’Occident chrétien du XIXe siècle.
- Conditions des esclaves. Dans
l'antiquité, le mot esclave ne décrit pas tout à fait la même réalité que
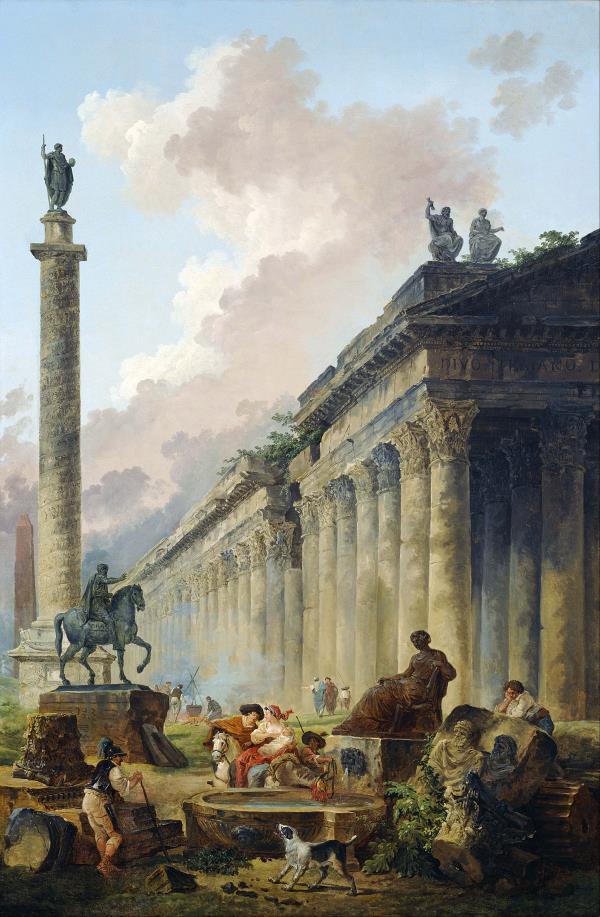 l'esclavage moderne à l'époque du code de noir. Les esclaves sont
principalement des prisonniers de guerres issus de peuple qui menaçaient Rome
et que Rome conquiert (l'histoire a prouvé que la menace était bien
réelle). L'esclavage est la seule alternative à l'exécution des vaincus sur
le champ de bataille ; que l'on ne peut pas relâcher dans la nature. On
est encore dans un monde peu civilisé à l'époque avec des hommes préhistoriques
(les barbares). Tout cela n'excuse pas l'exploitation horrible et tous les
abus qui en ont découlés (révolte légitime Spartacus) ; mais sous les Antonins
on observe un adoucissement de la condition des esclaves et des nouvelles lois
pour les protéger des abus (Gibbon, Chap
II). L'abolition n'est pas tellement un sujet car l'esclave
méritant a vocation à gagner son affranchissement. Et à Rome, cela se produit
souvent. Déjà au début de l'empire, les affranchissements étaient devenus
tellement massifs au point de déstabiliser l'ordre social que l'empereur
Auguste édicta une loi pour les ralentir (Lex Aelia Sentia et Lex
Fufia Caninia). Environ un tiers des esclaves sont affranchis par
génération (le satyricon met en scène de riches affranchis). La
méthode est donc rude mais le monde progresse. En passant par la dure case
de l'esclavage, Rome transforme progressivement
ses ennemis sauvages en homme libre, civilisé et citoyen à part
entière. Enfin, n'en déplaise à l'imaginaire chrétien et aux
croyants qui ne connaissent pas leur religion, il n'y a pas de progrès mais une
régression de la condition des esclaves avec l'arrivée du christianisme au
pouvoir (voir sur notre page contre Jésus).
l'esclavage moderne à l'époque du code de noir. Les esclaves sont
principalement des prisonniers de guerres issus de peuple qui menaçaient Rome
et que Rome conquiert (l'histoire a prouvé que la menace était bien
réelle). L'esclavage est la seule alternative à l'exécution des vaincus sur
le champ de bataille ; que l'on ne peut pas relâcher dans la nature. On
est encore dans un monde peu civilisé à l'époque avec des hommes préhistoriques
(les barbares). Tout cela n'excuse pas l'exploitation horrible et tous les
abus qui en ont découlés (révolte légitime Spartacus) ; mais sous les Antonins
on observe un adoucissement de la condition des esclaves et des nouvelles lois
pour les protéger des abus (Gibbon, Chap
II). L'abolition n'est pas tellement un sujet car l'esclave
méritant a vocation à gagner son affranchissement. Et à Rome, cela se produit
souvent. Déjà au début de l'empire, les affranchissements étaient devenus
tellement massifs au point de déstabiliser l'ordre social que l'empereur
Auguste édicta une loi pour les ralentir (Lex Aelia Sentia et Lex
Fufia Caninia). Environ un tiers des esclaves sont affranchis par
génération (le satyricon met en scène de riches affranchis). La
méthode est donc rude mais le monde progresse. En passant par la dure case
de l'esclavage, Rome transforme progressivement
ses ennemis sauvages en homme libre, civilisé et citoyen à part
entière. Enfin, n'en déplaise à l'imaginaire chrétien et aux
croyants qui ne connaissent pas leur religion, il n'y a pas de progrès mais une
régression de la condition des esclaves avec l'arrivée du christianisme au
pouvoir (voir sur notre page contre Jésus).
- Tolérance de la diversité religieuse et lutte contre les
fanatiques. Les romains polythéistes étaient  généralement assez
tolérants envers les diverses formes de culte dans l'Empire. Chaque peuple
pouvait honorer les dieux de ses ancêtres. Toutefois, les romains combattaient
férocement certaines formes de superstition avec sacrifice humain qui les
révoltait comme les bacchanales et la religion des druides qui
avaient interdit l'écriture, et
fomentaient des révoltes contre le pouvoir Romain, ce pourquoi leur religion
fut interdite en Gaule puis en Bretagne (Gibbon chap
II). De même, le fanatisme des prédicateurs juifs et chrétiens
causèrent des conflits récurrents avec les Grecs et les Romains.
généralement assez
tolérants envers les diverses formes de culte dans l'Empire. Chaque peuple
pouvait honorer les dieux de ses ancêtres. Toutefois, les romains combattaient
férocement certaines formes de superstition avec sacrifice humain qui les
révoltait comme les bacchanales et la religion des druides qui
avaient interdit l'écriture, et
fomentaient des révoltes contre le pouvoir Romain, ce pourquoi leur religion
fut interdite en Gaule puis en Bretagne (Gibbon chap
II). De même, le fanatisme des prédicateurs juifs et chrétiens
causèrent des conflits récurrents avec les Grecs et les Romains.
-un siècle d'irréligion. "Cicéron se servit des
armes de la raison et de l’éloquence pour combattre les systèmes absurdes du
paganisme : mais la satire de Lucien était bien plus faite pour les détruire :
aussi ses traits eurent-ils plus de succès. Un écrivain répandu dans le monde
ne se serait pas hasardé à jeter du ridicule sur des divinités qui n’auraient
pas déjà été secrètement un objet de mépris aux yeux des classes éclairées de la
société. Malgré l’esprit d’irréligion qui s’était introduit dans le siècle des
Antonins, on respectait encore l’intérêt des prêtres et la crédulité du peuple.
Les philosophes, dans leurs écrits et dans leurs discours, soutenaient la
dignité de la raison, mais ils soumettaient en même temps leurs actions à
l’empire des lois et de la coutume. Remplis d’indulgence pour ces erreurs qui
excitaient leur pitié, ils pratiquaient avec soin les cérémonies de leurs
ancêtres, et on les voyait fréquenter les temples des dieux ; quelquefois même
ils ne dédaignaient pas de jouer un rôle sur le théâtre de la superstition, et
la robe d’un pontife cachait souvent un athée." (Anecdote.
Vespasien n'était pas le plus éclairé, il avait chassé les philosophes de Rome,
mais toutefois pour se moquer de la divinisation des Empereurs accordée par le
sénat après leur mort, lorsque mourant il n'avait plus la force de se lever
"je crois que je deviens dieu !". Ironie et d'irréligion.)
"Il
semble que le monde s’effraye de l’incrédulité avouée des temps de César et
d’Auguste" "L’incrédulité à la religion officielle était générale
dans la classe éclairée. Les hommes politiques qui affectaient le plus de
soutenir le culte de l’État s’en raillaient par de forts jolis mots." Renan
 L'antonin
Marc-Aurèle fut le dernier des "cinq bons empereurs" (expression inventée en 1503 par
Machiavel) et qui marque l'âge d'Or de l'empire romain :
L'antonin
Marc-Aurèle fut le dernier des "cinq bons empereurs" (expression inventée en 1503 par
Machiavel) et qui marque l'âge d'Or de l'empire romain :
Il est décrit pas des contemporains comme "bienveillant
mesuré doux affable" Gallien. "Plein de bonté pour les hommes, il
avait l'art de les détourner du mal et de les porter au bien, donnant des
récompenses aux uns, adoucissant les peines des autres. Il rendit bons les
méchants et excellents les bons." (Hist Auguste).
« Une fois que le bruit de sa mort se fut répandu, tous les
soldats furent pareillement étreints et l'on ne vit personne dans l'Empire
romain recevoir sans pleurer une telle nouvelle. Comme à l’unisson, tous
célébraient en lui tantôt un père vertueux, Le Bon empereur, tantôt le vaillant
général tantôt le souverain vaillant est sage mais il n'y avait personne pour
médire. » (Hérodien). Dion Cassius nous dit: « Il se
montra dans son gouvernement le meilleur de tous les hommes qui est jamais exercé
une autorité quelconque ». [Aussi] "le jour de ses funérailles, personne
ne crut devoir le pleurer, tant l'on était persuadé que, prêté par les dieux à
la terre, il était retourné vers eux." (Hist Augsute). "Sa
mémoire fut longtemps chère à la postérité ; et plus d’un siècle encore après
sa mort, plusieurs personnes plaçaient l’image de Marc-Aurèle parmi celles de
leurs dieux domestiques" (Gibbon, Chap
III. Voir aussi Histoire Auguste). Les romains savaient ce qu'ils
avaient perdus.
- La menace chrétienne. A la fin du IIe siècle, le philosophe
païen Celse prédit la chute
future de l'empire romain si un terme n'est pas
rapidement mis à la diffusion du christianisme. Le très sage et très modéré
empereur Marc-Aurèle avait pris des mesures contre les fanatiques
chrétiens. Marc Aurèle condamne à la relégation dans une île ceux qui
agitent les esprits par des pratiques superstitieuses. (Voir plus sur notre
page contre Jésus: Marc-Aurèle contre les
chrétiens). "[Le chrétien Athénagore] s’indigne de la situation
exceptionnelle que l’on fait aux chrétiens, sous un règne plein de douceur et
de félicité, qui donne à tout le monde la paix et la liberté. Toutes les villes
jouissent d’une parfaite isonomie. Il est permis à tous les peuples de vivre
suivant leurs lois et leur religion. [Les chrétiens] sont les seuls hommes que l’on
persécute" (Renan).
L'avènement de l'empereur Commode, (vu au
cinéma), est classiquement présentée par les historiens comme le début de la
décadence de Rome. Ces films oublient toutefois de montrer que le tyran Commode
est le premier à tolérer le
christianisme... Commode était sous l'influence de sa
favorite, Marcia, patronne des chrétiens. Contre la sage politique de son
père, Commode inaugure la tolérance du christianisme dans l'empire et
soutien l'évêque de Rome. "Par une fatalité
singulière, les maux [que les chrétiens] avaient endurés sous le gouvernement
d'un prince vertueux cessèrent tout à coup à l'avènement d'un tyran" (Gibbon, chap
XVI). Commode abandonne aussi la pacification et annexion de la
Germanie à l'Empire entreprise par Marc-Aurèle suite aux attaques surprises
des Germains en 168. L'abandon de ces deux politiques par Commode fut deux
erreurs mortelles: deux siècles plus tard ce sera le triomphe du christianisme
et de la barbarie.
Image de Rome déformée par le cinéma. Les péplums
sont presque tous de la propagande chrétienne déconnectée des sources
historiques qui se sentent le besoin de diaboliser les païens pour justifier le
christianisme. A les voir on croirait que les empereurs romains étaient tous
fous ce qui interroge forcément étant donné la longévité de cette civilisation.
Certes il y a eu quelques tyrans mais les romains n'en étaient pas fiers. Ils
étaient honnis dans leur mémoire. Les bons empereurs (en particulier Les
Antonins) ne sont pratiquement pas montrés au cinéma. Et Gibbon fait remarquer
que chez les champions de la chrétienté, il y a largement matière pour les
faire passer eux aussi pour d'horribles tyrans alors qu'ils passent pour les
grands hommes dans l'Histoire officielle.... (Constantin avait tellement de
meurtres sans sa propre famille et son entourage que Gibbon rappel "les
vers injurieux affichés à la porte du palais, où l’on comparait les deux règnes
fastueux et sanglants de Néron et de Constantin" (chap
XVIII). Pareil pour Clovis, Gibbon nous dit "Son règne
fut une violation continuelle des lois du christianisme et de l'humanité."
(chap XXXVIII). Et pour Théodose, on trouve "un acte de cruauté
qu’on attendait à peine d’un Néron ou d’un Domitien" (chap
XXVII). On dénonce la mégalomanie de Néron qui voulait renommer Rome Neropolis,
mais Constantin fait déplacer la capitale de l'empire et la renomme
Constantinople.
Pour l'historien antique Ammien Marcellin, trouve également la cruauté de
Constance (fils de Constantin) "surpassait celle des Caligula, Domiten,
Commode" (Livre XI). Idem pour Valentinien, et le pire Justinien qui
a fait tué des centaines de milliers si pas des millions (Histoire secrète de Justinien). Ce sont des tyrans
criminels.
Par
ses éléments, j'espère avoir réussi à corriger un peu l'image fausse de Rome
trop souvent véhiculée par le cinéma, les reportages et l'historiographie
pro-chrétienne, encore dominante sur cette question.
► voyez le film Agora (2010) de
Alejandro Amenábar avec Rachel Weisz, rare représentation du réel visage du
christianisme dans l'antiquité. Les autres péplums étant généralement de la propagande
chrétienne non-historique.
Les relations païens-chrétiens. Sur notre page Celse, voir l'avis
général des païens sur les chrétiens. conversion impossible.
Sociologie du christianisme antique. Le christianisme
trouve son terrain dans une population urbaine de bas niveau sociale (les banlieues de l'époque). C'est là que le ressentiment s'accumule et créé une population
réceptive à l'inversion des valeurs. Ce n'est ni l'aristocratie ni le gros
du peuple paysans qui vit dans les campagnes (80% de la populations sont
des paysans = des païens). Ce n'est donc pas un mouvement populaire de
masse, mais une secte militante qui veut convertir le pouvoir.
"la populace ou le, cæcum vulgus, pour me servir d'une
expression de Tertullien » , était l'ennemi le plus acharné des chrétiens"
"Le siége de l'influence chrétienne avait donc été transporté dans la
classe intermédiaire , qui placée à une égale distance de l'aristocratie et du
bas-peuple "Arthur Beugnot, Histoire le la destruction du paganisme
"Déjà [au IIe siècle] le christianisme
dévoile la politique qu’il suivra constamment à partir du IVe siècle, et qui
consistera surtout à traiter avec les souverains par-dessus la tête des
peuples. « Avec vous, nous voulons bien discuter ; mais la foule ne vaut pas
l’honneur qu’on lui donne des raisons." "Les fidèles ne s’envisagent
jamais comme des gens du peuple ; ils semblent former dans les villes une
petite bourgeoisie honnête, très-respectueuse pour l’autorité, très-disposée à
s’entendre avec elle. Se défendre devant le peuple paraît aux évêques une honte
; c’est avec les autorités seules qu’ils veulent argumenter." Renan
Ils n'ont pas de prise sur les empereurs
éclairés, mais ils vont parvenir à leur fin sur des esprits perméable à la superstition
qui seront fasciné par les miracles de Jésus. La force essentielle du
christianisme ce n'est pas la promesse de la vie éternelle (qui est déjà
proposée par plein d'autres dieux à l'époque) ni même sa morale, mais c'est son
militantisme acharné qui va lui permettre de l'emporter. Gibbon dit que la
cause n°1 du succès du christianisme c'est son "zèle inflexible" et
intolérant (chap XVI).
IIIe
siècle
la déstabilisation des valeurs gréco-romaine classiques
-
Les orientations philosophiques peu éclairées des nouveaux empereurs: Sous
Commode, la société et le sénat s'orientalise. Ceci favorise la
superstition qui va continuer de se développer sous la dynastie des Sévères
avec l'appui du pouvoir impérial. L'empereur Septime Sèvère "comme
presque tous les Africains, s’appliquait avec la plus grande ardeur aux vaines
études de la divination et de la magie" (Gibbon, chap
VI). Il introduit le philosophe sophiste Flavius Philostratus à
sa cour et sa femme, l'impératrice Julia Domna, lui commande une vie
d'Apollonios de Tyane (un néo-jésus-christ faiseur de miracles), genre de
personnage que Lucien de Samosate moquait comme des charlatans. La
nourrice et le précepteur de Caraccala étaient tous deux chrétiens (Gibbon, chap
XVI). La nièce de Julia Domna, Julia Mamaea, mère du futur empereur
Alexandre-Sévère, s'intéressait aussi vivement aux choses du christianisme et
pour ses dévotions, l'empereur Alexandre-Sèvère réunit les portraits de saints
personnages, parmi lesquels Apollonius de Tyane, le Christ, Abraham et
Orphée (Gibbon chap
XVI). (ce ne sont pas des chrétiens car ils sont polythéistes contrairement aux vrais chrétiens mais ils montrent une sympathie marquée pour le christianisme)
Une sympathie pour le christianisme continue ainsi de se diffuser sans obstacle
majeur après Marc-Aurèle (les quelques persécutions sont courtes et
d'ampleur limitées) et le christianisme bénéficie en fait le plus souvent
du soutien du pouvoir impérial.
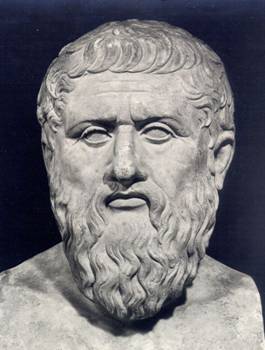 - le néoplatonisme. Gallien
fait venir le néoplatonicien Plotin à sa cour. L'appui impérial favorise
cette nouvelle orientation de la philosophie. "Les nouveaux platoniciens
s’épuisaient en disputes de mots sur la métaphysique. Occupés à découvrir les
secrets du monde invisible, ils s’appliquaient à concilier Platon avec Aristote
sur des matières aussi peu connues de ces philosophes que du reste des mortels
; et, tandis qu’ils consumaient leur raison dans des méditations profondes,
mais illusoires, leur esprit demeurait exposé à toutes les chimères de
l’imagination. Ils prétendaient posséder l’art de dégager l’âme de sa prison
corporelle ; ils se vantaient d’avoir un commerce familier avec les esprits et
avec les démons et, par une révolution bien étrange, l’étude de la philosophie
était devenue l’étude de la magie. Les anciens sages avaient méprisé la
superstition du peuple : après en avoir déguisé l’extravagance sous le voile
léger de l’allégorie, les disciples de Plotin et de Porphyre s’en montrèrent
les plus zélés défenseurs" "Fanatisme
des philosophes: On est surpris et scandalisé que les philosophes eux-mêmes
aient voulu abuser de la crédulité superstitieuse des hommes, et qu’ils aient
cherché à soutenir les mystères grecs par la magie ou théurgie des
platoniciens. Ils se vantaient audacieusement de pouvoir contempler l’ordre
mystérieux de la nature, pénétrer les secrets de l’avenir, commander aux démons
inférieurs, jouir de la vue et de la conversation des dieux supérieurs ; et, en
dégageant l’âme de ses liens matériels, réunir à l’esprit divin cette
immortelle particule de son être infini... [aboutissant à ce que Gibbon
dénonce comme une] alliance monstrueuse de la philosophie et de la
superstition" (Gibbon, chap
XIII. chap XXIII).
- le néoplatonisme. Gallien
fait venir le néoplatonicien Plotin à sa cour. L'appui impérial favorise
cette nouvelle orientation de la philosophie. "Les nouveaux platoniciens
s’épuisaient en disputes de mots sur la métaphysique. Occupés à découvrir les
secrets du monde invisible, ils s’appliquaient à concilier Platon avec Aristote
sur des matières aussi peu connues de ces philosophes que du reste des mortels
; et, tandis qu’ils consumaient leur raison dans des méditations profondes,
mais illusoires, leur esprit demeurait exposé à toutes les chimères de
l’imagination. Ils prétendaient posséder l’art de dégager l’âme de sa prison
corporelle ; ils se vantaient d’avoir un commerce familier avec les esprits et
avec les démons et, par une révolution bien étrange, l’étude de la philosophie
était devenue l’étude de la magie. Les anciens sages avaient méprisé la
superstition du peuple : après en avoir déguisé l’extravagance sous le voile
léger de l’allégorie, les disciples de Plotin et de Porphyre s’en montrèrent
les plus zélés défenseurs" "Fanatisme
des philosophes: On est surpris et scandalisé que les philosophes eux-mêmes
aient voulu abuser de la crédulité superstitieuse des hommes, et qu’ils aient
cherché à soutenir les mystères grecs par la magie ou théurgie des
platoniciens. Ils se vantaient audacieusement de pouvoir contempler l’ordre
mystérieux de la nature, pénétrer les secrets de l’avenir, commander aux démons
inférieurs, jouir de la vue et de la conversation des dieux supérieurs ; et, en
dégageant l’âme de ses liens matériels, réunir à l’esprit divin cette
immortelle particule de son être infini... [aboutissant à ce que Gibbon
dénonce comme une] alliance monstrueuse de la philosophie et de la
superstition" (Gibbon, chap
XIII. chap XXIII).
- Perte
du caractère romain. Le christianisme est également
favorisé par l'ouverture trop rapide de la citoyenneté romaine à des
peuples peu éclairés qui fragilisent la culture gréco-romaine (exemple:
édit de Caracalla Sévère en 212) et qui, comme les barbares se
convertissent facilement au christianisme. Au milieu du IIIe
siècle, « les 35 tribus (originelles) du peuple romain
composées de guerriers, de magistrats et de législateurs avait disparu dans la
masse commune du genre humain: elles étaient confondues avec des millions
d'esclaves habitants des provinces, et qui avait reçus le nom de Romains, sans
adopter le génie de cette nation si célèbre. La liberté n'était plus le partage
que de ces troupes mercenaires levées parmi les sujets et les barbares des
frontières qui souvent abusaient de leur indépendance. Leurs choix tumultuaires
avaient élevés sur le trône de Rome un Syrien, un Goth, un Arabe et les avaient
investi du pouvoir de gouverner despotiquement les conquêtes de la patrie des
Scipions » (Gibbon, chap
VII).
Note apolitique: On peut analyser ce fait
avec un point de vue de droite et y voir un effet néfaste de l'immigration et
du multiculturalisme. On peut aussi l'analyser avec un point de vue de gauche
et y voir un défaut d'éducation, que Marc-Aurèle avait déjà décelé ce pourquoi
il avait pensionné les philosophes pour instruire le peuple. (Il
faut aussi citer les contre-exemples des syriens Philodème de Gadara et de
Lucien ardant défenseur de l'épicurisme. Ce qui a donc été dit des orientaux
même s'il est globalement vrai à l'échelle du groupe ne vaut évidemment pas à
l'échelle des individus). Rome devait durer pour l'éternité. Elle a disparu en 2
siècles et demi. Gibbon explique qu'il écrit pour que les politiques
connaissent les erreurs du passé afin d'éviter que la catastrophe ne se répète.
La leçon c'est que la civilisation est une source d'antisélection naturelle. La
protection et l'assistance apportée par l'état permet à des groupes humains
arriérés de prospérer alors qu'ils auraient été éliminés à l'état naturel et
quand les plus bêtes, les plus superstitieux, les moins éclairés se mettent à
dominer démographiquement et idéologiquement al société, et bien il provoque le
déclin de la civilisation et engendre leur propre destruction. Tant que
l'exigence et la méritocratie république dominant à Rome a pu maintenir des
élites de qualité, y compris d'origine étrangère. Le jour ou Caracalla a donné
la citoyenneté romaine à tout le monde, Rome allait vers d'immenses problèmes.
Ce problème de
barbarisation de la culture s'aggrave dramatiquement au IVeme siècle après les
réformes militaires désastreuses de Constantin (Michel de Jaeghere. Les derniers jours, la fin de l'empire
romain d'Occident)
Voir les études génétiques: Posth
et al., Sci. Adv. 2021; 7 : eabi7673. The origin and
legacy ofthe Etruscans through a 2000-year archeogenomic time transect.
- La
terrible crise du IIIe siècle. épidémies + mauvaise
gouvernance depuis le tyran Commode + perte de contrôle de l'armée
+ hausse de la fiscalité qui asphyxie l'économie -> crise
économique (effondrrement monéaire) + famines + baisse de la natalité + défaites militaires +
invasions barbares (des Goths déjà eux ! Les frontières du limes dégarnie en
Germanie pour combattre les perses à l'est). Ceci conduit l'empire à une très
grave crise qui atteint son apogée avec la faiblesse de l'empereur Gallien,
occupé à converser avec le néoplatonicien Plotin dans son palais et qui laisse
l'empire non-défendu se disloquer, envahi de toute part par les
barbares. L'empereur Gallien donne une reconnaissance publique au
christianisme. "L'avènement de Gallien, en augmentant
les calamités de l'empire, rendit la paix à l'Église" Gibbon, chap
XVI. (On ne dit pas pour le moment que le christianisme est la cause
directe de tous ces problèmes, mais juste que les mauvais empereurs laisse
la superstition proliférer et dégrader la culture classique).
Après l'apocalypse entre 235 et 268 où famines + épidémies + barbares
conduisirent à la mort de près de la moitié de la population, les empereurs
Illyriens Claude II, Aurélien et Probus réagissent et font cesser rapidement le
désordre. Les barbares qui mettaient presque tout l'empire à feu et à sang en
toute impunité et sans réaction depuis des décennies ne comprennent pas de qui
se passe. Avec les empereurs illyriens la machine romaine se remet tout à
coup en marche et ils écrasent les barbares étonnés qui s'enfuient en
détresse se cacher dans les montagnes. Ces évènements du milieu du IIIe siècle
montrent que la puissance romaine certes diminuée était toujours là,
mais qu'elle était complètement paralysée par une crise de gouvernance. Ce
prémice aide à comprendre la crise terminale qui aura lieu 150 ans plus tard. (Les
invasions du IIIe siècle mentionnent « trois cent vingt mille goths » donc
comparable à celle du Ve siècle où le problème sera également politique, disons
politico-religieux).
- Les
empereurs illyriens redressent l'état, doublent les effectifs
militaires pour rétablir la sécurité et sauvent l'empire. Ils font aussi cesser
la tolérance contre le christianisme et l'Empereur Dioclétien (fils d'esclave)
va même tenter de le détruire complètement déclenchant la pire persécution que
le christianisme ait jamais connue. Il fait brûler les églises, les livres
sacrés, arrêter les prêtres, et torturer tous ceux qui ne sacrifient pas à
l'Empereur.... Mais on ne détruit pas facilement une idée même avec la
violence. On détruit une idée par une idée contraire et plus forte. Or, la
belle philosophie n'est plus là. Le climat défavorable de la crise et des épidémies
a encore accrue la superstition dans le peuple et dans les élites. On assiste à
un effondrement de la pensée éclairée, ce qui ouvre la voie à la croyance aux
miracles de Jésus qui paraissaient auparavant bien ridicules (voir Celse).
- La
Destruction de la Philosophie Classique. A
la fin du IIIe siècle, les païens sont devenus beaucoup plus
superstitieux et ils renient les philosophes classiques de la Grèce qui ont
pourtant façonné leur culture depuis 700 ans. "Les
bosquets de l’académie, les jardins d’Épicure, et même le portique des
stoïciens furent presque abandonnés, comme autant d’écoles différentes de
scepticisme ou d’impiété ; et plusieurs parmi les Romains désirèrent que les
écrits de Cicéron fussent condamnés et supprimés par l’autorité du sénat. La secte
dominante des nouveaux platoniciens crut devoir s’unir avec les prêtres" (Gibbon, Chap
XVI). Ainsi, l'élite romaine jadis éclairée
par l'épicurisme et le stoïcisme a disparu et la philosophie
est désormais réduite au mieux à Aristote, en général à du néoplatonisme qui prépare le terrain pour le christianisme. Les conditions
sont désormais réunies pour une transformation de plus grande ampleur
c'est-à-dire à un changement de religion et donc de civilisation.
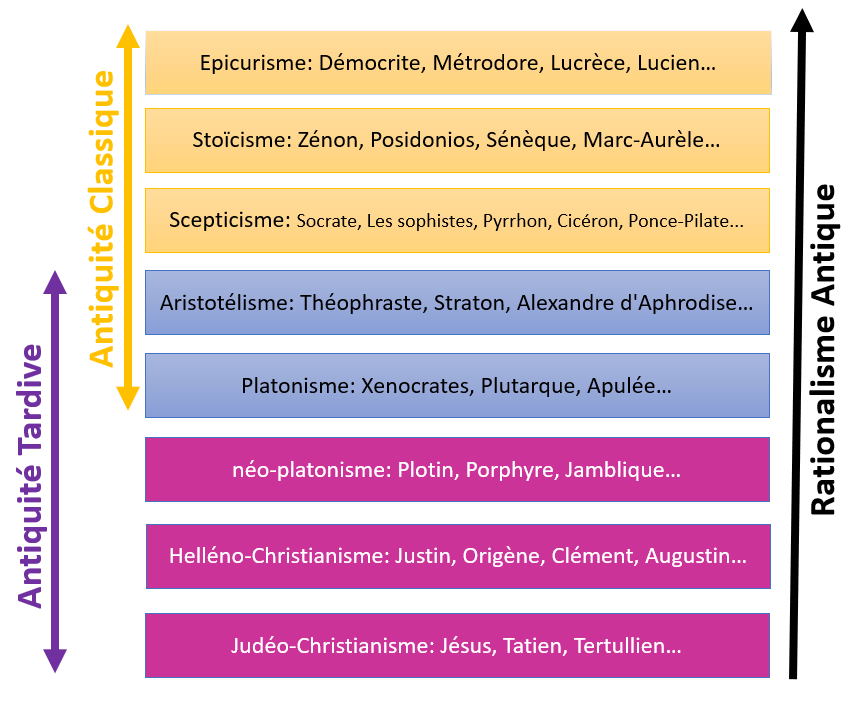
- la
mutation culturelle. « N'est-ce pas précisément l'un
des traits les plus caractéristiques du 3e siècle que la foi aveugle et
l'entraînement irraisonnée des meilleurs esprits aux devins de toutes sortes et
de toutes origines, aux thaumaturges et aux prophétiseurs? […]
[Sous Dioclétien], l'expansion radical des rangs
supérieurs de la société se doubla d'une évolution aussi radicale dans
l'histoire de la pensée. C'est la thèse de ce chapitre. L'arrivée massive de
nouveaux titulaires de charge ecclésiastique et laïque dans l'élite remodela
cette dernière à leur image [...] Les mentalités repérables dans les
limites de l'Empire à l'époque de Pline (Ier siècle) furent submergées par
d'autres mentalités très différentes, plus populaire. Le spectre
des croyances fut amputé de son extrémité sceptique et empirique. Il ne restait
plus que le milieu et l'extrémité la plus crédule. […] J'aurais
donc tendance à compter non pas sur de nouvelles idées qui se seraient
introduite dans la tête des individus mais sur des individus nouveaux avec
leurs vieilles idées qui arrivent à des positions d'où on pouvait mieux les
entendre - en bref une explication démographique du changement culturel. [...]
L'événement historique central que l'on repère est la disparition
du rationalisme. […] Le moyen-âge survient appelé ainsi parce qu'il
se situe entre ce que les hommes des Lumières sentaient être leur propre époque
éclairée et l'époque éclairée de l'Antiquité. […] Alors que Cicéron avait
pu affirmer que les événements se produisaient soit parce qu'ils étaient
voulus, soit par le destin, le hasard ou des causes naturelles, Augustin
reculera d'un pas et prétendra que tous les événements en définitif dépendent
de la volonté de Dieu. À quoi bon s'ennuyer avec les livres et la
philosophie?"
Ramsay
Macmullen. Christianisme et paganisme. Chapitre 3.
note:
idées similaires défendues par Rostovtzeff et Arnaldo Momigliano.
IVe
siècle
le basculement: la guerre civile païen-chrétien
- La conversion de Constantin.
En 313, le général Constantin devient Empereur. Un édit de tolérance du
christianisme est promulgué. Constantin s'entoure de chrétiens et commence à
soutenir discrètement le christianisme en mêlant des symboles chrétiens à
d'autres cultes. C'est généralement mal vu par l'élite mais tout cela n'est pas
totalement nouveau. On a vu que les Sévères, Phillipe l'arabe, et Gallien
avaient déjà fait des gestes de soutien ou de sympathie envers le christianisme
au siècle dernier.
La mère de Constantin
était chrétienne donc l'hypothèse la plus probable c'est que Constantin était
un chrétien dissimulé qui avait secrètement adopté la religion de sa mère dans
sa jeunesse même s'il il n'était pas baptisé. Ensuite, il a avancé son christianisme
très prudemment au début puis a éliminé un à un tous ses rivaux pour obtenir un
pouvoir incontesté dans l'armée et dans l'état pour pouvoir enfin se
permettre de promouvoir plus ouvertement le christianismes. (D'après Eusebe
Césarée, l'affrontement avec son rival Licinius aurait eu des motifs
religieux.) Après l'élimination, de son grand rival Licinius en 325 Constantin
se déclare alors ouvertement chrétien. A Rome c'est alors la
consternation
"A Rome, dans cette citadelle du paganisme, dont
Constantin n'avait pas toujours ménagé soigneusement les préjugés, il était
devenu odieux depuis son changement de religion. Quand il vint dans ses murs en
326, il fut reçu avec des malédictions (Blaconuías), quitta promptement cette
ville et n'y reparut plus. Libanius dit seulement que les Romains employèrent
contre lui l'arme du ridicule ; peu importe que ce soient injures ou
sarcasmes" Arthur Beugnot, Histoire le la destruction du paganisme
Constantin fonde une nouvelle capitale :
Constantinople. L’Empereur se méfie de la possible résistance des aristocrates païens
et préfère recruter des mercenaires barbares dans l'armée (ce qui aggrave la
barbarisation et va créer des tensions ethnico-culturelles dans l'empire).
Il confie à des chrétiens les postes clefs de l'administration qui commencent
à persécuter le paganisme (destruction et pillage de temples païen pour
financer sa politique de christianisation) mais Constantin est rapidement
débordé par les fanatiques qui s'affrontent sur la vraie nature du christ. Au
début il leur répond qu'on ne peut juste pas savoir si il découle du père
ou s'il est de même nature, mais comme la querelle prend des proportions incontrôlables,
afin de faire cesser les troubles il fixe le dogme chrétien et créé l'église
catholique au concile de Nicée. En fait il vient d'ouvrir la boite de pandore,
car les querelles entre sectes chrétiennes vont agiter tout le siècle et
affaiblir l'empire. Entre les ariens, nicéen, donatises et autres ce sera des
massacres dignes de la Saint-Barthélemy entre les différents branches du christianisme.
Constantin dénonce "les temples du mensonge" "les coutumes des temples et la puissance des ténèbres"
La Vie de Constantin écrite par l’évêque Eusèbe de Césarée met en scène
une répression généralisée du paganisme. Rappelons que l’auteur,
conseiller de l’empereur depuis l’époque du concile de Nicée en 325,
rédigea ce texte entre la mort de Constantin en 337 et son propre décès
en 339/340. [..] on peut penser que la cour de Constance II et l’Église
propageaient de conserve l’idée que tous les sacrifices avaient été
interdits par Constantin.
Vincent Puech
- Transformations économique: de
l'evergétisme à la charité / vers le moyen-âge.
Les historien parlent d'évergétisme pour
décrire la générosité pratiquée par les notables consistant à financer des
édifices d'utilité publique, des banquets, des spectacles gratuits, , etc. On a
des mécènes qui font des dons astronomiques à la communauté et sont honorés
pour leur bienfaits.
Ce système et tellement
efficace que Renan écrit "Dans la
haute antiquité, on peut dire que le monde n'avait pas besoin de charité".
Cela paraitra étonnant, mais contrairement
à l'idée qui traine dans l'imaginaire chrétien, le succès initial du
christianisme n'est pas dû à une absence de charité dans le mon païen et le
paradoxe c'est que le christianismes va en fait détruire ce système pour des raisons
théologiques. En effet, la mentalité chrétienne du mépris des honneurs et des richesses
vient bouleverser ce système.
"Fais l'aumône [en secret afin d'éviter] d'être
glorifiés par les hommes" Mathieu 6:2 "Ce n'est point par les
oeuvres, afin que personne ne se glorifie" Éphésiens 2:9. Rejet
chrétien de ceux qui se prennent pour des dieux sur la terre ce qui est au
contraire le but ouvertement avoué des épicuriens et des stoïciens. La morale
chrétienne sera combattu par Spinoza, qui est un restaurateur la morale
païenne, lorsqu'il écrivait à ce sujet: "Rien n'excite plus à la
vertu[faire le bien] que l'espoir permis à tous d'atteindre aux plus grands
honneurs, car tous nous sommes mus principalement par l'amour de la gloire
ainsi que je l'ai montré dans mon Éthique" Spinoza, Traité Politique, VII,
6.
l'interdiction de la glorification des
honneurs est incompatible avec l'évergétisme.
C'est une doctrine essentiellement catholique / aujourd'hui partiellement
corrigé par le protestantisme et qui explique la sous performance économiques
des pays catholiques. (inversion de la domination Europe du sud/ Europe du nord
après la réforme protestante). l'éthique du capitalisme. Max Weber. Là il se
produit l'inverse.
Dans le protestantisme, la théorie de la grâce dit
que dieu a déjà choisi qui il va sauver, et qu'il accorde à ses élus le droit
de jour d'un avant-gout du paradis sur Terre. Donc pour des raisons
théologiques les élus c'est à dire les riches sont admirés car ils sont vu
comme ceux que dieu va sauver. Retour de la philanthropie dans la culture protestante
mais des proportions bien moindre que ce qui existait ans l'antiquité).
Tout cela est contraire à l'enseignement de Jésus qui
enseigne la Haine du riche (qui ne rentrera pas au paradis) et qui invite à
être pauvre. Les esséniens et les premiers chrétiens étaient des communistes
qui vivaient comme dans les monastères.
En l'absence de prestige social les grands
donateurs cessent progressivement leur activité de mécène. Effet complètement
pervers du christianisme. La morale de haine des riches est complètement
contre-productive pour la charité publique en fait. Les grands notables
païens vont de plus en plus garder leur fortune pour eux-mêmes et se construire
des villas immenses avec les dons qu'ils faisaient auparavant à la
communauté. On assiste à la fin de l'évergétisme au IVe siècle
(écoutez Dumezil) apparition de grande villas dotées d'un luxe inutile et mondain pour
l'aristocratie seulement.
L'autre raison de la fin de l'évergétisme c'est le changement de la forme de gouvernement (du Principat au Dominat). "Tant que les consuls romains furent les premiers magistrats d’un pays libre, ils durent au choix du peuple leur autorité légitime ; et tant que les empereurs consentirent à déguiser leur despotisme, les consuls continuèrent d’être élus par les suffrages réels ou apparents du sénat. Depuis le règne de Dioclétien, ces vestiges de liberté se trouvèrent effacés ; et les heureux candidats qui recevaient les honneurs annuels du consulat, affectaient de déplorer la condition humiliante de leurs prédécesseurs. Les Scipion et les Caton avaient été obligés de solliciter les suffrages des plébéiens, de s’assujettir aux formes dispendieuses d’une élection populaire, et de s’exposer à la honte d’un refus public." Gibbon, XVII
L'autoritarisme gouvernemental qui a été nécessaire pour mettre fin à la crise du IIIe siècle, a
républicanisme, à la compétition des notables pour les élections qui donnent
accès aux carrières qui étaient une motivation très forte de l'évergétisme.
Désormais les nominations se font sur le nom de famille et directement par l'administration impériale et
plus à travers les élections populaires. Tendance marquée (pas encore
systématique) à privilégier les chrétiens dans l'administration. La
secte chrétienne
devient l'état profond et se renforce et se prépare à faire son coup
d'état théocratique.
Les évêques remplacent l'ancienne aristocratie romaine
pour la charité publique, mais l'argent part surtout pour les églises
et les monastères et plus autant pour le bien public C'est moins efficace que
l'évergétisme et la pauvreté augmente. Enfin les riches qui commencent eux
aussi à se convertir font désormais des dons à l’église qui sont autant d'impôt
qui échappent à l’état. Le mouvement est très important puisque l'Empereur
chrétien Valentinien limite les dons des vierges et veuves aux évêques qui sont
en train d'aspirer les ressources de l'Etat. "Le métier
lucratif et honteux que les ecclésiastiques exerçaient pour dépouiller les
héritiers naturels, enflamma l’indignation, même d’un siècle
superstitieux." Gibbon, XXV. L'église
bénéficie d'avantages fiscaux énormes qui appauvrissent l'état. Le consul païen
Caïus Prétextatus disait ironiquement : « Donnez-moi la place d’évêque de Rome,
et je me fais chrétien. »
- Vers
le servage. Pour compenser l'absence des dons des grands notables, il
y a augmentation des impôts pour le peuple et durcissement des conditions pour les esclaves. Les petits
propriétaires sont surtaxés, et forcés de vendre leur terre. En 332 sous
Constantin, une loi, conservée au Code théodosien, entérine l'attachement des
colons à la terre, en donnant au maître le droit de poursuivre le
fuyard. Le progrès social est inversé. Avant on transformait progressivement
des esclaves en hommes libres, maintenant, on transforme désormais des hommes
libres en esclaves. Les emplois deviennent héréditaires. Les charges qui
étaient électives deviennent aussi héréditaires. Système de caste qui bloque la méritocratie républicaine.
Les juristes qui ont produit ces lois avaient peu de considérations de
l'individu, de sa créativité et de son esprit d'initiative. C'est la fin du
libéralisme. La société se sclérose et donc la sous-performance économique
est alimentée par ces transformations favorisées par la mentalité apportée par
le christianisme. Gibbon parle d'une politique « qui
abaisse tout ce qui est élevé, qui craint toutes les facultés actives, et
n’attend d’obéissance que de la faiblesse » (le christianisme
appliqué).
"Toute initiative et toute liberté étaient ôtées aux individus et l'Etat les écrasait de son poids." "[Pour
l'empereur chrétien Valentinien] l'empire n'est qu'une immense prison."
"Le triomphe du christianisme coïncide avec un effrayant progrès de la misère
et de la mendicité." p445 "le luxe inouï des puissants s'oppose
brutalement à la misère des pauvres [augmentation de l'injustice]" On assiste à la
"concentration de la propriété entre les mains des puissants"
"l'injustice et l'inégalité ne furent-elles jamais plus graves" p 333
"il semble enfin que les peines soient devenues plus atroces. La législation
criminelle du IVe siècle laisse une impression d'horreur ; beaucoup de lois
semblent dictées par des furieux. Spectacle inattendu au siècle des empereurs
chrétiens" p 454
(Châtiments barbares sous les empereurs chrétiens conformes aux
enseignements de Jésus-Christ qui invite à
mutiler les corps. Ces châtiments cruels de même que la torture des
citoyens avaient disparu grâce à Rome. Désormais, même dans les
monastères, "les abbés se permettaient de mutiler leurs moines
et de leur arracher les yeux" Gibbon)
"Le moyen-âge commence avec Constantin. [Constantin]
ouvrait toutes grandes les portes de l'Empire aux forces ennemies de la
romanité: le christianisme et les barbares, il déclarait terminer la
mission
historique de Rome dans le monde et rendait le naufrage inévitable."
"Si on le juge du point de vue de Rome son compte est lourd. Il a
renforcé sur les grands domaines l'institution naissance du servage, il
a brûlé
les livres des philosophes, il a appelé des généraux germains au plus
grand
honneur de l'État. De vue du Moyen-Âge il faut reconnaître qu'il nous
donne la
première image du souverain médiéval qui vit les yeux levés au ciel. Il
reste
qu'il a trahi Rome."
André Piganiol, l'empire chrétien
- Restauration païenne. Après l'échec de la révolte païenne de Magnence, la Gaulle est déjà en train de s'effondrer . Attaques de germains mais Julien le neveu de Constantin envoyé en mission
rétablit la situation. Bien qu'issu d'une famille chrétienne, Gibbon
raconte que "La vénérable antiquité de la Grèce aspirait à Julien une
tendresse respectueuse qui éclatait en transports, au souvenir des dieux, des
héros et des hommes supérieur aux héros et au dieux qui avaient légué à la
dernière postérité les monuments de leur génie ou l'exemple de leurs vertus" (Gibbon, chap
XXII). Sous
le commandement de Julien, l'armée romaine
redevient la machine de guerre implacable face aux barbares qui avait
jadis permis
à Rome de conquérir un territoire si vaste avec une armée réduite. A la
bataille
de Strasbourg (Argentoratum) en 357 (50 ans avant les grandes
invasions, on voit que les progrès ne sont pas fulgurants chez les barbares), on
compte seulement 243 soldats et 4 tribuns militaires romains tués.
Alors que du
côté alaman, d’après Ammianus Marcellinus, 6000 guerriers tués + de
nombreux
noyés dans le Rhin en s'enfuyant. "Les victoires de
Julien suspendirent un peu les invasions des Barbares, et retardèrent la chute
de l’empire d’Occident." Gibbon, Chap
XIX (qui se serait sinon produite plus tôt).
. Attaques de germains mais Julien le neveu de Constantin envoyé en mission
rétablit la situation. Bien qu'issu d'une famille chrétienne, Gibbon
raconte que "La vénérable antiquité de la Grèce aspirait à Julien une
tendresse respectueuse qui éclatait en transports, au souvenir des dieux, des
héros et des hommes supérieur aux héros et au dieux qui avaient légué à la
dernière postérité les monuments de leur génie ou l'exemple de leurs vertus" (Gibbon, chap
XXII). Sous
le commandement de Julien, l'armée romaine
redevient la machine de guerre implacable face aux barbares qui avait
jadis permis
à Rome de conquérir un territoire si vaste avec une armée réduite. A la
bataille
de Strasbourg (Argentoratum) en 357 (50 ans avant les grandes
invasions, on voit que les progrès ne sont pas fulgurants chez les barbares), on
compte seulement 243 soldats et 4 tribuns militaires romains tués.
Alors que du
côté alaman, d’après Ammianus Marcellinus, 6000 guerriers tués + de
nombreux
noyés dans le Rhin en s'enfuyant. "Les victoires de
Julien suspendirent un peu les invasions des Barbares, et retardèrent la chute
de l’empire d’Occident." Gibbon, Chap
XIX (qui se serait sinon produite plus tôt).
Face à son succès militaire, il est proclamé Empereur par les troupes. Trahison
de l'empereur chrétien: appel à l’aide des barbares qu’il a christianisé. "[Julien]
avait découvert par des lettres interceptées de son rival sacrifiant l’intérêt
de l’Etat à celui du monarque excitait les Barbares à envahir les provinces de
l’Occident." "Soumettre au jugement du public le choix de deux
princes, dont l’un chassait les barbares tandis que l’autre les appelait"
Gibbon.
Finalement,
l'empereur chrétien décède de cause naturelle et Julien devient le seul
empereur. Il annonce alors ouvertement qu'il a renié la religion chrétienne dans
laquelle il était né. Il déclare
que le christianisme "n’est qu’une fourberie
purement humaine, et malicieusement inventée, qui, n’ayant rien de divin, est
pourtant venue à bout de séduire les esprits faibles, et d’abuser de
l’affection que les hommes ont pour les fables, en donnant une couleur de
vérité et de persuasion à des fictions prodigieuses" (Contre
les galiléens).
Il accuse les chrétiens d'avoir persécuté les païens et chrétiens
hérétiques: « L’odieux misérable (Anathase) ! sous mon règne le baptème de
plusieurs femmes grecque de rang le plus élevé a été l’effet de ses
persécutions » Gibbon "Vous [les chrétiens] avez égorgé non seulement ceux
d'entre nous qui restons fidèles aux valeurs ancestrales, mais parmi les
hérétiques égarés tout autant que vous, ceux qui ne se lamentent pas sur le
cadavre [Jésus] de la même façon que vous" Fr48 = Cyrille 206a
A Alexandrie émeute de libération païenne contre la tyrannie des dirigeants chrétiens, Georges de
Cappadoce et le général Artème qui sont exécutés.
Alors, que c'est-il passé ? Julien meurt
en 363 dans une bataille contre les Perses, mais Julien aurait été assassiné par un
soldat romain touché par une flèche romaine. Cela semble être l'opinion
des Perses qui ne revendiquent étrangement pas d'avoir atteint l'empereur (XXV,6,6). Plusieurs
païens dénoncent l'assassinat de l'Empereur Julien par un romain chrétien et s'indignent que le
coupable n'ait pas été puni (Libanios et l'orateur Fabricius) tandis
que plusieurs chrétiens revendiquent l'assassinat (Zosomène et Grégoire de Nazianze.
Voir fresques dans les églises). Alors, accident dans la confusion de la
bataille ou meurtre opportuniste d'un soldat chrétien au milieu de la cohue ?
La situation n'était peut-être pas très claire même pour les contemporains, en
tout cas la polémique est révélatrice du climat de tensions religieuses extrêmes qui règnent à cette époque.
Sur son lit de mort, Julien rendit l'âme
en véritable païen "la nature me redemande ce qu'elle
m'a prêté ; je lui rends avec la joie d'un débiteur qui s'acquitte et non point
avec la douleur ou les remords que la plupart des hommes croient inséparables
de l'état où je suis" (Gibbon, chap
XXIV).
- Un
manque de chance pour la romanité païenne? D'une manière générale,
depuis Marc-Aurèle les empereurs favorables au christianisme ont globalement
affaiblit l'empire (Commode, les Sèvères, Phillipe, Gallien,
Valens...), au contraire, les défenseurs de la romanité ont combattu cette
religion (opinion de Gibbon et Renan IV), mais après Marc-Aurèle leur règne fut le plus souvent
très courts. La mort tragique, accidentelle et prématurée de Pertinax en 193,
Gordien en 238, Dèce en 251, Claude II en 270, Aurélien en 275, Probus en 282
et enfin Julien en 363, (puis Eugène/Arbogaste en 394 et on peut même inclure
même Majorien en 461) sont une explication supplémentaire à la disparition de
cette civilisation qui a vraiment manqué de chance car aucune des diverses
tentatives ultérieures de restauration de la romanité n'a jamais eu le temps
d'aboutir. Au contraire Constantin et ses fils ont durés 54 ans au total,
le temps donc de remodeler l'administration pendant pratiquement deux
générations, et de placer ainsi le germe d'une christianisation durable. Si Bassianus avait réussi à assassiner
Constantin ou si Julien avait duré aussi longtemps que Constantin, le monde
serait différent. L'histoire se joue à peu de chose. Aucun empereur païen légitime n'aura duré suffisamment
longtemps pour défaire cette transformation.
Selon ses contemporains, s'il avait vécu plus longtemps, Julien serait vraisemblablement parvenu à "éteindre la religion de Jésus-Christ" (Gibbon, chap XXIII). Le païen Procope que Julien avait secrètement prévu pour lui succéder manque de soutien et échoue à s'imposer en 365. "En négligeant d'assurer par le choix prudent et judicieux d'un collègue et d'un successeur, l'exécution future de ses projets (la restauration du paganisme) Julien fut en quelque sorte la cause du triomphe du christianisme et des calamités de l'Empire" (Gibbon, chap XXIV). On va assister à "la victoire de la barbarie et de la religion".
- Comment
les chrétiens reprennent le pouvoir. Le préfet
païen Secundus Salutius est
proposé par l'armée pour lui succéder, mais celui-ci refuse s'estimant trop vieux et c'est finalement
un général chrétien (Jovien) qui lui succède accidentellement:
" les soldats placés en avant des enseignes, entendant saluer Jovien
Auguste, répétèrent le cri de toutes leurs forces, parce que, trompés par la
ressemblance des noms, qui ne diffèrent que d’une lettre, ils crurent que
Julien leur était rendu, et que c’était lui qu’on accueillait avec
l’enthousiasme ordinaire. En voyant s’avancer la longue figure voûtée de
Jovien, on comprit la triste vérité, et ce fut une explosion de larmes et de
sanglots. [suivi de défections dans l'armée]".
Ammien Marcelin, XXV, 5, 6
"Ce n'est donc pas la puissance du christianisme, mais bien
les scrupules d'un vieillard qui empêchèrent l'ancien culte de se maintenir
dans la position où Julien l'avait placé."
Arthur Beugnot, Histoire le la destruction du paganisme
Opportunisme religieux pour faire carrière.
(Julien est cependant un néoplatonicien
superstitieux, anti-Epicure, ce qui reste de plus éclairé comme philosophe à
cette époque et ne propose pas un paganisme satisfaisant. Lucrèce dénonçait les
sacrifices d'animaux). Lui les pratiquait au point de choqué ses contemporains
païens. Critiqué pour son zèle religieux qui ne lui permet pas de fédérer tous
les païens. La plupart s'en foute de la religion. Un stoïcien éclairé aurait pu
beaucoup mieux fédérer l'ensemble du monde romain qu'un néoplatocien qui
finalement a les mêmes dogmes que les chrétiens.
Peu de chrétiens convaincus - une poignée de militants très
déterminés introduits par cooptation à la cour de l'empereur. La société n'est
pas chrétienne et cela démontre à quel point les lois de Théodose qui vont imposer
la christianisation forcée sont illégitimes. C'est vraiment le coup d'état
d'une secte.
On a d'autres exemples historiques d'une minorité de
militants qui prend le pouvoir. Les communistes étaient minoritaires en
Russie ne 1917 et pourtant ils ont pris le pouvoir total. Une base de militants
déterminés peut l'emporter sur une masse passive.
"Plus
on pénètre dans la connaissance des usages de ce siècle, plus on est autorisé à
penser qu'il existait peu de véritables chrétiens parmi les nobles."
"Reconnaître que durant le quatrième siècle la foi véritable ne dominait
plus dans les rangs des deux religions, c'est sans doute faire un aveu pénible;
mais tout ce qui reste à dire ne le justifiera que trop."
Arthur Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme
"Écebole, qui se conformait avec une merveilleuse facilité aux divers
changements de fortune du christianisme. Du vivant de Constance, il affecta la
plus vive ardeur pour les croyances nouvelles : Julien étant monté sur le trône,
il reprit son ancien dévouement pour les dieux ; mais après la mort de ce
prince, il pensa qu'il était bon de donner une grande publicité à son
repentir"
Arthur Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme
"Hekebolius que Constance désigna pour lui enseigner la rhétorique et
qui oscillait, selon le vent du jour, du paganisme au christianisme, –
païen d 'abord , puis chrétien, puis redevenu païen en 361 et chrétien
de nouveau en 363 ;" "les Nazaréens, épouvantés en secret de la
promptitude avec laquelle la moitié des leurs au moins a été ramenée à
l'ancien culte par la douceur du jeune prince Julien , et surtout par
le désir des honneurs dont le taurobole est le seul chemin"
Pierre de Labriolle, la réaction païenne.
Idem pour l"empereurl'Eugène.
Manque de militantisme païen: "Cette
délégation des choses saintes était autrefois « sans inconvénients ' ;
maintenant s'éloigner des autels « est un moyen de faire sa cour »"
Symmaque cité par Beugnot
- Persécutions des intellectuels païens sous
Valens/Valentinien.
On ne persécute pas directement la croyance païenne mais la
pratique (la divination, astrologie) mais c'est une persécution du paganisme
quand même. ex Le célèbre devin Amantius (Ammien Marcellin XXVIII)
"un
certain Festus (proconsul chrétien), esprit sanguinaire et digne d'un boucher
[...] dès qu'il fut arrivé, exécuta la besogne qu'on lui commandait et y ajouta
même du sien, lâchant la bride à ses instincts de bête fauve et à la rage de
son âme. [...] Après avoir égorgé un nombre considérable de coupables et
d'innocents, il couronna tant de meurtres par celui du grand Maxime.
[...] (il rentre dans un temple) bien qu'il n'eût guère l'habitude
d'honorer les Dieux, puisque c'était pour les punir de leur piété
(païenne) qu'il avait mis à mort toutes ses victimes."
Eunape, vie
de philosophes et de sophistes, Maxime
"Presque tous
les philosophes païens furent exterminés vers l'époque dont nous venons de
parler" (Valens / Valentinien 364-375)
Sozomène, VI, 35
Alors
est-ce une persécution du paganisme ? Piganiol clôt le débat: "S'il
[Valentinien] n'a pas persécuté le paganisme, il a massacré, ce qui est pire,
l'élite païenne" "[haine chrétienne] des
hommes cultivés, des bien vétus, haine des riches. Valentinien soumet à la
torture les plus haut personnages des milieux politiques et intellectuels. Il
mène une lutte contre toute forme supérieure de culture. Il a décimée et
terrorisée [les classes supérieures de culture hellénique]. "
André
Piganiol, l'Empire Chrétien p218-220
"On
ne peut nier cependant que cette longue terreur n'ait porté à l'ancien culte un
coup fatal"
Arthur Beugnot, Histoire le la destruction du paganisme
Tout
cela reste malgré tout insuffisant pour les chrétiens militants qui veulent
l’interdiction complète du paganisme. "La conduite prudente et
réservée des empereurs commençait à lasser les chrétiens ; ils s'étonnaient que
la conversion des chefs de l'empire n'eût apporté aucun préjudice direct à
l'ancien culte ; de là des murmures, des plaintes et des excitations à la
violence." "En regardant ces édifices éclatants de dorures (au rata
templa), beaucoup de chrétiens répétaient sans doute ce mot de Georges évêque
d'Alexandrie : « Jusques à quand laisserons-nous subsister ces sépulcres ? »
Bientôt leur zèle ne sera plus contenu." "Fatigués de la lenteur des
princes, ils mettaient eux -mêmes la main à l'oeuvre"
Arthur Beugnot, Histoire le la destruction du paganisme
- Nouvelle Politique d'immigration menée par les empereurs chrétiens.
"Il n'y a là ni
Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni
homme libre ; mais le Christ est tout et en tous." Paul. le communisme in
différentialiste des chrétiens avec les barabres est dénoncé comme une folie
par Celse. "étant donné la diversité des populations et de leur coutumes.
Qui se met pareil dessein en tête témoignage par cela même qu'il est
aveugle." Idem Empereur Julien selon qui les nations ont « un substrat de
nature différente » dénoncé par Cyrille d'Alexandrie. Les romains ont une
conception universaliste de la Raison qui s'article avec une identité des
peuples. L'universalisme chrétien nie les identités nationale et veut tout
fondre dans une oumma/communauté des croyants.
Le but du christianisme n'est pas de rendre chrétien seulement
les romains mais aussi les barbares. Avec l'appui de Valens, Fritigern
goth converti au christianisme arien défait le roi goth Athanaric II qui avait
lancé une très dure campagne de persécution des Goths chrétiens. Il craignait
que le christianisme ne détruise l'ordre social des Goths encore païens. Gibbon, chap
XXXVII. (païens barbares hors de l'empire eux aussi persécutés par les
empereurs romaines chrétiens).
Aussi quand les barbares chrétiens demandent de l'aide,
l'empereur chrétien Valens laisse ces immigrés entrer (des barbares Wisigoths
armés! dans l'empire romain confiant dans le fait qu'ils étaient déjà chrétiens (Wulfila
avait évangélisé les Goths) ou qu'ils promettaient de se convertir à
l'arianisme (Socrates scholasticus, Church
History, book 4, chapter 33). Les mêmes qui avaient pillés l'empire
au IIIe siècle.
Mais les goths chrétiens une fois dans l'empire sont
mal accueillis et s'avèrent en fait rapidement incontrôlables. On essaie alors
de les soumettre par la force, mais consternation l’armée est mal dirigée,
lance l’attaque avant d’en avoir reçu l’ordre et se fait battre à bataille
d'Andrinople 378. Plutôt que de laver l'affront de cette défaite et de
punir les pillages que les Wisigoths se sont permis en macédoine, et restaurer
la suprématie de Rome, Théodose se contente de négocier en 382 une paix avec
les Goths chrétiens.
"Théodose
eut l’adresse de persuader à ses alliés, que les conditions de paix [...]
étaient l’expression sincère de son amitié pour la nation des Goths; mais il
faisait une réponse bien opposée aux plaintes du peuple, qui blâmait hautement
ces concessions humiliantes et dangereuses. [on espérait que] leurs mœurs
s’adouciraient par l’influence de l’éducation et de la religion chrétienne [...]
Malgré ces arguments spécieux et ces brillantes espérances, il était bien
facile de prévoir que les Goths seraient encore longtemps les ennemis des
Romains, et qu’ils deviendraient peut-être bientôt les conquérants de leur
empire. Ils montraient dans toutes les occasions le plus insolent mépris pour
les citoyens et les habitants des provinces, qu’ils insultaient
impunément." Gibbon, XXVI
-
Politique faible vis-à-vis des barbares rebels. Théodose envoie
par là un signal de faiblesse aux autres barbares qui vont bientôt tous
rappliquer et tenter des incursions. Politique impensable sous Trajan
(Décébale) et même sous Marc-Aurèle deux siècles plus tôt, qui avait
proposé la paix à des germains qu’ils n’avaient pas respecté en l'attaquant par
surprise. Tout à coup tous les autres barbares s'étaient mis à s'agiter à la
frontière. Marc-Aurèle les a pourchassés et leur a fait payer leur trahison. Un
barbare qui attaque Rome est un barbare mort ou esclave.
"Voyant
la plupart de ces peuples envoyer des députés pour solliciter leur pardon,
était d'avis de s'en retourner, parce que le préfet du prétoire, Furius
Victorin, était mort, et qu'une partie de l'armée avait péri. Marc-Aurèle,
persuadé, au contraire, que la retraite des barbares et leurs dispositions pacifiques
n'étaient qu'un artifice pour éloigner d'eux ce formidable appareil de guerre,
fut d'avis de les poursuivre." (Hist Auguste)
Grâce aux compagnes fermes de Marc-Aurèle, l'empire avait
ensuite de nouveau regagner 50 ans de paix et elles auraient du conduire à
l'annexion d'une partie de la Germanie, mais Commode n'a pas poursuivi cette
sage politique. On ne peut pas contractualiser / pactiser avec les barbares.
Les barbares ne se respectent que la force. Ils ne se tiennent tranquille que
tant que Rome montre sa puissance. Le changement d’attitude sous l'empereur
chrétien Théodose envers les envahisseurs est dû au christianisme. Pas
tellement un changement de morale des romains sous l’influence chrétienne, mais
surtout changement d’attitude envers les goths parce qu’ils sont chrétiens
(avec les barbares non chrétiens comme Radagaise on restera impitoyable).
- L'alliance des romains chrétiens avec les barbares chrétiens. Au
lieu de soumettre, chasser ou anéantir ces envahisseurs, l'empereur romain
chrétien Théodose décide au contraire de s'allier à ces barbares
chrétiens qu'il va tenter d'utiliser comme mercenaires pour mater les
romains païens qui s'opposent à sa politique de christianisation de
l'empire.
- La
radicalisation chrétienne provoque une nouvelle réaction païenne. Vers
380-390, les chrétiens nicéens prennent le pouvoir total. Théodose édicte
des décrets qui interdisent la pratique du paganisme, amorçant la crise
terminale de l'empire romain. Même sous la plume d'un historien
chrétien, comme Henri-Irénée Marrou, on peut lire que l'état chrétien
de cette époque était un "état totalitaire" (Michel Onfray. Christianisme religion d'état et code
théodosien).
- L'affrontement
final païen-chrétien: la bataille de la rivière froide. En 394,
les païens encore majoritaires à Rome conduit par Arbogaste (Franç païen
fidèle au dieu Wotan) se révoltent et proclament Eugène empereur (Flavius
Eugenius Augustus) contre Théodose et les fanatiques chrétiens qui ont
pris le pouvoir à Constantinople. Eugène né païen converti au
christianisme est accusé d'apostasie par le clergé (C'est même un
païen selon Philostorge ; probablement un de ces païens dissimulé qui prennent
le christianisme seulement pour faire carrière ).
Arbogaste promet de changer à son retour l'église de Milan en écurie
et de forcer tous les moines à servir dans l'armée (Paulin,
Vita Ambrosii), si les dieux lui accordent la victoire. L'opposition n'est
plus romains contre barbares, mais elle est religieuse. On a d'un côté les
païens (romains et barbares principalement francs) contre chrétiens (romains +
barbares principalement wisigoths). L'Espagne se rallie à Eugène.
Augustin cité de Dieu, V et Claudien parlent de "guerre
civile" terme repris par Gibbon en opposition avec la transition douce
proposée par les historiens chrétiens.
Note: Théodose ne prévoit pas de ravitaillement pour les
Goths au Frigidus et Honorius leur tendra un guet-apens en 409, donc il y a
volonté de les éliminer. La politique des empereurs chrétiens est de réduire
les barbares chrétiens en les utilisant contre les romains païens. On ne
dit pas que les chrétiens romains sont pro barbares mais seulement qu'ils préfèrent
les barbares chrétiens aux romains païens.
Avant la bataille, l'armée d'Arbogaste met en avant des statues de Jupiter
et d'Hercule pour humilier l'empereur chrétien Théodose qui lui fait
porter devant son armée le grand étendard de la croix ("déployer
dans ses armées contre l’invincible étendard de la croix les symboles idolâtres de Jupiter et d’Hercule" Gibbon, XXVIII). Comme Rufin d’Aquilée (Histoire
ecclésiastique, XI, 31), Sozomène, (Histoire ecclésiastique, VII) souligne
l'engagement pour la cause païenne ; Arbogast et Eugène auraient promis à
Flavien de renverser l’Église (Paulin, Vita Ambrosii, 30.).
A la fin
du premier jour, la nuit tombe, la bataille n'est pas finie mais elle tourne
clairement à l'avantage des païens menés par Eugène-Arbogaste. Les wisigoths
envoyés en première ligne ont été décimés. "Le
carnage fut si furieux que la plupart des confédérés furent taillés en
pièce" (le général Bacurius "aussi zélé pour la défense de
la religion chrétienne que pour le service de l’empereur" a été
tué)". 10 000 goths tués sur 20 000. Ils ont subis de très lourdes
pertes. On notera que ceci constitue une preuve que l'armée romaine pouvait
donc très bien battre les envahisseurs wisigoths si les romains s'étaient unis
contre les envahisseurs au lieu de se battre entre eux. sources: Zosime, Socrate, Théodoret Augustin. Plus
de détails sur cette épisode chez Charles le Beau et dans Histoire de Théodose le Grand. Esprit Fléchier
L'empereur chrétien Théodose fait alors une prière: "Vous savez, mon Dieu,
que j'ai entrepris cette guerre au nom de Jésus-Christ votre fils. Si mes
intentions ne sont pas aussi pures que je pensais, que je périsse. Si vous
approuvez la justice de ma cause et la confiance que j'ai en vous, secourez moi,
et ne permettez pas que les gentils disent : Où est le Dieu des Chrétiens ?
" "Non, dit- il, la croix ne fuira pas devant les images d'Hercule ;
je ne déshonorerai point par une lácheté sacrilége le signe de notre
salut." (Eugène s'écrit "Ou est le dieu de Théodose ?"
(Ambroise, oration on the death of Theodosis). Pour les chrétiens, la
providence lui est venue en aide.
Le camps païen est affaiblit par la défection et trahison du général Arbitrius,
chargé par Arbogaste de couper la retraite à l'ennemi avec un corps d'armée de
20 000 hommes.
"
Tandis que les troupes d’Eugène célébraient leur triomphe dans son camp par les
orgies d’une joie insolente, le vigilant Arbogaste fit occuper les passages des
montagnes par un corps nombreux, pour couper l’arrière-garde des ennemis, et
Théodose aperçut au point du jour tout l’excès du danger de sa situation. Mais
les chefs de ce corps firent bientôt cesser les craintes de l’empereur, en lui
envoyant offrir de passer sous ses drapeaux. Théodose accorda sans hésiter
toutes les récompenses honorables et lucratives qu’ils exigeaient pour prix de
leur perfidie ; et au défaut d’encre et de papier, qu’il n’était pas facile de
se procurer, il écrivit sur ses propres tablettes la ratification du
traité." Gibbon, XXVII
De plus, le second
jour, le sens du vent favorise les archées de Théodose et le camp
d'Eugène-Arbogaste perd de justesse cette bataille au pris de très
lourdes pertes (bataille du Frigidus). Le vent de
la région la bora peut être particulièrement très violent certains jours
(200km/h). Les soldats sont "aveuglés de poussière"
"L’armée de Théodose était
garantie, par sa position, de l’impétuosité du vent, qui soufflait un nuage de
poussière dans le visage de l’ennemi, rompait ses rangs, arrachait les épées
des mains des soldats, et repoussait contre eux leurs inutiles javelots." Gibbon, XXVII." Des
soldats présents à la bataille m’ont rapporté qu’ils se sentaient enlever des
mains les traits qu’ils dirigeaient contre l’ennemi ; il s’éleva, en effet, un
vent si impétueux du côté de Théodose, que non-seulement tout ce qui était
lancé par ses troupes était jeté avec violence contre les rangs opposés, mais
que les flèches de l’ennemi retombaient sur lui-même." Augustin.
"
Convaincu qu’il n’avait plus de ressource, et que sa fuite était impossible,
l’intrépide Barbare imita l’exemple des anciens Romains, et se perça de sa
propre épée. Le sort du monde romain se décida dans un coin de
l’Italie." Gibbon, XXVII.
- L'affaiblissement militaire de l'Occident. Après la bataille
de la rivière Froide guerre civile (réunit toutes l'armée romaine de l'époque +
seulement 80 000 hommes), les effectifs militaires s'effondrent en
occident et on peinera ensuite à réunir 30 000 hommes même en sollicitant les
esclaves (soldats mals recrutés mal équipés mal formés.). La défaite
d'Arbogast a des conséquences politiques et sécuritaires désastreuses pour la
partie occidentale. Elle provoque l'effondrement militaire de l'Occident à
cause d'une perte de soutien des grandes familles païennes occidentales vis à vis du
pouvoir impérial qui les persécute et a interdit leur religion.
Grosses
tensions perdurent dans l'armée qui ne peut être réunifiée "A campée aux
environs de Milan, elle se trouvait en face des légions victorieuses de
Théodose. Les passions n'étaient pas encore assez affaiblies pour qu’un
semblable rapprochement fût, sans péril ; aussi craignit-on un instant que les
deux armées n'en vinssent encore une fois aux mains ? Stilicon s'empressa de
prévenir une collision en publiant l'amnistie prescrite par Théodose mourant
"
Arthur Beugnot, Histoire le la destruction du paganisme
Dans
le même temps le pouvoir chrétien investit ses ressources dans les
églises
et néglige l'armée, seulement déléguée à des barbares mercenaires
(changement
culturel causé par le changement de religion). Bilan de cet
affaiblissement militaire, morale, économique et de la cohésion
nationale à
cause des oppositions religieuses: les barbares voient la
désorganisation
romaine et profitent de la situation. Le point de non retour se
situe
probablement ici. Maintenant qu'il est franchi, la catastrophe est
désormais certainement inéluctable. Mais on va voir que le
christianisme va encore accélérer la décomposition et provoquer une
chute brutale.
- Pillage
de la Grèce. Alaric le roi des Wizigoths voit la faiblesse de l'armée
romaine qui s'est autodétruite lors de la bataille du Frigidus à laquelle il a
participé du coté chrétien comme mercenaire et donc il va profiter de la
faiblesse de l'Empire. Les wisigoths ne veulent pas spécialement détruire
l'Empire Romain. Ils veulent être intégrés à l'empire et le menace pour
soutirer de l'argent des terres et obtenir une reconnaissance
légale. Alaric "avait sollicité le commandement
des armées romaines ; irrité du refus de la cour impériale" il
s'en va alors ravager la Grèce. Un an après la bataille de la rivière
froide, les wisigoths pillent la Grèce. La destruction du berceau de la
civilisation gréco-romaine se produit avec les barbares laissés libre
à l'intérieur de l'Empire: "Les plaines fertiles de la
Phocide et de la Béotie furent bientôt couvertes d’une multitude de Barbares
qui massacraient tous les hommes d’âge à porter les armes, et entraînaient avec
eux les femmes, les troupeaux et le butin enlevé aux villages qu’ils
incendiaient. Les voyageurs qui visitèrent la Grèce plusieurs années après,
distinguèrent encore les traces durables et sanglantes de la marche des
Goths". Et ce n'est qu'après avoir ravagé Sparte et Athènes qu'"un édit
publié à Constantinople déclara la promotion d’Alaric au rang de maître général
de l’Illyrie orientale. Les habitants des provinces romaines, et les alliés qui
avaient respecté la foi des traités, virent avec une juste indignation
récompenser si libéralement le destructeur de la Grèce et de l’Épire. Le
Barbare victorieux fut reçu en qualité de magistrat légitime dans les villes
qu’il assiégeait si peu de temps auparavant. Les pères dont il avait massacré
les fils, les maris dont il avait violé les femmes, furent soumis à son
autorité, et le succès de sa révolte encouragea l’ambition de tous les chefs
des étrangers mercenaires. [...Alaric donna] l’ordre de fournir à ses troupes
une provision extraordinaire de boucliers, de casques, de lances et d’épées.
Les infortunés habitants de la province furent contraints de forger les
instruments de leur propre destruction, et les Barbares virent disparaître
l’obstacle qui avait quelquefois rendu inutiles les efforts de leur
courage" Gibbon, chap XXX.
- Alaric un romain ? Plutôt que de le vaincre militairement,
le pouvoir faible de Constantinople essaie de calmer le chef des Wisigoths en
lui accordant un titre de général. Le titre de général attribué à ce
barbare n'a donc pas été donné volontairement. Il l'a extorqué par la
force. Cette lâcheté du gouvernement chrétien envers les envahisseurs va
continuer tout au long du Ve siècle. Idem pour les Vandales et même pour
Attila: "tribut dont il déguisa la honte en donnant le titre de
général romain au roi des Huns" Gibbon, chap
XXXIV. Donc affirmer que la vision classique de la chute de Rome par
les barbares est un mythe qui recouvre en fait une réalité plus complexe sous
prétexte qu'Alaric le roi des Wisigoths a obtenu le titre de général romain est
vraiment un travestissement de la réalité historique par nos modernes épris de
relativisme culturel (écueil véhiculé par la chaîne Nota Bene. Les invasions
barbares, un mythe ?).
le
tournant du Ve siècle
la chute de Rome, de l'Occident, et de la civilisation
gréco-romaine
En
402/403, les wisigoths attaquent l'Italie (exode de la population vers l'Afrique
et l'orient) mais sont contrés par le général romain Stilicon. Dans son discours
aux armées, il dit que
"[les Goths] Longtemps protégé non par ses propres forces que par la
confusion et les discordes civiles qui tiennent encore l’univers en
suspens".
Claudien, guerre contre les Gètes
"Saint Jérôme après avoir décrit les ravages des Huns ajouter : « A
cette époque la discorde régnait parmi « nous, et la guerre domestique
surpassait la guerre « étrangère."
Arthur Beugnot, Histoire le la destruction du paganisme
Après avoir remporté la bataille,
plutôt que de profiter de son avantage sur les Wisigoths, Stilicon "proposa
de payer la retraite des Barbares" Wisigoths. Gibbon, chap
XXX. Funeste politique de continuer de tenter d'en faire des mercenaires pour
pallier au manque de soldats. Ces wisigoths vont contre-attaquer 7 ans plus
tard et piller Rome.
-
Politique faible du déshonneur. Cette mauvaise politique de
compromission se poursuit avec le paiement d'or aux barbares pour essayer
d'acheter la paix. L'empereur chrétien Honorius et Stilicon imposent
au réticent sénat païen de Rome le paiement d'un tribu aux Wisigoths
au lieu d'utiliser cet argent pour lever une armée et de les
annihiler. Pour le sénat de Rome "il était indigne de
la majesté de Rome d’acheter une trêve honteuse d’un roi barbare, et qu’un
peuple magnanime devait toujours préférer le hasard de sa destruction à la
certitude du déshonneur (Lampadius)." Gibbon, chap
XXX (Churchill: "Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le
déshonneur ; il a choisi le déshonneur et il aura la guerre").
Une illustration de la perte totale du caractère romain sous les empereurs
chrétiens. Gibbon fait le parallèle avec la résistance héroïque de Rome
contre l'attaque surprise d'Hannibal, et nous nous pouvons la faire avec
Churchill, lors "les heures sombres" (juin 1940). Gibbon avait écrit
pour former les politiques. Rome que l'on croyait devoir être un empire
éternel est pourtant rapidement tombée et tout chef d'état doit connaître les
erreurs commises pour ne pas refaire les mêmes. Peut-être a-t-il influencé
Churchill et indirectement sauver l'Europe du nazisme... On ne peut pas
contractualiser la paix avec un fauve, une bête sauvage. (Gibbon
XXXI citant le roi des Goths disant lui-même que "le caractère indocile et
féroce des Goths n’est point susceptible de se soumettre à la contrainte salutaire
d’un gouvernement civil")
- En 406
les Ostrogoths attaquent l'Italie. La faiblesse
de Rome a éclaté au grand jour. Des barbares se précipitent pour
piller. Un grand nombre de villes d'Italie du Nord sont détruites ou
pillées par l'Ostrogoth Radagaise qui fait le siège de Florence en 406. La
chute de Rome approche.
- Les dissensions
religieuses n'ont pas disparues. "Les
adorateurs de Jupiter et de Mars, opprimés par leurs concitoyens, respectaient
dans l’implacable ennemi de Rome (Radagaise), le caractère d’un païen zélé ;
ils déclaraient hautement que les sacrifices de Radagaise leur paraissaient
beaucoup plus à craindre que ses armes, et ils se réjouissaient secrètement
d’une calamité qui devait convaincre de fausseté la religion des
chrétiens." Gibbon, chap
XXX Augustin, cité de Dieu, V, XXIII
On disait tout haut : « C'est la
faute de ces gens-là et de leur Dieu ! » « Comment résisterions-nous à un
ennemi qui sacrifie, nous qu’on empêche de sacrifier? » s’écriaient les
païens avec rage, et alors éclataient les imprécations, les blasphèmes, les menaces
contre la religion du Christ et contre les lois des successeurs de Constantin.
»
Amédée Thierry. Revue des deux mondes. Trois Ministres de l’empire romain
sous les fils de Théodose.
- Le
constat de l'effondrement militaire. "Toutes
les espérances du vigilant ministre d’Honorius (Stilicon) se bornèrent à la
défense de l’Italie. Il abandonna une seconde fois les provinces, rappela les
troupes, pressa les nouvelles levées exigées à la rigueur et éludées avec
pusillanimité, employa les moyens les plus efficaces pour arrêter ou ramener
les déserteurs, et offrit la liberté et deux pièces d’or à chaque esclave qui
consentait à s’enrôler. Ce fut à l’aide de ces ressources que Stilichon parvint
à rassembler avec peine, parmi les sujets d’un grand empire, une armée de trente
ou quarante mille hommes, que, dans le temps de Scipion ou de Camille, eussent
fournie sur-le-champ les citoyens libres du territoire de Rome." Gibbon, Chap XXX.
Le clergé
contre les honneurs pour les héros militaires. Stilicon rapatrie toute l'armée
romaine en Italie et stoppe les Ostrogoths. "quand cette grande menace se
fut dissipée comme un rêve, les chrétiens revendiquèrent l'honneur d'une
victoire dont le profit était à eux. [...] Dans ce système, la gloire et les
services de Stilicon devenaient un embarras : on les atténua, on les effaça, on
les nia. [...] Des versions combinées dans cette intention, et que nous pouvons
lire encore, présentèrent ce général et l'armée romaine comme de simples
spectateurs de la victoire, qui n'avaient pas tiré l'épée, pas eu un seul mort,
pas un blessé ; mais qui buvaient, mangeaient et se divertissaient ( tels sont
les termes du récit d'Orose) pendant que le ciel se chargeait de tout faire.
Malheur à qui fût venu réclamer sa part de gloire contre Dieu !"
Amédée Thierry. Revue des deux mondes. Trois Ministres de l’empire
romain sous les fils de Théodose.
-> Saint-paul vs Spinoza sur la gloire. L'ambiance
n'est pas tellement favorable au recrutement.
- Le
passage du Rhin. Le rapatriement en Italie de toute
l'armée en Italie facilite le passage du Rhin par les barbares (nuit du 31
décembre 406) qui ravagent l'Occident, seulement donc 10 ans après la victoire
finale du christianisme sur le paganisme. A partir de 407, on
assiste à un effondrement brutal de l'occident d'abord en Gaulle et en
Bretagne: des villes entières disparaissent. C'est la pire invasion depuis
des siècles.
"Ce passage mémorable des Suèves, des
Vandales, des Alains et des Bourguignons, qui ne se retirèrent plus, peut être
considéré comme la chute de l’Empire romain dans les pays au-delà des Alpes ;
et dès ce moment, les barrières qui avaient séparé si longtemps les peuples
sauvages des nations civilisées, furent anéanties pour toujours." Gibbon, chap
XXX
Vandales, d' Alains et de Suèves (Quadiens, Marcomans et Alamans)
- La
modération religieuse du général Stilicon énerve le clergé. Depuis
la bataille du Frigidus, Stilicon applique une politique d'apaisement envers
les païens à Rome. Il fait, par exemple, protéger les temples païens, avec pour
argument la volonté ne pas dénaturer les cités romaines. Il s'entoure, de plus,
de païens notoires, tels son panégyriste, Claudien, et traite avec déférence le
Sénat de Rome, où les anciens cultes sont encore très pratiqués.
"Le sénat paraît avoir regardé Stilicon comme un partisan secret de
l'ancien culte ; car dans plusieurs missions qu'il lui confia près des
empereurs , il lui adjoignit Symmaque"
Arthur Beugnot, Histoire le la destruction du paganisme
Tout cela attise la haine du clergé, lorsque son fils se déclare
païen. Les chrétiens montent un intrigue de cour pour le faire assassiner.
" Le ministre Olympius dit à l'empereur Honorius à propos du fils de
Stilicon « que son fils avait déjà un parti puissant; qui le désiraient
pour maître, dans l'espérance qu'il relèverait l'idôlatrie ; que [Stilichon] le
père , chrétien en apparence, avait élevé son fils dans le paganisme, afin de
réunir ainsi les deux grands partis qui divisaient tout l'empire "
Charles Le Beau. Histoire du
Bas-Empire en commençant à Constantin le Grand
"
dans l’opinion des chrétiens l’éducation d’Euchérius se trouvait entachée de
paganisme. Un maître de rhétorique, de philosophie, de poésie, interprète de
systèmes ou d’ouvrages littéraires fondés sur le polythéisme, était assez
naturellement soupçonné d’être lui-même païen, pour peu qu’il admirât ses
modèles : or du maître à l’élève il n’y avait qu’un pas, et la
présence assidue de Claudien dans la famille de Sérène donnait assez
naturellement couleur aux suppositions. Sans s’arrêter à rien éclaircir,
les partis décidèrent qu’Euchérius était païen. On alla jusqu’à citer de lui
des propos menaçant contre le christianisme. Nouveau
Julien, disait-on, il avait promis aux hiérophantes et aux sophistes, ses
maîtres, d’inaugurer son principat par le rétablissement des temples et le
renversement des églises"
Amédée Thierry. Revue des deux mondes. Trois Ministres de l’empire romain sous
les fils de Théodose.
-
L'assassinat du généralissime Stilicon en 408. Alors
que la Gaulle est à feu et à sang, et que la situation est critique, le
gouvernement chrétien redoute que cette crise favorise un général qui aurait pu
remettre de l'ordre comme Julien et Arbogaste et reprendre le pouvoir (mais
aussi s'en prendre au christianisme). En cas de succès sur le champ de
bataille, c'est ce qui serait inévitablement arrivé. Il serait devenu
l'empereur légitime. Ils ne veulent pas d'une troisième restauration païenne
aboutisse. L'affrontement religieux est une cause majeure derrière cette
politique. De peur de la renommée grandissante du général Stilicon qui
vient de sauver Florence (et Rome) et de son fils, le gouvernement chrétien
préfère faire assassiner préventivement le dernier grand général qui lui reste
plutôt que d'avoir à affronter une nouvelle restauration du paganisme.
"Le clergé, en célébrant dévotement le jour heureux (de la mort
de Stilicon) qui en avait délivré presque miraculeusement l’Église, assura que
si Euchérius (le fil de Stilicon) eût régné, le premier acte de sa puissance
aurait été de rétablir le culte des idoles et de renouveler les persécutions
contre les chrétiens." Gibbon, XXX
- La cour
de Constantinople choisi d' imposer le christianisme nicéen à tout prix au
mépris de la sécurité de Rome. Une fois débarrassés de
Stilicon, en 408, le parti de l'unité catholique obtient l'interdiction aux païens
de servir l'état, "Par cet édit, (l'empereur) Honorius
écartait de tous les emplois de l’état tous ceux dont la croyance était en
opposition avec la foi de l’Église catholique, rejetait absolument les services
de tous ceux dont les sentiments religieux ne s’accordaient pas avec les siens,
et se privait ainsi d’un grand nombre de ses meilleurs et de ses plus braves
officiers, attachés au culte des païens ou aux erreurs de l’arianisme. Alaric
aurait approuvé et conseillé peut-être des dispositions si favorables aux
ennemis de l’empire Gibbon, XXXI.
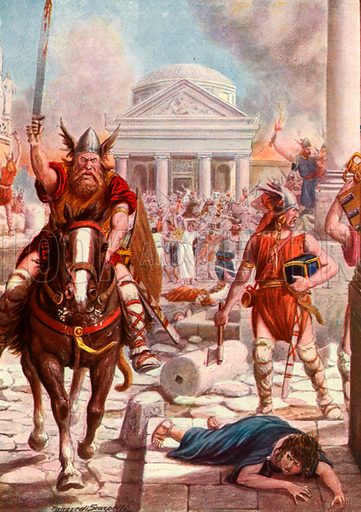
« Bien que ce Généride (Generidus) fût un étranger, il ne laissait pas d’être un modèle accompli de
vertu, et d’être tout-à-fait supérieur à l’avarice. Il était demeuré
étroitement attaché à la religion de ses pères. Lorsqu’on publia une loi par
laquelle il était défendu à ceux qui n’étaient pas chrétiens de porter la ceinture, il
mit bas la sienne, et demeura dans sa maison. L’empereur lui ayant depuis
commandé de venir au palais en son rang avec les autres officiers, il répondit
qu’il y avait une loi qui lui défendait de se tenir au rang des officiers et de
porter la ceinture. L’empereur lui ayant répondu que la loi était faite pour
les autres, et non pour lui qui s’était exposé à tant de hasards pour le bien
de l’état, il persista à refuser un honneur qu’il ne pouvait accepter
sans faire injure aux autres, jusqu’à ce que l’empereur, pressé par la
honte et par la nécessité, abolit entièrement la loi, et permit d’exercer les
charges à ceux qui ne voulaient point changer de religion. » (en
fait il est fait seulement temporairement des exceptions loi de 410 avant
de réappliquer à nouveau en 416)
Zosime
[...épuration des soldats d'origine barbare de l'armée
romaine...] Par cette conduite inconcevable, les ministres d’Honorius perdirent
non-seulement trente mille des plus braves soldats de leur armée, mais en
firent leurs ennemis ; et le poids que devait mettre dans la balance ce corps
formidable, capable à lui seul de déterminer l’événement de la guerre, passa du
parti des Romains dans celui des Goths." Gibbon, XXXI.
- La priorité absolue du gouvernement chrétien n'a pas été de combattre les
envahisseurs barbares mais de détruire le paganisme quitte à utiliser les
barbares. Comment expliquer une politique si absurde ? Incompétence totale
de la cour, en partie oui mais cette politique absurde de notre point de
vue n'est pas absurde du point de vue du chrétien militant. Peu importe la cité
terrestre, ce qui compte c'est la christianisation des âmes et il vaut mieux
privilégier un barbare chrétien qu'un romain païen.
Le barbare n'est pas une menace pour l'empereur chrétien planqué dans son
palais de Ravennes derrière ses marécages. Le peuple romain chrétien ne va pas
se rallier à un barbare et les païens ne vont pas se rallier à un chrétien. Au
final, donc l'empire finira par traiter avec Alaric, Genséric, Attila même
s'ils continuent de piller. En revanche les barbares païens en position de
servir dans l'armée romaine officielle sont les plus dangereux pour l'empereur
chrétien et eux sont éliminés sans pitié.
- Le sac de Rome: un accident lié à la priorité donnée au christianisme ou
pire encore, une volonté délibérée des chrétiens intégristes de châtier les
païens réfractaire à Jésus ? Face à
tant de mesures absurdes du gouvernement chrétien, on peut s'interroger si le
sac n'était pas finalement intentionnel ?
Un
sentiment qui ressort de la lecture des sources Les chrétiens sont
pro-barbare quand il s'agit de lutter contre les païens: "on trouve chez
les chrétiens plus de textes exprimant de l'empathie envers les Barbares que
chez tous les auteurs non chrétiens réunis : même Jérôme, si hostile aux
Barbares en général, trouve à louer les Goths lorsqu'il adresse à deux d'entre
eux, Sunnia et Frétéla, une très longue lettre répondant à leur demande de
comparer la version grecque et la version latine des Psaumes.[...] Salvien de
Marseille est plus systématiquement positif" Claire Sotinel Les chrétiens sont-ils responsables - -
lhistoire.fr. Dans le
récit de l'affrontement entre le général païen Litorius et le roi chrétien
Théodoric, on sent que les auteurs chrétiens préfèrent le chrétien
barbare plutôt que le romain païen (Salvien de Marseille).
Le clergé préfère le général chrétien barbare au général romain pas assez
chrétien au goût du clergé. "Alaric, quoique arien,
était un chrétien fidèle et pieux qui ne voulait point combattre le jour de
Pâques, tandis que l’impie Stilicon violait de gaîté de cœur la sainteté de
cette fête".
Amédée Thierry. Revue des deux mondes. Trois Ministres de l’empire romain sous
les fils de Théodose.
En effet à la Bataille de Pollentia "Stilichon
résolut d’attaquer les dévots barbares tandis qu’ils célébraient pieusement la
fête de Pâques. L’exécution de ce stratagème, que le clergé traita de
sacrilège, fut confiée à Saul, barbare et païen".Gibbon, chap
XXX
Pas seulement une préférence des barbares chrétiens. Certaines sources
font carrément références à une manipulation délibérée des barbares contre Rome
?
- le païen "Eunape (in vit. Philosoph.) donne à entendre qu’une troupe de
moines trahit la Grèce et suivit l’armée des Goths (en 395)" Gibbon, chap
XXX) et Augustin confirme que les Goths ont été excités par les prêtres
contre le paganisme: "[les barbares wisigoths d'Alaric] se sont montrés
ennemis si acharnés des démons et de tout ce culte où Radagaise mettait sa
confiance, qu’ils semblaient avoir déclaré aux idoles une guerre plus terrible
qu’aux hommes." Augustin, cité de dieu
"Alaric déclara la guerre à l'empire d'Occident,
ravagea la Pannonie, la Macédoine, la Thessalie, et ne trouvant rien qui lui
fit obstacle , il envahit la Grèce. Ses soldats détruisirent les plus beaux
monuments païens de cette contrée" "Les Goths étaient ariens et très
-attachés aux croyances de cette secte. Leur fureur dévastatrice se porta
principalement sur les temples et les simulacres païens." Arthur Beugnot,
Histoire le la destruction du paganisme
According
to Claudian, Stilicho was in a position to destroy them, but was
ordered by Arcadius to return the Eastern Empire's forces and leave
Illyricum.
- "les conseillers chrétiens du prince n'oubliaient pas
l'horreur des blasphèmes commis à Rome en 406" pour Paul
Orose, [l'explication du sac de Rome est que] Dieu a décidé de chantier cette
tempête de blasphèmes qui éclata à Rome durant l'été 408" . Paul
Orose écrit "que l'incrédulité et la désobéissance sera laissée comme
excrément et comme paille pour être détruit et brûlé".
- On a vu les manœuvres du ministre Olympus.
- "[la
chrétienne] Serena fut accusée de vouloir livrer la ville aux barbares" la
chrétienne Serena, nièce de Théodose exécutée
pour collusion avec Alaric sur ordre du sénat peu avant le sac de Rome accusée
par Zosime, chrétienne fanatique accusée d'avoir prophanée le temple des
vestales.
- la chrétienne Anicia Faltonia Proba sera accusée d'avoir ouvert les
portes aux barbares (selon le chrétien Procope).
-
L'empereur Honorius accusé d'avoir appelé lui-mêmes les barbares pour réprimander
ses propres sujets" (selon
le chrétien Procope de Césarée, Histoire de la Guerre des Vandales, I, II). VIe siècle
"[si les troupes restantes ne sont pas employées pour sauver Rome
peut-être aurons nous droit de parler de trahison" "[Pour André
Piganiol, les chrétiens intégristes de la cours impériale qui ont participé à
la chuté Stilicon] Olympius, Serena sont directement responsables de la chute
de Rome" "Nous soupçonnons, sans posséder la preuve, que le
sac de 410 a été voulu et préparé par les fanatiques chrétiens qui se
dissimulaient dans l'ombre d'Honorius.".
André
Piganiol, le mémorial des Siècles, le sac de Rome, 1964. p99, p123, p200.
L'idée reste confuse dans l'esprit de certains historiens
chrétiens.
"Tillemont intitule un de ses chapitres : Triomphe de Jésus - Christ dans
le saccagement de Rome. A la vérité saint Augustinº et Orose citent un fait qui
semble favorable à cette étrange opinion que le christianisme triompha dans la
prise de Rome " [...] "Pendant que les chrétiens et les païens sont
aux prises, les barbares arrivent sur la scène et terminent une lutte qui sans
leur intervention se serait prolongée. " "La Providence réunit dans
des régions sauvages les peuples qui viendront en Occident faire table rase, et
débarrasser le christianisme de tous ces restes gênants d'une civilisation
ennemie." "Les incertitudes du combat [entre chrétiens et païens] se
seraient prolongées longtemps encore si la Providence n'avait enfin donné le
signal aux barbares : ils franchissent les barrières de l'empire romain, et
l'arrêt rendu contre la vieille société va être exécuté"
Arthur Beugnot
- La sac de Rome. Suite à la politique
d'Honorius en dessous de tout, les Wisigoths chrétiens mettent finalement
Rome à sac en 410.
Les contemporains sont fortement frappés par
l'événement et accusent le christianisme. Des Chrétiens retournent même au
paganisme. On trouve des échos de l'accusation païenne dans les sermons
d'Augustin: "voilà ce que valent les temps chrétiens !" "C'est à
l'époque chrétienne que Rome est saccagée et incendiée. " "Tous ces
maux datent de l'époque chrétiennes, avant l'époque chrétienne comme nous regorgions
de biens. Avant que cette doctrine ne fût prêchée de par le monde, le genre
humain n'endurait pas tant de maux. C'est le fait de l'époque chrétienne [...]
le monde est dévasté, il défaille"
Augustin, Sermon 296
L'illustre Saint Augustin expliqua Alaric n'était
entré à Rome que pour faire la guerre aux idôles; c'était l'instrument avec
lequel Dieu châtiait les païens; quant aux chrétiens qui avaient souffert,
c'est Dieu qui l'avait ainsi voulu!
"ces hommes ingrats et blasphémateurs qui
imputent au Christ les maux qu’ils souffrent [..] Ils savaient bien la retenir,
cette langue, quand réfugiés dans nos lieux sacrés, ils devaient leur salut au
nom de chrétiens; et maintenant, échappés au fer de l’ennemi, ils lancent
contre le Christ la haine et la malédiction !" (Livre I, III)
Mais quelques hommes bons et
chrétiens ont été mis à la torture, afin d'être forcés de livrer leurs biens à
l'ennemi. [...] Livre I, chap X. Mais, ajoute-t-on, de nombreux
chrétiens ont été massacrés et ont été mis à mort d'une affreuse variété de
manières cruelles.[...] les chrétiens savent bien que la mort du pauvre pieux
dont les chiens léchaient les plaies était bien meilleure que celle du méchant
riche qui gisait en pourpre et en fin lin, quel mal ces morts terribles
pouvaient-elles faire aux morts qui avaient bien vécu ? Livre I, chap XI
"[les innocents] sont justement chatiés avec les
méchants dans ce monde, bien que dans l'éternité ils échappent tout à fait au
châtiment. [...] les bons sont châtiés avec les méchants, quand Dieu se plaît à
punir temporellement les mœurs débauchées d'une communauté. Ils sont punis
ensemble, non parce qu'ils ont mené une vie également corrompue, mais parce que
les bons comme les méchants, quoique pas également avec eux, aiment cette vie
présente [...] Livre I, chap IX.
[...] ils croient porter une accusation décisive contre le
christianisme, lorsqu'ils aggravent l'horreur de la captivité en ajoutant que
non seulement les femmes et les jeunes filles célibataires, mais même les
vierges consacrées, ont été violées. [.et tout ce qu'Augustin trouve à répondre
c'est que..] cet acte qui ne pouvait pas être subie sans plaisir sensuel, doit
être considérée comme ayant été commise aussi avec un certain assentiment de la
volonté."[...] Livre I, chap XVI
[face aux chrétiennes violées qui doutent] Demanderez-vous
pourquoi il a été permis? qu’il vous suffise de savoir que la Providence, qui a
créé le monde et qui le gouverne, est profonde en ses conseils; « impénétrables
sont ses jugements et insondables ses voies ». Toutefois descendez au fond de
votre conscience, et demandez-vous sincèrement si ces dons de pureté, de
continence, de chasteté n’ont pas enflé votre orgueil, [...] Si vous n’avez pas
consenti au mal, c’est qu’un secours d’en haut est venu fortifier la grâce
divine que vous alliez perdre, et l’opprobre subi devant les hommes a remplacé
pour vous cette gloire humaine que vous risquiez de trop aimer. [..] qu’elles
ne se plaignent pas d’avoir souffert la brutalité des barbares qu’elles
n’accusent point Dieu de l’avoir permise, qu’elles ne doutent point de sa
providence. Livre I, chap XVIII
j’ai encore quelque chose à répondre à ceux qui rejettent
les malheurs de l’empire romain sur notre religion Livre I, chap XXXVI
plusieurs vont attaquant notre religion avec une extrême
insolence; et quand ils voient de nos jours quelque guerre se prolonger, ils
s’écrient que si l’on servait les dieux comme autrefois, cette vertu romaine,
autrefois si prompte, avec l’assistance de Mars et de Bellone, à terminer les
guerres, les terminerait de même aujourd’hui.
Augustin, la citée de Dieu contre les païens
Destructions.
"Depuis que la campagne de Toscane et la voie Aurélienne, que la main des
Goths a dévastées par le fer et par la flamme, n'ont plus d'habitations pour
éloigner les forêts ; de ponts pour contenir les fleuves, la mer, malgré ses
dangers, est une route plus sûre. [.. ] On ne peut plus reconnaître les
constructions, ouvrage des siècles passés ; le temps a dévoré ces grandes
murailles : l'enceinte est brisée çà et là, et il n'en reste que des vestiges ;
les toits sont étendus sur le sol, ensevelis sous de vastes décombres."
Rutilius en 417 de Rome à la Gaulle.
Scènes de désolation racontée par Salvien en Gaulle.
Les relations entre les Wisigoths et le pouvoir romain Christine Delaplace
PARTIE III
La
chute de Rome causée par le christianisme ?
C'était la conclusion d'Edward Gibbon (XVIIIe), historien du plus célèbre
ouvrage sur la chute de l'empire Romain: Gibbon s'excuse de
devoir donner sa conclusion (les réactions à son époque étaient
hostiles): "Comme le principal objet de la
religion est le bonheur d’une vie future, on peut remarquer sans surprise et
sans scandale que l’introduction, ou au moins l’abus du christianisme, eut
quelque influence sur le déclin et sur la chute de l’empire des Romains. »
« La conversion de Constantin précipita la
chute de l'empire » Gibbon, Observations
Générales sur la chute de l’Empire romain dans l’Occident (Tome 7). (opinion de Bruno Dumézil sur Gibbon).
La guerre civile + arrivée des barbares
est la cause de l'effondrement brutal en occident, ensuite la décadence morale
produite par le christianisme induit une transformation plus lente, qui n'est
pas responsable de l'effondrement brutal, mais plutôt d'un affaiblissement
progressif qui va empêcher tout rebond pendant les siècles suivants.
La guerre
civile entre sectes chrétiennes: "La
foi, le zèle, la curiosité et les passions plus mondaines de l’ambition et de
l’envie, enflammaient les discordes théologiques. L’Église et l’État furent
déchirés par des factions religieuses, dont les querelles étaient quelquefois
sanglantes et toujours implacables. [...] une nouvelle espèce de tyrannie opprima
le monde romain, et les sectes persécutées devinrent en secret ennemies de leur
patrie." Gibbon, Observations
Générales sur la chute de l’Empire romain dans l’Occident (Tome 7).
"L’abus du christianisme fit naître dans l’Empire romain de nouveaux
sujets de tyrannie et de sédition. Les violences des factions religieuses rompirent
tous les liens de la société civile ; et le citoyen obscur qui
pouvait regarder avec indifférence la chute ou l’élévation des empereurs,
imaginait et éprouvait que sa vie et sa fortune se trouvaient liées avec les
intérêts du chef ecclésiastique qu’il avait choisi." "les querelles
théologiques affligèrent l’empire" "un évêque arien pouvait
satisfaire impunément les ressentiments envenimés de sa haine théologique"
"Le simple récit des divisions intestines qui troublèrent la paix de
l’Église et déshonorèrent son triomphe, confirmera la remarque d’un historien
païen, et justifiera les plaintes d’un respectable évêque. L’expérience avait
convaincu Ammien que les chrétiens, dans leurs mutuelles animosités,
surpassaient en fureur les bêtes féroces que doit le plus redouter
l’homme" Gibbon, Chap XXI
Affrontement
meurtrier entre les partisans de l’évêque Athanase et l’évêque George de
Cappadoce. (La foule crie dans l’arène) : un dieu, un Christ, un
évêque. » « (à Rome) Les partisans de l’évêque Felix furent inhumainement
égorgés dans les rues, dans les places publiques, dans les bains, dans les
églises même » Idem a Constantinople « la première fois que le sang coula
dans la nouvelle capitale, ce fut pour des démêlés ecclésiastiques et un grand
nombre de citoyens des deux partis perdirent la vie dans des émeutes violentes
et opiniâtres »
"Ils ont, dit-il, beaucoup de dieux qui sont tous faux, nous en avons un
seul qui est le véritable ; or , ils restent unis et nous , nous ne pouvons pas
supporter la concorde."
Augustin cité par Arthur Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme
La guerre / Haine Chrétienne du paganisme.
"[Les
cultes] furent abolis et toutes les traditions anciennes négligées, ce qui fut
cause de la décadence de l’empire, de l’invasion des Barbares, de la désolation
des provinces, de ce changement si déplorable de la force de l’empire, qu’on ne
peut seulement plus reconnaître le lieu où étaient autrefois les villes les
plus célèbres. Le récit que nous ferons du détail des affaires découvrira plus
clairement la vérité de ce que j’avance."
Zosime, IV
" Si
le christianisme se fût contenté d'attaquer les croyances, les traditions ou la
mythologie du polythéisme, il n'eût fait que reprendre l'oeuvre de plus d'un
philosophe, et sans doute l'empire n'aurait pas ressenti une aussi vive
commotion. Mais quand les Romains entendirent proclamer comme but d'une
religion nouvelle la destruction de leurs moeurs, de leurs usages et de leurs
lois ; quand ils reconnurent qu'on professait ouvertement le mépris de la
sagesse des temps passés; quand ils apprirent que des hommes prétendaient faire
dans le monde toutes choses nouvelles ; alors ils crurent la société menacée
non seulement d'une réforme religieuse , mais d'une révolution politique ,
et ils vouèrent une haine implacable à ces esprits malfaisants qu’animait un
funeste vertige , et qui , par leur audace, s'étaient eux-mêmes placés en
dehors des lois ordinaires de l'humanité"
"
Arthur Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme
« Le
christianisme n'avait pas déclaré la guerre à la société romaine, mais il
l'avait condamnée. Il attendait impatiemment la chute de la nouvelle Babylone,
qui serait le premier épisode de la fin du monde. C'est pourquoi, avant
l'avènement de Constantin, le chrétien faisait grève, fuyait les charges de
l'État, refusait de se battre pour Rome. [...] Quand Rome traversa la crise
suprême, les chrétiens, la voyant perdue, l'ont traitée de cité du diable et
l'ont de nouveau trahie. La patrie romaine a beaucoup à se plaindre de ces
mauvais citoyens. »
André Piganiol, L'Empire chrétien
note: une haine viscérale envers les Romains et leur état se fait jour dans l’apocalypse de saint Jean.
Affaiblissement militaire due aux guerres civiles: baisse de la discipline
militaire et négligence des frontières sous les empereurs chrétiens.
"On a blâmé, avec raison, Constantin d’une autre innovation qui corrompit la discipline militaire, et précipita la ruine de l’empire. [...] Les rivaux qui se disputaient l’empire du monde romain, avaient retiré la plupart des troupes destinées à la défense des frontières [...]. Quand la fin de cette guerre civile eut rendu inutiles les garnisons intérieures, l’empereur n’eut pas assez de sagesse ou de fermeté pour ramener la discipline sévère de Dioclétien" " La chaîne de fortifications que Dioclétien et ses collègues avaient tendue sur les bords des grands fleuves, cessa d’être entretenue avec le même soin et défendue avec la même vigilance. [...] quoique une suite de princes aient fait, chacun dans leur temps, tous leurs efforts pour recruter et ranimer les garnisons des frontières, jusqu’au dernier moment de sa dissolution, l’empire a beaucoup souffert de la blessure mortelle que lui avait faite l’imprudente faiblesse de Constantin." XVII. "les institutions partiales de Constantin anéantirent [le gouvernement militaire] et le monde romain devient la proie d'une multitude de Barbares » Gibbon, Observations Générales sur la chute de l’Empire romain dans l’Occident (Tome 7).
Les Chrétiens et l'Armée
Condamnations pour refus de service dans l'armée
surtout au IIIe siècle. Le pacifisme n'est pas la première motivation, mais
surtout un rejet de l'idolâtrie. "Maximilien
persista opiniâtrement à déclarer que sa conscience ne lui permettait pas
embrasser la profession de soldat. …après avoir jeté son baudrier, son épée et
les marques de sa dignité, s’écria hautement qu’il n’obéirait qu’à
Jésus-Christ, roi éternel, et qu’il renoncerait pour jamais à des armes
temporelles et au service d’un maître idolâtre" Gibbon
Le motif du rejet était surtout l'idolâtrie de l'empereur et le culte
impérial. Une fois l'empereur devenu chrétien les défection sont moins
nombreuses et plusieurs megalomartyrs qui attaquent le paganisme sont des
militaires: Georges de Lydda, Artème d'Antioche, Polyeucte, Théodore Tiron,
Mercure de Césarée, Martin de Tour, et Contantin/Théodose. Depuis 314 l'église de
Constantin veut des chrétiens dans l'armée. La violence pour la foi est une
constante de la culture judéo chrétienne qui n'est pas un pacifiste envers les
hérétiques, infidèles, incroyants. "L’Église chrétienne ayant été fondée
par le sang, confirmée par le sang, accrue par le sang, ils continuent à en
verser" Erasme, Eloge de la folie Depuis
314 l'église de Constantin veut des chrétiens dans
l'armée. La violence pour la foi est une constante de la culture judéo
chrétienne qui n'est pas un pacifiste envers les hérétiques,
infiodèles, incroyants. "L’Église
chrétienne ayant été fondée par le sang, confirmée par le sang, accrue
par le sang, ils continuent à en verser" Erasme, Eloge de la folie
Valens
légifère contre les moines qui refusent de servir dans l'armée (CT.
12.1.63) en 376. Les moines de Nitrie refusèrent d'être enrôlés et furent
battus à mort par la troupe armée (Socrate,
4, 21-23 – st jerome chron ann 377).
L’attention des empereurs abandonna
les camps pour s’occuper des synodes ;
Vers 400 Synesios la politique militaire irresponsable du précédent empereur (Théodose) écrit: "permettre que les citoyens, exemptés, quand ils le demandent, du service militaire, désertent en foule, pour d’autres carrières, les rangs de l’armée, qu’est-ce donc, si ce n’est courir à notre perte?" Synesius, De la royauté
Enfin, "L’infanterie quitte son armure" XXVII et
le casque sous Gratien.
L'accaparement
des ressources de l'état (hommes + finances) par l'église . "Le clergé prêchait avec succès la doctrine de la patience
et de la pusillanimité (l'absence de courage). Les vertus actives qui
soutiennent la société étaient découragées, et les derniers débris de l’esprit
militaire s’ensevelissaient dans les cloîtres. On consacrait sans scrupule aux
usages de la charité ou de la dévotion, une grande partie des richesses du
public et des particuliers ; et la paye des soldats était prodiguée à une
multitude oisive des deux sexes, qui n’avait d’autres vertus que celles de l’abstinence
et de la chasteté." Gibbon, Observations
Générales sur la chute de l’Empire romain dans l’Occident (Tome 7). (Voir
les mesures de l'empereur Majorien qui limite le monachisme 457-461. rappel des
paroles d'Arbogaste. Exemple du moine Jovinien condamné
en 393 pour avoir dénoncer les excès de la virginité).
"saint Paulin cherche à détourner les chrétiens d'entrer dans le service militaire et même de se marier" Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme
"les
monastères étaient remplis d’une foule de plébéiens obscurs et de la plus basse
classe, qui trouvaient dans le cloître beaucoup plus qu’ils n’avaient sacrifié
en se séparant du monde. Des paysans, des esclaves et des artisans trouvaient
facile d’échapper à la pauvreté et au mépris en se réfugiant dans une
profession tranquille et respectée, dont les peines apparentes étaient adoucies
par l’habitude, par les applaudissements publics et par le relâchement secret
de la discipline. Les sujets de Rome qui voyaient leur personne et leurs biens
exposés à répondre du payement d’une taxe exorbitante et inégalement répartie,
échappaient dans les cloîtres à la tyrannie du gouvernement, et une partie des
jeunes hommes préférait les rigueurs de la vie monastique aux dangers du
service militaire. Les différentes classes des timides habitants des provinces
qui fuyaient à la vue des Barbares, y trouvaient une retraite et une
subsistance ; des légions entières s’enterraient dans ces religieux asiles, et
la même cause qui adoucissait le sort des particuliers, détruisait peu à peu
les forces et les ressources de l’empire." Gibbon, XXXVII.
« plusieurs de leurs prosélytes avaient vendu leurs terres et leurs
maisons pour augmenter les fonds publics de la société, aux dépens, à la
vérité, de leurs malheureux enfants, qui se trouvaient réduits à la mendicité,
parce que leurs pères avaient été des saints. » Gibbon, XV. (Appauvrissement
de l'état et enrichissement de l'église).
"ils les persuadèrent de distribuer aux pauvres tous les biens. la
substance et la possession qu'ils possédaient, et, entrant eux-mêmes dans un
état de besoin, pour se rassembler en mendiant, passant d'une position de
liberté à une demande inconvenante, et de la prospérité à un caractère
pitoyable"
Porphyre,
contre les chrétiens, fragments
La théocratie. Ambroise de Milan est l'architecte de la théocratie. Ambroise ose
écrire à Gratien qu'il doit "montrer respect en premier à l'église
catholique et secondairement aux lois de l'état" (Ep10). "si on
lit l'écriture on voit que ce sont les évêques qui jugent les empereurs"
Ep 21 à Valentinien II. Théodose se prosterne à ses pieds et lui baise la main
(humiliation jamais vue de l'empereur). Lorsque des moines chrétiens
persécuteurs brûlent une synagogue, Théodose réclame la reconstruction mais Ambroise fait pression contre la
décision de l'Empereur "en le menaçant de ne pas célébrer l’eucharistie
tant qu’il n’aurait pas obtenu la promesse que non seulement toute poursuite
serait abandonnée contre les chrétiens mais qu’on renoncerait à reconstruire la
synagogue, Ambroise réussit à faire céder".
Ambroise dicte sa conduite à Théodose grâce à cette affaire et au massacre de
Thessalonique. Il fait basculer Rome en Théocratie. Sur KTOV, la
réjouissance de passer en théocratie est présentée comme la soumission du
pouvoir politique à une norme morale m'a laissé sans voix.
Exemple de Théodose II "une
honteuse superstition l’asservissait et la dégradait encore. Il jeûnait,
chantait des psaumes, et croyait aveuglément aux miracles et aux préceptes qui
nourrissaient sa crédulité. Dévotement attaché au culte des saints, soit morts,
soit vivants, de l’Église catholique, l’empereur des Romains refusa une fois de
manger, jusqu’à ce qu’un moine insolent, qui avait osé excommunier son
souverain, eût daigné guérir cette blessure spirituelle." Gibbon, XXXII.
Chantage chrétien. L’évêque Nestorius prononça à Constantinople en 428, s'adressant à l'empereur Théodose II : « Donne-moi, ô roi, une terre purgée des hérétiques, et je te donnerai le ciel en retour. Aide-moi à détruire les hérétiques, et je t'aiderai à vaincre les Perses » (Socrate le Scolastique, Histoire ecclésiastique, VII, XXIX, 5).
Sur
le long terme, la christianisation des esprits empêche tout rebond. La
culture judéo-chrétienne transforma les hommes. "L'habitude
de l'obéissance et de la crédulité détruisait la liberté de l'âme,
source de tous les sentiments raisonnables ou généreux" "La
crédulité [des moines] dégradait les facultés de leur esprit ; ils falsifiaient
le témoignage de l’histoire, et les erreurs de la superstition éteignaient peu
à peu les dangereuses lumières de la science et de la philosophie. La
révélation divine vint à l’appui de tous les cultes religieux pratiqués par les
saints, de toutes les doctrines mystérieuses qu’ils avaient adoptées, et le
règne avilissant des moines acheva d’étouffer toute vertu noble et courageuse.
S’il était possible de mesurer l’intervalle entre les écrits philosophiques de
Cicéron et la légende de Théodoret, entre le caractère de Caton et celui de
saint Siméon Stylite (un moine masochiste), nous apprécierions
peut-être la révolution qu’éprouva l’Empire romain dans une période de cinq
cents ans." Gibbon, XXXVII,
p1093.
En
1790, le révolutionnaire Louis Saint-Just poursuivait : « Les
ravages de l'ignorance, après le Bas-Empire, furent incroyables ; on en doit
accuser la tyrannie des moines, et leur vie stupide ; cette institution venue
de l'épouvante des dogmes ébranla toutes les lois, et créa des vertus stoïques
inutiles au monde [.] Le fanatisme est né de la domination des
prêtres européens »
L’esprit de la révolution et de la constitution de la France.
Avis des Lumières.
Pour Voltaire, c'est "cette religion qui a détruit l’empire
romain" (Le Dîner du comte de Boulainvilliers). "L’empire
romain avait alors plus de moines que de soldats" "Le christianisme
ouvrait le ciel, mais il perdait l’empire : car non seulement les sectes nées
dans son sein se combattaient avec le délire des querelles théologiques, mais
toutes combattaient encore l’ancienne religion de l’empire ; religion fausse,
religion ridicule sans doute, mais sous laquelle Rome avait marché de victoire
en victoire pendant dix siècles" "des déluges de barbares inondèrent
de tous côtés [...]. Que faisaient cependant les empereurs ? ils assemblaient
des conciles."
Voltaire, Essai sur les mœurs et
l’esprit des nations, Chap XI
"cette
idée nouvelle d’un royaume de l’autre monde n’ayant pu jamais entrer dans la
tête des payens, ils regarderent toujours les Chrétiens comme de vrais rebelles
qui, sous une hypocrite soumission, ne cherchoient que le moment de se rendre
indépendans & maitres, & d’usurper adroitement l’autorité qu’ils
feignoient de respecter dans leur foiblesse. Telle fut la cause des
persécutions.Ce que les payens avoient craint est arrivé ; alors tout a changé
de face, les humbles Chrétiens ont changé de langage, & bientôt on a vu ce
prétendu royaume de l’autre monde devenir sous un chef visible le plus violent
despotisme dans celui-ci." "l’Etat cessa d’être un, & causa les
divisions intestines qui n’ont jamais cessé d’agiter les peuples
chrétiens" "quand la croix eut chassé l’aigle, toute la valeur
romaine disparut"
Rousseau, contrat social, IV, VIII.
Ernest Renan, qui est bien plus respectueux du christianisme qu'il considère comme la religion de l'humanité reconnaît pourtant
lui aussi l'implication du christianisme dans la chute de Rome. Cette
analyse n'est pas un point de vue d'ultra. C'est seulement point de vue est un
minimum. Gibbon était chrétien éclairé de même que Renan, respectueux du
christianisme, et qui ne s'est pas libéré des préjugés chrétiens contre
les soi-disants insuffisances du paganisme.
"Les stoïciens, maîtres de l’Empire, le réformèrent et
présidèrent aux cent plus belles années de l’histoire de l’humanité. Les
chrétiens, maîtres de l’Empire à partir de Constantin, achevèrent de le
ruiner." (des stoïciens-épicuriens cf le divin pieux signe comme Epicure:
soyeux heureux)." Renan
"à mesure que l’empire baisse, le christianisme s’élève. Durant le iiie
siècle, le christianisme suce comme un vampire la société antique, soutire
toutes ses forces et amène cet énervement général contre lequel luttent
vainement les empereurs patriotes. Le christianisme n’a pas besoin d’attaquer
de vive force ; il n’a qu’à se renfermer dans ses églises. Il se venge en ne
servant pas l’État" "L’Église, au iiie siècle, en accaparant la vie,
épuise la société civile, la saigne, y fait le vide. La vie antique, vie tout
extérieure et virile, vie de gloire, d’héroïsme, de civisme, vie de forum, de
théâtre, de gymnase, est vaincue par la vie juive, vie antimilitaire, amie de
l’ombre, vie de gens pâles, claquemurés." chap XXXII
"Un
grand danger résultait pour l’avenir de cette morale exaltée, exprimée dans un
langage hyperbolique et d’une effrayante énergie. À force de détacher l’homme
de la terre, on brisait la vie. Le chrétien sera loué d’être mauvais fils,
mauvais patriote, si c’est pour le Christ qu’il résiste à son père et combat sa
patrie. La cité antique, la république, mère de tous, l’État, loi commune de
tous, sont constitués en hostilité avec le royaume de Dieu. Un germe fatal de
théocratie est introduit dans le monde.. " "L’empire
était certes plus loin encore de soupçonner que son futur destructeur était né
[Jésus]" "l’idée jetée par Jésus dans le monde fut, avec l’invasion
des Germains, la cause de dissolution la plus active pour l’œuvre des
Césars."
"la société romaine sentait instinctivement qu’elle s’affaiblissait ; elle
n’entrevoyait que vaguement les causes de cet affaiblissement ; elle s’en
prenait, non sans quelque raison, au christianisme." chap
IV "Ce n'est pas sans raison qu'on les détestait [...] Ils
démolissaient vraiment l'Empire romain. Ils buvaient sa force. Ils enlevaient à
ses fonctions, à l'armée surtout, les sujets d'élite. [...] L'Empire romain
sentait au fond que cette république secrète le tuerait" Chap
XXIII
" Les chrétiens désiraient, au fond, que tout allât
pour le plus mal. Loin de faire cause commune avec les bons citoyens et de
chercher à conjurer les dangers de la patrie, les chrétiens en triomphaient.
Les montanistes, la Phrygie tout entière, allaient jusqu’à la folie dans leurs
haineuses prophéties contre l’empire. On pouvait se croire revenu aux temps de
la grande Apocalypse de 69. Ces sortes de prophéties étaient un crime prévu par
la loi chap IV " "Montanus, comme tous les
prophètes de l’alliance nouvelle, était plein de malédictions contre le siècle
et contre l’empire romain. Même le voyant de 69 était dépassé. Jamais la haine
du monde et le désir de voir s’anéantir la société païenne n’avaient été
exprimés avec une aussi naïve furie." chap XIII ""
"au point de vue militaire et patriotique,
[le christianisme] détruisit le monde ancien" "La patrie et les lois
civiles, voilà la mère, voilà le père, que le vrai gnostique, selon Clément
d’Alexandrie, doit mépriser pour s’asseoir à la droite de Dieu." "Le
chrétien ne se réjouit pas des victoires de l’empire ; les désastres publics
lui paraissent une confirmation des prophéties qui condamnent le monde à périr
par les barbares et par le feu. Le cosmopolitisme des stoïciens avait bien
aussi ses dangers ; mais un ardent amour de la civilisation et de la culture
grecque servait de contrepoids aux excès de leur détachement." "en se
faisant chrétien, on quittait l’armée. « On ne sert pas deux maîtres », était
le principe sans cesse répété." " « C’est assez combattre pour
l’empereur que de prier pour lui » (réponse d'Origène, Contre Celse, VIII,
73.). Le grand affaiblissement qui se remarque dans l’armée romaine [...] a sa
cause dans le christianisme. Celse aperçut ici le vrai avec une merveilleuse
sagacité." chap XXXII
"l’Orient chrétien a perdu toute valeur militaire.
L’islam en a profité" "[au Ve siècle] La Syrie et principalement
l’Égypte devinrent des pays tout ecclésiastiques et tout monastiques. L’église
et le monastère, c’est-à-dire les deux formes de la communauté, y furent seuls
riches. La conquête arabe, se précipitant sur ces pays, après quelques
batailles à la frontière, ne trouva plus qu’un troupeau à conduire. Une fois la
liberté du culte assurée, les chrétiens d’Orient se soumirent à toutes les
tyrannies." chap XXXII
" [Le christianisme] tua plus lentement la richesse ;
mais, à cet égard, son action n’a pas été moins décisive. Le christianisme fut,
avant tout, une immense révolution économique." "L’avarice était pour
l’Église primitive le crime suprême. Or, le plus souvent, l’avarice, c’était la
simple épargne." "Le riche devait se faire pardonner sa fortune,
comme une dérogation à l’esprit du christianisme. En droit, le royaume de Dieu
lui était fermé, à moins qu’il ne purifiât sa richesse par l’aumône ou ne
l’expiât par le martyre." "la vie humaine est suspendue pour mille
ans. La grande industrie devient impossible ; par suite des fausses idées répandues
sur l’usure, toute opération de banque, d’assurance, est frappée
d’interdiction. Le juif seul peut manier l’argent; on le force à être riche ;
puis on lui fait un reproche de cette fortune à laquelle on l’a condamné."
"La funeste terreur répandue sur toute la société du moyen âge par le
prétendu crime d’usure fut l’obstacle qui s’opposa, durant plus de dix siècles,
au progrès de la civilisation." chap XXXII
Ernest Renan, Marc-aurèle ou la fin
du monde antique
Pour Nietzsche, l'inversion des valeurs par
le christianisme fut la véritable cause de la chute Rome.
Le christianisme
est bien la cause principale de la chute de Rome
La
menace barbare n'était pas nouvelle. Depuis des siècles, cette menace était
largement contenue. Les épisodes du IVe siècle avant JC (Brennus et
la Bataille de l'Allia 15 à 40 000 pertes romaines) et du IIe siècle (la
Guerre des Cimbres 110 000 morts romains, très supérieurs à la célèbre bataille
de Cannes 50 000 contre Hannibal) montrent que de graves invasions avaient déjà
eu lieu pendant l'époque de la République et avait été surmontée. Sauf qu'au Ve
siècle quelque chose a changé et Rome ne sait plus y faire face. Donc ce
n'est pas une Rome florissante qui s'effondre au Ve siècle en raison d'une
cause externe que serait la puissance magnifique des barbares, mais une Rome
décadente qui se fait écraser en raison de sa faiblesse interne.
La population barbare (soldats + non combattants) qui entrent dans
l'empire représente 3-4% de la population totale de l'empire romain, alors
même que les frontières ne sont plus défendues à ce moment-là (abandonnées).
Donc la pression due aux huns n'était pas si grande que cela. Ce n'est pas en
soi une vague incontrôlable qui déferle, sauf si Rome est complètement
paralysée et désorganisée (comme l'a déjà montré l'épisode du IIIe
siècle). Les barbares ont seulement violement accéléré la chute
d'une Rome décadente qui aurait sinon dégénéré plus lentement. Ils sont donc le
catalyseur de la chute brutale de l'occident, mais pas la VRAIE cause de la
chute de Rome. La vraie cause est interne à Rome.
La
mauvaise gouvernance corruption et crise économique dans l'empire n'empêche pas
de construire plein d'églises au Ve siècle, et de payer des tributs aux
barbares et à l'orient, épargné des invasions, de rester relativement
florissant encore 150 ans. La crise économique et démographique n'explique pas
un tel effondrement militaire du Ve siècle en occident. La cause de cet
effondrement est politico-religieuse.
On
conclut donc que le christianisme est la cause principale car
- Sans le christianisme, les barbares du Ve siècle ne
prenaient pas Rome.
- Avec le christianisme (mais sans les barbares) on aurait eu un
déclin plus lent, mais un effondrement quand même. Le christianisme est donc
bien la VRAIE cause profonde du déclin de l'occident et ultimement de sa chute
(de la même façon que le recul du christianisme dans les élites à partir de la
renaissance sera la cause qui permettra la remontée en puissance de
l'occident).
On m'objectera que le christianisme ne permet pas
d'expliquer tout. Certes mais la thèse de Gibbon intègre ces autres causes; et
maintenant si je dis que l’idéologie nazi est la cause principale de la seconde
guerre mondiale, cela ne permet pas de comprendre tout non plus de ce qui se
passe entre 1939 et 1945. La causalité des événements est toujours
multifactorielle (idéologique, économique, géographique, humaine...). Donc ce
n'est pas parce qu'il a à chaque fois d'autres causes que le
christianisme que le christianisme n'est pas la cause de fond
principale.
Lorsqu'on m'oppose que la cause principale de la chute de l'empire Romain au Ve
siècle reste les barbares, je réponds oui... des barbares convertis au
christianisme ! (des ariens qui deviendront ensuite nicéens). Si Rome
avait été conquise par des païens germaniques porteur d'un néostoïcisme ou à un
néoépicurisme (Arbogaste éclairé ?), il y aurait eu continuité
civilisationnelle. La civilisation gréco-romaine aurait perduré même
si l'empereur romain était ensuite devenu un grand blond et que la
capitale avait été déplacée plus au nord, comme ce fut le cas lorsque Rome pris
le contrôle de la Grèce. C'est donc bien le christianisme qui est la cause
profonde de la disparition de cette civilisation et des "dark
ages". Les barbares ont abandonné leur paganisme pour se convertir en
masse au christianisme, l'alliance naturelle de Thor et de Jupiter contre
Jésus devenant alors impossible Jésus est désormais libre de détruire Jupiter
dans le sud avant de s'occuper de Thor dans le nord.
Il est aussi important de préciser que c'est
un christianisme fanatique qui prend le pouvoir dans l'antiquité et pas une
version plus humaniste qui existait pourtant déjà (Pelage), et qui pouvait
essayer de s'accorder avec la philosophie grec au lieu de simplement vouloir la
détruire, ce qui réémergera au milieu du moyen-âge et permettra
la renaissance.
" Dans tous les conciles, c’est le dogme le plus
superstitieux qui l’emporte. [une version plus raisonnable de christianisme]
est étouffé par la grossièreté d’un clergé qui veut l’absurde." Renan, chap XXXIV.
Contrairement donc à la plupart des historiens modernes qui nient la
responsabilité évidente du fanatisme chrétien dans ce désastre
et rejettent la conclusion de Gibbon, pour ma part, je rejoins donc
la position classique de Gibbon ou aujourd'hui de Ramsay
Macmullen (Christianisme
et paganisme. Chapitre 3) qui insistent sur la
responsabilité de toute la superstition (incluant donc Platon et
le néoplatonisme). Le dégoût des sacrifices sanglants et la superstition païenne
a légitimé l'irrationalisme chrétien qui a su l'exploiter dans ses défenses et
apologies et ceci a empêché le lancement d'une contre-offensive qui aurait été
bien plus efficace et moins criminelle que les persécutions. La tragédie c'est
donc la disparition de l'épicurisme au IIIe siècle.
Outre donc la question du sac de Rome ou même la chute de l'occident, plus
généralement la disparition de la civilisation gréco-romaine classique fut
d'abord causée par une montée générale de l'irrationalité chez les païens au
IIIe siècle, dont le christianisme ne fut ensuite que l'aboutissement ultime.
Le reniement de la "Raison grecque" (expression de Celse)
et des Lumières antiques qui avaient soutenues le génie
gréco-romain détruisirent cette civilisation de l'intérieur (y
compris dans l'empire d'Orient également décadent).
Ma conclusion sur l'empire romain ne devrait pas paraître si
choquante ni originale. Elle n'est que l'application au cas romain de ce que
l'on admet pour d'autres cas similaire. La destruction de la rationalité
est le facteur clef généralement retenu pour expliquer la fin de l'âge d'or de
la civilisation arabo-musulmane (VIII-XIIe siècles) qui s'effondre au XIIe
siècle lorsqu'elle renie la science sous l'influence de théologiens
obscurantistes comme Algazel. Inversement, on admet généralement que les
progrès de l'Occident lors de la Renaissance et des Lumières s'expliquent
principalement par un retour de la rationalité (scientifique, philosophique,
éthique, politique...).
Note: Dans des temps encore plus anciens, la
réforme religieuse de Nabonidus précipite
la chute de la civilisation mesoppo-akkadienne. Le rôle des religions dans
l'histoire est énorme.
Le
cas de l'empire d'Orient. Contre la thèse chrétienne, un des
principal argument est la survie de l'empire d'Orient, mais en fait celui-ci
frôle de très près plusieurs fois la destruction (par les Goths, puis par les
Arabes) et est incapable d'empêcher le pillage d'Athènes et de la Grèce, même
s'il survit pour diverses raisons circonstancielles (fortifications de Constantinople, avantages
géographiques face aux invasions du Ve siècle, rapatriement de l'or à Constantinople,
récupération des talents d'Occident qui s'effondre en premier, pression
barbare Ostrogoth détournée vers l'Italie à conquérir...). Pour
Gibbon il "subsista mille cinquante-huit ans dans un état de décadence
perpétuelle" (Gibbon, XXXII). Après
quelques tentatives éphémères de reconquête de l'Occident dévasté, l'empire de
l'est se réduira à la ville de Constantinople et ses
alentours. Enfin, la culture gréco-romaine décline elle-aussi
rapidement dans empire d'Orient sous le poids de l'obscurantisme
religieux. En 528, Justinien ferme la dernière école
philosophique néoplatonicienne d'Athènes (les autres
écoles ayant déjà été détruites au IVe siècle) et condamne désormais à
mort les apostats. La pratique du paganisme n'est pas seulement interdite,
désormais le fait même d'avoir des convictions païennes est passible de la
peine capitale (plus de liberté de conscience). Ceux qui recopient les écrits
païens ont la main tranchée. (Ramsay
Macmullen. Christianisme et paganisme. Chapitre 1). En 582
Athènes est mise à sac et conquise par les slaves. En 611 les perses prennent
Antioche (en Turquie). 636-646 les arabes prennent le levant et l'Egypte. Les
arables font le blocus de Constantinople 674-678 et 716-718. Les byzantins
ne sont pas l'empire romain d'orient. Ils ne sont plus la grande puissance de
la région. Conscient de leur impuissance, ils cherchent la source de leurs
échecs dans la religion (de 726 à 843, période iconoclaste). Enfin pendant que
les turcs assiégeaient Constantinople en 1453, les byzantins discutaient du
sexe des anges.
L'idée que
la chute de Rome soit liée au christianisme a récemment été contestée par:
-Michel De Jaeghere (droite
catholique): Le christianisme a-t-il provoqué la chute de Rome ? (à
partir de 42:30)
-Claire Sotinel (gauche postmoderne /
relativisme). Les chrétiens sont-ils responsables - lhistoire.fr
Les anti-Gibbon sont très mauvais. Ils caricaturent la thèse de
Gibbon et répondent en effet à côté. Gibbon n'accuse pas les chrétiens d'être
des pacifistes incapables d'affronter des ennemis (les chrétiens tuent défendre
pour leur religion), mais d'avoir provoqué une guerre civile qui a détruit la
société de l'intérieur. Les chrétiens ne sont pas accusés de vouloir détruire
l'empire mais de vouloir détruire le paganisme antique et la culture
gréco-romaine qui soutenait l'empire et dont l'interdiction a provoqué la
mort de cette civilisation.
Les principaux arguments des historiens anti-Gibbon auquel nous
nous proposons de répondre ici, sont:
- Gibbon, c’est juste le parti pris
anti-chrétien des Lumières.
- Pas de lien de causalité entre christianisation et chute: les
dates c’est juste une coïncidence.
- Le christianisme favorisait l'unité de l'Empire.
- Les chrétiens servent dans l’armée après 314 et les empereurs
chrétiens combattent.
- L’Empire Romain d’Orient / Byzantin (très chrétien) survie 1000
ans de plus (1453).
- Le paganisme était mort. La transition entre paganisme et
christianisme s’est faite en douceur.
- Il n’y a pas eu de vraie réaction païenne: c’est un mythe romantique.
- La législation antipaïenne n’a pas vraiment été appliquée.
- La liberté de conscience existait à cette époque: pas de
persécutions, ni de conversion forcée.
- Les destructions de temple sont un phénomène marginal, et elles concernent
l’Orient pas l’Occident.
- Le monachisme est un phénomène seulement balbutiant en Occident
au moment de la chute.
La
terreur des moines et de l'église pour imposer le Moyen-Age chrétien
La
dissimulation de la vérité historique concernant l'instauration brutale de la
religion chrétienne (et non par une adhésion comme se l’imaginent les croyants)
est la raison principale de la non compréhension de la chute de Rome. Les
historiens anti-Gibbon, généralement pro-chrétiens contestent le fait que
christianisme se soit imposé brutalement. On va voir ce que dit l'archéologie.
(le
remplacement d'une religion-culture millénaire par une secte qui était méprisée
et interdite en seulement 70 ans c'est un bouleversement majeure qui ne peut
pas être négligé comme cause non contributive).
-> A la fin IVe siècle en orient
"dans
presque toutes les provinces du monde romain, une armée de fanatiques, sans
discipline comme sans autorité, assaillaient les paisibles habitants, et les
ruines des plus beaux monuments de l’antiquité attestent encore les ravages de
ces barbares, qui avaient seuls le loisir et la volonté d’exécuter des
destructions si pénibles. [...]
En Syrie, l’excellent, le divin évêque Marcellus, ainsi que
l’appelle Théodoret, animé d’un zèle apostolique, résolut de raser tous les
temples du diocèse d’Apamée. Marcellus [..] attaqua successivement les temples
répandus dans les villages et dans les campagnes [...] des paysans en fureur le
surprirent et le massacrèrent, et le synode de la province prononça sans
hésiter que le pieux Marcellus avait sacrifié sa vie au service de la
foi." (Gibbon, chap
XXVIII).
« Marcellus
d’Apamée, à l’origine en 386, de la destruction du grand temple local de Zeus :
se lançant alors dans une série de destructions dans les campagnes
avoisinantes, il est finalement tué par une foule vengeresse en voulant s’attaquer
une fois encore à un temple de la Bekaa, au sud d’Apamée. Il n’est alors rien
de moins que capturé et brûlé vif, et ses enfants, réclamant justice au nom de
leur père, se verront déboutés pour une question de paix civile. On
argua alors d’une certaine dignité de mourir pour le Seigneur, et les enfants
du défunt en furent quittes pour leurs frais. »
JUSTINE CUDORGE La_destruction_des_sanctuaires_paiens
Vers 400, Porphyre de Gaza ordonne des destructions de temples (Marc le
diacre).
En 420 Le tribun Ursus profita de cette occasion pour faire raser les temples
qui existaient Prospera encore à Carthage et particulièrement celui de Céleste
- préfet
Cynegius Maternus
Tout cela
n'est pas juste le point de vue païen, on a vu que Ambroise de Milan reconnaît
la violence destructive des moines (lettre XLI).
"Mais ces
gens vêtus de noir (les moines), [...] cours aux temples, apportant
avec eux du bois, des pierres et du fer,[...] les toits sont découverts, les
murs sont abattus, les images sont emportées et les autels sont renversés : les
prêtre (païens) doivent toujours se taire sous peine de mort."« [les
moines] se sont répandus sur le pays comme des torrents, dévastant les pays
avec les temples : car partout où ils démolissent le temple d'un pays, en même
temps, le pays lui-même est aveuglé, décline et meurt." "ceux qui
oppriment les habitants : et dépouillant ces misérables de leurs biens et de ce
qu'ils avaient amassé des fruits de la terre pour leur subsistance, ils s'en
vont comme avec le butin de ceux qu'ils ont conquis."
Libanius, Oraison 30 : Pour les temples (Pro templis) - discours prononcé
devant Théodose qui ne changea pas sa politique
-
la statue d'Athéna au Parthénon est retirée au Ve siècle (Marinus de neapolis. Vie de Proclus, 30)
->
Destructions en occident
Vers 370 "Saint Martin, évêque de Tours, parcourait la
Gaule à la tête de ses moines, et détruisait les idoles, les temples et les
arbres consacrés, dans toute l’étendue de son vaste diocèse" (Gibbon, chap
XXVIII). ("Dans un bourg se trouvait un temple fort ancien,
auquel il avait mis le feu" Vie de saint Martin, XIV)
Entre 370
et 380, une secte d'abstinents parait en Espagne, et en Aquitaine. Ils
voudraient imposer à tout le clergé la rigueur monastique. (voir Priscillien)
En 397 dans
le nord de l'Italie (dans le val di non) les missionnaires venus d'Orient
envoyés par Vigile de Trente (Sisinnius, Martory et Alexandre) sont mis à
mort par la foule avec la tolérance/complicité des autorité
locales, puis Vigile est lui-même lynché à mort vers 400 en Suisse après
avoir renversé une statue de Saturne (dans la vallée de Randea).
« Un
grand nombre d'édifices païens étaient tombés sous le marteau, en Gaule
et en Afrique, et le fameux sanctuaire de Vénus Céleste, antique orgueil de
Carthage, pris en quelque sorte d'assaut par l'évêque de la ville, venait
d'être transformé en église. Pour mettre à l'abri les objets de leur culte, les
païens de leur côté construisaient des cachettes dans leurs maisons ou au fond
de leurs jardins »
Amédée Thierry. Revue des deux mondes. Trois Ministres de l’empire romain sous
les fils de Théodose.
Augustin cité de dieu
"Les
fouilles mettent au jour nombre de statues et d'éléments architecturaux
méthodiquement détruits dans les sanctuaires, la plupart en Gaulle" Ramsay
Macmullen. Christianisme et paganisme. Chapitre 2, note 124).
Le temple gallo-romain de la forêt d'Halatte (Oise) abandonné au début du Ve
siècle. Statues mutilées.
Le temple gallo-romain de la forêt d'Halatte (commune d'Ognon,
Oise). Nouvelle interprétation du site à la suite des fouilles de 1996
à 1999. Marc Durand. [article]
Destruction du sanctuaire d'Intaranum (entrains sur nohain Bourgogne). L'évéque saint pelerin d'auxerre avait promis de saccager le site entier
Hisoire des saints Cassius et Castus
- Destruction violente des temples de Mithra en Gaulle et à Rome: Le
commandement militaire vénère Mithra (défections ?)
The Decline and Fall of the Mithraea
of Rome.Feyo L. Schuddeboom
« Des statues de Mithra ont ainsi été retrouvées avec le visage martelé (à Angers). Le temple de Mithra de Bordeaux a été saccagé et détruit à la fin du IVe siècle ; toutes les statues ont été retrouvées brisées » « Des fouilles archéologiques révélant l'existence de temples de Mithra ont montré que ces édifices avaient fait l'objet d'entreprises de destruction volontaires de la part des chrétiens, pour qui le culte de Mithra - religion monothéiste - faisait concurrence au christianisme. » « Les monnaies retrouvées dans plusieurs sanctuaires [et permettant de les dater] indiquent que leur destruction parfois violente se situe à l'extrême fin du IVe siècle . La relative rareté et le mauvais état de conservation des vestiges sont ainsi imputables à des opérations de dégradation consécutives au décret de l'empereur Théodose. »
Sur le mithraum d'Angers, Idem à Bordeau et en Corse, à Mariana
"Le mithraum d'Angers, par exemple, a été saccagé par un groupe venu briser le bas-relief . Le même scénario est envisageable à Mariana, puisque le bas-relief a aussi été brisé avant que le temple ne soit détruit et comblé." François Savatier, Pour la science 09 mars 2017
Idem sur le Rhin: Mackwiller, Sarrebourg, et Biesheim. Kern E. Le mithraeum de Biesheim-Kunheim (Haut-Rhin). In: Revue du Nord, tome 73, n°292,1991. Archéologie. pp. 59-65;
"on a pu observer dans les autres mithraea de la région des traces de destruction violente avec — en particulier à Mackwiller5 et à Sarrebourg6"
-> Persécutions des païens
Squelette décapité, enchaîné et retrouvé dans le temple de Mithra de Sarreboug,
vraisemblablement le prêtre païen qui a été emmuré vivant. (Franz Cumont).
Profanation des
temples avec le cadavre des prêtre païens exécutés ("Il était
persuadé que le voisinage des cadavres détournait les dieux d 'exercer
ici- bas leur action bienfaisante" Labriolle)
"les prêtres (païens) doivent toujours se taire sous peine de mort."
Libanius, Oraison 30 : Pour les temples (Pro templis)
Shenoute and his zealous followers not only destroyed images of the gods in
Upper Egypt, but also killed polytheistic
priests.
Shenoute is reported to have said that “there is no crime for those who have Christ"
Idem
Anathase persécute les païens et les hérétiques, Piganiol le décrit
ensuite comme un être violent, «d'une haine sans mesure», qui
«n'hésitait pas à déchaîner contre ses ennemis des pogroms meurtriers»
(...) «Partout sur son passage, il fera surgir la haine et la guerre».
Sa politique religieuse est jugée «mesquine et méchante»10. L'historien
américain T.D. Barnes, reprenant à son compte l'image imposée par
Schwartz quelque soixante-dix ans plus tôt du politicien sans scrupule,
fait de l'évêque rien moins qu'«un gangster» à latête d'une «mafia
ecclésiastique»" Athanase d’Alexandrie et l’Église d’Égypte au IVe
siècle (328-373) Annick Martin.
"On
faisait la guerre aux temples, dans les villes et à la campagne. Il y
avait du danger à croire qu’il y a des dieux et à lever
les yeux au ciel pour les adorer."
Zosime
, IV
idem dans le code théodosien: "que personne n'aille dans les temples, ne regarde
les temples et ne lève les yeux sur les images formées par les œuvres
mortelles, de peur qu'il ne soit rendu coupable des sanctions divines et
humaines" "que personne ne fasse le tour des temples, que personne ne
lève les yeux vers les temples." CT 16.X.10 & 11
Il
mentionne donc bien des persécutions antipaïennes contrairement aux
affirmations de Paul Veyne, Maraval, M. De Jaeghere... De plus les textes de
Zosime et Eunape ont été expurgé par les copistes. Il y a des coupures dans les
manuscripts !
"sous
les empereurs chrétiens il est dangereux de regarder les astres" (la nuit)
+ il faut baisser les yeux en passant devant les temples)
André
Piganiol, empire chrétien, p261 (Mamertinus, XI, 23 et autres exemples donnés
par Benjamin Gras, la destruction du paganisme, tome I, p 83/84)
La
censure: "Au moment où je publiais les trois premiers, et quand ils
étaient déjà entre (116) les mains de tout le monde, j’appris qu’on y préparait
une réponse, et depuis j’ai été informé qu’elle était prête, mais qu’on
attendait l’occasion de pouvoir la faire paraître sans danger."[..] Si
donc il y a quelqu’un de nos adversaires qui s’estime heureux d’avoir la
liberté de médire, nous pouvons l’assurer qu’il sera plus heureux d’en être
privé".
Augustin, cité de dieu
"ils
introduisirent dans les lieux sacrés de ces gens appelés moines qui, tout en
ayant la forme humaine, menaient la vie, des animaux et se livraient
ouvertement à toutes sortes d'excès que je n'oserais rapporter. Mais, en
revanche, ils regardaient comme un acte de piété de profaner les choses
divines. A cette époque, du reste, tout homme affublé d'une robe noire, et
qui ne craignait pas d'affecter en public un maintien peu décent, avait
permission d'exercer une autorité tyrannique.
C'est à ce haut point de vertu que l'humanité en était arrivée. Mais j'ai déjà
parlé de ces gens-là dans mon Histoire générale.
Ces moines furent donc établis à Canope et là, ils substituèrent à des
divinités accessibles à l'intelligence un culte d'esclaves, et encore
d'esclaves méprisables, auquel ils soumirent les hommes. Recueillant, en
effet, les ossements et les têtes des misérables que leurs nombreux crimes
avaient fait condamner par la justice de la cité, ils les présentaient comme
des dieux, se roulaient convulsivement sur ces restes immondes, et
s'imaginaient que le contact impur de ces sépulcres les rendaient meilleurs. On
les appelait martyrs, diacres, arbitres des prières auprès de la Divinité,
quand ils n'avaient été que des esclaves infidèles, sans cesse roués de cous de
fouet, et portant sur leur corps les marques infamantes que leur avait values
leur perversité. Et la terre souffre de pareils Dieux !
Eunape, vie de philosophes et de sophistes, Antonin
En
415, la philosophe Hypathie est assassinée par
des chrétiens à Alexandrie (Gibbon, chap
XXVIII). (voir le film Agora).
Persécution des païens en 561 en orient "ils subirent eux-mêmes le
supplice réservé aux crimes ignominieux, c'est- à - dire qu'après leur avoir
coupé les pieds et les mains, on les promena nus et sur des chameaux à travers
les rues de la ville"
Arthur Beugnot, Histoire le la destruction du paganisme
"Il
est certain qu’en ces premiers temps que notre religion commença de gagner
autorité avec les lois, le zèle arma plusieurs contre toute sorte de livres
païens, de quoi les gens de lettres souffrent une merveilleuse perte. J’estime
que ce désordre ait plus porté de nuisance aux lettres que tous les feux des
barbares."
Montaigne, essais, II, XIX
Montaigne dit aussi que Julien, « très grand homme et rare » , est
présenté comme l’incarnation même de la vertu antique, de cette vertu que le
monde moderne semble incapable de pouvoir imiter. Les chapitres de Gibbon sur
l'empereur Julien sont à mon avis les plus beaux du livre et je vous invite à
les découvrir en priorité.
"Si
les premiers chrétiens avaient pu écrire dans une langue différente, on ne
saurait douter, en voyant tout ce qu’ils ont détruit, qu’il n’existerait plus
aucun souvenir des événements passés. Lorsqu’on lit les moyens employés par
saint Grégoire et par les autres chefs de la religion chrétienne, on est frappé
de l’acharnement avec lequel ils poursuivirent tout ce qui pouvait rappeler la
mémoire de l’antiquité ; brûlant les écrits des poètes et des historiens,
renversant les statues, et mutilant tout ce qui portait la marque des anciens
temps."
Machiavel, Discours...
->
Réactions païennes
Que cette religion de fanatique honnie de tous les païens soit passée du statut
de culte interdit, méprisé et persécuté à celui de seule religion autorisée en
seulement 70 ans (325-395), voilà un séisme d'une violence inouie pour les esprits et la
société. C'est l'événement majeur qui écrase tous les autres (économiques,
sociaux, démographiques....).
-
révolte païenne à Petra et Aréopolis qui permettra de sauvegarder le site (Sozomène)
En 398 ,
saint Augustin traçait ainsi aux chrétiens leur ligne de con duite (t. X, p. 10
d .) : « L'Écriture dit : Détruisez leurs autels , leurs bois sacrés et leurs
livres. Saint Augustin , parlant des temples de l'Afrique, dit ? : «
Voyez dans quel état sont les temples des idoles : les uns a sont détruits, les
autres languissent sans réparations; ceux-ci sont fermés, ceux-là ont reçu une
nouvelle destination. Quant aux idoles et aux puissances de ce siècle , on les
détruit , on les brise , on les brûle ou « bien on les cache. » Cela était vrai
en général les moines n'éprouvaient plus d'entraves dans leurs tumultueuses
expéditions contre les édifices de l'ancien culte , et en beaucoup d'endroits
des dédicaces chrétiennes recouvraient les anciennes inscriptions païennes
Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme
En 399, à
Sufes Byzacène (Sbiba en Tunisie actuelle, Afrique occidentale romaine) les
chrétiens brisent une statue d'Hercule. S'en suis une émeute lors de laquelle
60 chrétiens sont tués.
Puis en 408 à Calama (Guelma), suite à l'application de la loi d'interdiction
du paganisme, insurrection païenne (un clerc tué et église incendié) avec la
tolérance/complicité des autorité locales dénoncée par Augustin.
Claude Lepelley. Augustin et la cité romano africaine (page 33).
En 415, en Afrique "les ministres du culte païen exerçaient encore leurs
fonctions, en dépit de toutes les lois rendues contre eux par la cour
d'Occident
« les
moines s’emparèrent de la grande église. Ce sont des hommes qui renoncent au
mariage, qui remplissent les villes et les campagnes de communautés nombreuses,
qui ne portent point les armes et qui ne rendent aucun service à l’état.
S’étant toujours multipliés depuis leur premier établissement, ils ont acquis
de grandes terres, sous prétexte de nourrir les pauvres, et ont en
effet réduit tout le monde à la pauvreté. S’étant donc emparé de l’église,
et en ayant gardé l’entrée, le peuple et les gens de guerre demandèrent la
permission de réprimer leur insolence, et l’ayant obtenue, ils fondirent sur eux
et en tuèrent un si grand nombre que l’église fut remplie de corps morts. Ils
poursuivirent ensuite les autres, et n’épargnèrent aucun de ceux qui
étaient vêtus de noir »
Zosime, V
(cf Gibbon XXXVII ->
Churchill "Le vice inhérent au capitalisme c'est le partage inégal des
richesses, tandis que la vertu inhérente au socialisme c'est le partage
équitable de la misère")
Sur notre
page contre Jésus voir
aussi les critique des moines par Rutilius / le fanatisme suicidaire
(Justin / Ignace / les donatistes)
->
Survivance tardive du paganisme héllenique au moyen-âge
- Le
paganisme persiste pourtant et est encore vivace. Il est parfois
majoritaire dans le peuple, par exemple en Provence en 580 (Grégoire
de Tour cité par MacMullen p111 ou Beugnot) Il disparait en Espagne ou
en Angleterre.
Un
jour se présenta devant Nicétius un homme portant de longs cheveux et
une longue barbe qui se jeta à ses pieds pont le remercier de l’avoir
sauvé d’un danger qu’il avait couru sur nier, et comme le saint homme
le rudoyait d’oser dire cela , il raconta que s’étant embarqué
récemment pour l’Italie , il se trouvait seul chrétien au milieu d’une
foule rustique de païens.
Grégoire de Tours, Les sept livres des Miracles, VII, XVII
En Grande Bretagne "Les peuples
oublièrent insensiblement les pratiques et jusqu’au souvenir du christianisme ;
et le clergé breton tira peut-être quelque consolation de la damnation
inévitable de ces idolâtres." Gibbon.
Christianisation de l'occident. "le christianisme imposait la célébration de ses fêtes à une société qu'on
ne pouvait pas encore appeler chrétienne" "De l'aveu même des
historiens chrétiens l'idolâtrie pendant le quatrième siècle régnait dans les
campagnes de l'Italie. Les missionnaires chrétiens sortaient timidement des
villes et n'osaient pas étendre au loin leurs travaux." "Avant
l'arrivée de saint Martin en, ce pays, personne, ou presque personne n'adorait
le vrai Dieu" [Après le sac de Rome]"Nous avons acquis la
certitude que l'essence du paganisme était restée intacte, et que les dommages
éprouvés par ce culte consistaient dans l'anéantissement de ses prérogatives
politiques et dans la saisie de ses biens, atteintes assurément très graves,
mais qui étaient étrangères à la religion proprement dite."
"l'idolâtrie des habitants des campagnes ne consistait pas, comme on
aurait pu le penser, en quelques hommages stériles rendus à des lieux et à des
objets autrefois consacrés; elle allait beaucoup plus loin, puisque nous
apercevons ici des temples, des autels , des victimes, des offrandes, et des
prêtres encore fidèles aux plus cruelles prescriptions de leur religion ."
"le polythéisme romain existait encore et d'une manière à peu près
complète dans les Gaules pendant le sixième siècle" "Je suis parvenu
à démontrer que pendant toute la durée du sixième siècle, l'état du culte
romain dans les Gaules ne différa pas essentiellement de ce qu'il avait été pendant
les cinquante dernières années du cinquième. Cette conclusion n'aura rien de
surprenant quand on saura que le moine Jonas ne craignait pas d'avouer que de
son temps la force de la religion était à peu près détruite dans la Gaule à
cause de la négligence des évêques ' Le jugement sévère de Jonas est conforme à
l'idée que nous donnent de ce siècle les autres documents historiques"
Arthur Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme
- Au VIe siècle, Benoît de Nursie est confronté à des
adorateurs d''Appolon regroupés au mont-Cassin en Italie.
-
VIIe siècle. Destruction de temples de Vénus, de Jupiter, de Mercure et
d'Apollon qui avait été reconstruit par la population encore païenne dans
certaines localités (Vie de saint Romain de Rouen).
- Au IXe siècle, en Grèce, l'empereur Basile découvre un village
qui dispose encore d'un temple à Aphrodite, un autre à Poséidon au milieu d'un
bois sacré (Constantin porphyrogénète)
« Au vu de
la date tardive de ces témoignages sur la survie du paganisme [il faut bien
admettre que] la vieille religion convenait très bien à la plupart des gens,
ils l'aimaient lui faisait confiance, ils s’y épanouissaient et donc ils
résistaient au changement » (Ramsay
Macmullen. Christianisme et paganisme. Chapitre 2).
- Derniers
païens exilés à Harran / Carrahe qui résistent jusqu'au XIe siècles en
orient et sont à l'origine de l'age d'Or des sciences arabes.
l'hommage au paganisme du sabéen Thābit
ibn Qurra cité par Bar Hebraeus (Chronicon Syriacum 168-169, cité dans Ramsay
Macmullen. Christianisme et paganisme) : « Bien que nombreux soient ceux qui
ont été soumis à l’erreur [c.a.d. fait chrétiens] par la torture, nos ancêtres,
grâce à la main de dieu [Aziz] ont enduré et parlé vaillamment, et cette cité
bénie n’a jamais été souillée par l’erreur de Nazareth. Et nous avons reçu, et
nous transmettrons, l’héritage du paganisme, qui est tenu en grand honneur dans
ce monde. Heureux qui supporte le fardeau et dont l’espoir reste ferme pour
l’amour du paganisme. Qui a fait le monde pour qu’il soit habité, et l’a
recouvert de cités, si ce n’est les hommes bons et les rois du paganisme ? Qui
a construit les ports et protégé les fleuves ? Qui a révélé les sciences
cachées ? Sur qui s’est posée la divinité qui dispense les prédictions et
enseigne la connaissance des événements futurs si ce n’est les sages païens ?
Ce sont eux qui ont indiqué toutes ces choses et ont révélé la guérison des
âmes, et ont fait briller leur rédemption, et ce sont eux aussi qui ont révélé
les médecines du corps. Et ils ont rempli le monde avec les bons modes de vie
et avec la sagesse qui est la première des vertus. Sans ces fruits du
paganisme, le monde serait un lieu vide et pauvre, enveloppé de misère et
d’indigence. »
-Sciences
arabes / âge d'or de l'Islam ? "Tel est ce grand ensemble philosophique,
que l’on a coutume d’appeler arabe, parce qu’il est écrit en arabe, mais qui
est en réalité gréco-sassanide. Il serait plus exact de dire grec ; car
l’élément vraiment fécond de tout cela venait de la Grèce. [...] Cette
science dite arabe, qu’a-t-elle d’arabe en réalité ? La langue, rien que la
langue. [...] Cette science n’est pas arabe. Est-elle du moins musulmane
? [...] L’islamisme, en réalité, a donc toujours persécuté la science et
la philosophie. Il a fini par les étouffer. [...] Les libéraux qui défendent
l’islam ne le connaissent pas. [...] L’islam a été libéral quand il a été
faible, et violent quand il a été fort. Ne lui faisons donc pas honneur
de ce qu’il n’a pas pu empêcher. Faire honneur à l’islam de la philosophie et
de la science qu’il n’a pas tout d’abord anéanties, c’est comme si l’on faisait
honneur aux théologiens des découvertes de la science moderne. Ces découvertes
se sont faites malgré les théologiens. "
Renan, L’Islamisme et la science
-> La persécution par
l'église au moyen-âge
- "Les successeurs de Clovis condamnèrent les paysans
qui refusaient de détruire leurs idoles, à recevoir cent coups de verges ou de
courroies". Gibbon,
- En Orient, vers 550-600, sous Justinien, Tibère II et
Maurice la spoliation et la persécution des païens est la politique
officielle de l'état Byzantin. Plusieurs personnages parfois
haut placés sont exécutés pour paganisme, à l'image du gouverneur de Carrhae
Acindynus (Ramsay
Macmullen. Christianisme et paganisme. Chapitre 1). Justinien
est probablement le plus grand criminel pour la foi chrétienne. C'est le Staline
ou le Hitler du christianisme. Selon l'Histoire secrète de Procope de
césarée, il a fait tuer des centaines de milliers peut-être même plusieurs
millions de personnes. "je suis pénétré de cette conviction, que ce que je
vais en écrire aujourd'hui ne paraîtra à la postérité ni digne de foi, ni même
vraisemblable".
- En 681
le concile de Tolède demande de faire arrêter et décapiter toute personne
coupable de pratiques non-chrétiennes.
"Le gouvernement aussi poussé par les évêques brandissait la
menace et plus: amendes, confiscations, exil, emprisonnement, fouet, torture,
décapitation et crucifixion. Qu'imaginer de plus ? Rien. On faisait pression de
toutes les manières possibles et imaginables, même les plus extrêmes. C'est
ainsi que l'on se fit obéir au bout de plusieurs siècles et que l'empire fut
véritablement rendu chrétien" (Ramsay
Macmullen. Christianisme et paganisme. Chapitre 2).
->
Destruction du paganisme nordique au moyen-âge
- Radbod
Ier, roi des Frisons (alias Redbad, c. 680- c. 719) est connu dans l'histoire
du haut Moyen Âge pour sa contribution au maintien de la culture frisonne. Il
refusa de se convertir à la nouvelle religion et poussa les adeptes des
coutumes païennes à la révolte.
- Au VIIIe
siècle, Charlemagne, le soldat de l'église, parcourt l'Europe
occidentale pour faire aux païens ce qu'Hitler faisait aux juifs. En
772, Charlemagne fait exécuter 5000 prisonniers païens qui refusent de se
convertir au christianisme en une seule journée ! (Massacre de Verden). Les
dernières poches de résistances païennes sont ainsi
éradiquées. L'inquisition poursuivra son combat jusqu'au XVIIIe siècle.
Capitulaire De partibus Saxoniae
"Si quelqu'un méprise le jeûne du saint Carême par mépris du
christianisme et mange de la viande, qu'il meure de mort " "Si
quelqu'un fait brûler le corps d'un défunt selon le rite païen, et que
ses os retournent en cendres, il sera puni de la décapitation" "Si
quelqu'un ensuite dans la nation des Saxons, caché parmi eux, non
baptisé, choisit de se cacher, et dédaigne de venir au baptême, et
choisit de rester païen, qu'il soit mis à mort." "Mais si, à cause de
ces crimes mortels commis en secret, une personne s'enfuit
volontairement chez le prêtre et veut faire pénitence par confession,
elle sera dispensée de la mort par le témoignage du prêtre." "nous
ordonnons que chacun donne un dixième de sa substance et de son travail
à ses églises et à ses prêtres"
Note: A
titre de comparaison, pendant la terreur à Paris durant 2 ans (entre 1793 et
1795), dans un climat de guerre civile et d'invasion étrangère, 2 639
personnes sont condamnées à mort par le Tribunal révolutionnaire.
L'établissement du christianisme a donc été très violent ce que les chrétiens
ont oublié !
- En
Hongrie, en 1046 Révolte païenne de Vata.
- en
Scandinavie. Les textes de Snorri Sturluson vantent les exactions chrétiennes
"ceux qui n’abandonnaient pas le paganisme étaient expulsés, à d’autres,
[Olaf Haraldson] faisait couper les mains ou les pieds ou extirpait les yeux,
pour certains il les faisait pendre ou décapiter, mais ne laissait impuni aucun
de ceux qui ne voulaient servir Dieu (…) à qui il affligeait de grands
châtiments"
- Christianisation de l'Islande.
"Olaf prit en otage des Islandais résidant en Norvège. Cela coupa tout
échange entre l’Islande et son principal partenaire commercial.
Certains des otages étaient des enfants d’éminents chefs islandais, et
Olaf menaça de les tuer si les Islandais n’acceptaient pas le
christianisme."
- la Lithuanie (dernière terre christianisée d'Europe en 1387). Au début du
XIe siècle, le premier moine à se risquer dans ces confins païens de l'Europe,
Bruno de Querfurt, se fait massacrer sans autre forme de procès. Piqués au vif
par la résistance des Baltes, les chevaliers Teutoniques et leurs cousins de
l'ordre des Porte-Glaive se mettent en tête de convertir ces irréductibles au
fil de l'épée. Mal leur en prend. "Il était inconcevable pour les tribus
qui peuplaient ces contrées d'accepter la religion que cherchait à leur imposer
l'agresseur", souligne Algirdas Jakubcionis, professeur d'histoire à l'université de Vilnius.
La donation de Constantin (Arte)
"Nous
avons résolu de faire honorer la sacro-sainte Église romaine plus que
notre puissance impériale, qui n’est que terrestre ; et nous attribuons
au sacré siège du bienheureux Pierre toute la dignité, toute la gloire,
et toute la puissance impériale..." "« Nous lui donnons notre diadème,
notre couronne, notre mitre, tous les habits impériaux que nous
portons, et nous lui remettons la dignité impériale et le commandement
de la cavalerie.... Nous voulons que les révérendissimes clercs de la
sacrosainte romaine Église jouissent de tous les droits du Sénat : nous
les créons tous patrices et consuls. Nous voulons que leurs chevaux
soient toujours ornés de caparaçons blancs" " « Nous donnons en pur don
au bienheureux pontife la ville de Rome, et toutes les villes
occidentales de l’Italie, comme aussi les autres villes occidentales
des autres pays. Nous cédons la place au saint-père ; nous nous
démettons de la domination sur toutes ces provinces ; nous nous
retirons de Rome, et transportons le siège de notre empire en la
province de Byzance, n’étant pas juste qu’un empereur terrestre ait le
moindre pouvoir dans les lieux où Dieu a établi le chef de la religion
chrétienne."
Quand le
christianisme devient-il majoritaire dans la population ? Il n'y
aurait eu au maximum que 5% de chrétiens lors de la conversion de Constantin (1/20 de la
population selon Gibbon, <5% selon Peter Heather) mais la religion était encore
récemment persécutée, donc le nombre de chrétiens/sympathisants dissimulés rend
le chiffre possiblement sous évalué. Le pourcentage de chrétien augmente
rapidement pendant le IVe siècle, mais ils deviennent majoritaires qu'au Ve
siècle. Il faut donc voir la politique de christianisation en regard du rapport
de force politique.
- les chrétiens sont minoritaires au milieu du IVe siècle donc
politique en faveur du christianisme, mais le paganisme est forcément toléré.
Il monte peut-être à 25% vers 350 moment du début de l'affrontement.
- A la fin du Ve siècle, lorsque les chrétiens sont en passe de bientôt devenir
majoritaires, on assiste aux interdictions des pratiques païennes. En 408,
Augustin se réjouit que sous la contrainte des lois impériales, de nouveaux
fidèles sont entrés dans l'église (Lettre XCIII). Les chrétiens deviennent majoritaires
en Gaulle vers 430 selon Salvien. Il reste alors seulement la liberté de
conscience car la persécution pour simple défaut de croyance était juste à ce
stade juste impossible à réaliser. Il y avait encore trop de païens.
- enfin quand au VIe siècle le christianisme sera devenu
clairement majoritaire: suppression de la liberté de conscience pour
les païens restant.
Remarque sur
le judéo/christianisme n'est pas un concept inventé
au XIXe siècle, mais c'est bien la religion/civilisation qui prend le pouvoir
dans l'empire romain au tournant du Ve siècle. Le code théodosien
-393 La
secte juive est protégée par la loi. Aucune synagogue ne sera spoliée, et aucun
règlement ne pourra être promulgué pour interdire le judaïsme, même au nom du
christianisme. CT 16.8.9
-397
Les Juifs ne doivent pas être harcelés ou attaqués ; les gouverneurs doivent
maintenir la tranquillité des synagogues. Le clergé juif est autorisé à
conserver ses propres lois et rituels et est exempté de service comme dans les
sénats municipaux. Ils doivent avoir les mêmes privilèges que le clergé
chrétien. CT 16.8.12
-412
Les Juifs ne peuvent pas être persécutés pour leur religion ou se voir
confisquer leurs biens sans motif. Ils sont avertis, cependant, qu'ils ne
peuvent pas manquer de respect au christianisme. CT 16.8.21
-
415 Les Juifs sont autorisés à détenir des esclaves chrétiens à condition que
les esclaves soient autorisés à conserver leur christianisme. CT 16.9.3
V, VI
et VIIème siècle
L'effondrement total de l'occident
S'il y a bien un événement majeur à retenir dans l'histoire, c'est la chute de
Rome. C'est l'événement historique le plus important et marquant de tous les
temps. En termes de destruction relative, la seconde guerre mondiale est une
petite crise (15 ans plus tard rattrapé en population et en économie).
- Au
début de la renaissance, Pétrarque parle de "dark ages"
(âges sombres) pour décrire la période post-romaine. En effet, au
V, VI, VIIe siècle, on constate l'effondrement complet de la civilisation en
Occident, avec un retour à des conditions de vie comparables à celles de la
préhistoire dans certaines régions.
En effet, au Ve siècle, on constate la
disparition des infrastructures, écoles, routes, aqueducs, constructions en
pierre... perte d'usage de la monnaie, montée de l'illettrisme... (Bryan
Ward-Perkins. La chute de Rome). La population de l'empire romaine
avait atteint un record de développement (Gibbon, p31).
La ville de Rome perd 95% de sa population. L'eau y est coupée. Voir
aussi Paul Van Ossel, collège de
France.
"De vastes forêt reparurent
sur la surface de la Gaulle" Gibbon chapXXXVIII. Bruno Dumézil nous dit aussi que les forêts regagnent du
terrain au VIe et VII siècle. Selon Ward Perkins, après la chute de
Rome les trois quarts de la population disparait. Au levant, il faut attendre
le milieu du XIXe siècle pour que la population remonte au niveau atteint sous
l'antiquité romaine. (Ward-Perkins p234/235, p240).
A Cologne, en Germanie romaine (80 000 habitants), l'eau potable était disponible pour tous les habitants (y compris les maisons
des Ubiens) et ne serra rétablie qu'en 1872. Idem
pour les égouts, il faut attendre 1881. Il faut
attendre 1700 ans pour que la ville possède un système de distribution d'eau
comparable ! (documentaire: Rom am Rhein / Les Romains en Germanie).
L’analyse des glaces du carottage GRIP (Greenland Ice Core Project) montre que
le taux de métaux dans l'air (plomb/cuivre - signe de l'activité humaine)
connait un pic à l'époque romaine avant
de chuter à un niveau quasi- préhistorique au moyen-âge.
"lead
pollution sustained over decades at or above the levels of the high
Roman Empire only began in the 12th century. However, because of the
more northerly location of medieval mining regions to which the coring
sites are more sensitive, this does not necessarily mean that the
emissions at that time were higher than during the Roman period."
McConnel PNAS 2019
Paris a seulement 25 000 habitants au XIIe siècle
Voir HérodoteVideos L'évolution de l'espérance de vie depuis l'Antiquité
Alors que dans l'empire
romain, 50% de la population savait lire, le taux
d'alphabétisation tombe à seulement 1% au moyen âge (Charlemagne ne
savait pas écrire. Les Francs saliens sont analphabètes) Au Ve
siècle, 95% des livres disparaissent. L'hostilité des pères de l'église envers
la science ne favorise pas la transmission du savoir (Interview Dr Richard Carrier ; idem
selon John Scheid).
Perte des livres pendant l'antiquité
Mots passés dans le langage sont un témoignage ancestral. Vandales était
le nom d'un peuple. le seul mot hérité du wisigoth en espagnol c'est celui
qui désigne le bourreau. Sur la dizaines de mots passés du vieux-françique au
français, on trouve guerre, haine, hache, frapper.
De même,
l'armée romaine compte 600 000 hommes sous Dioclétien, et peut déplacer des
dizaines légions comptant au total plusieurs centaines de milliers hommes, des
effectifs très supérieurs à celui des grandes batailles du moyen âge
-1066
Bataille Hastings (15 000 hommes par camps)
- 1214 Bataille de Bouvines (10 000 hommes par camps)
-1415 Bataille d'Azincourt (15 000 hommes par camps)
et même
des croisades, où toute l'Europe coalisée compte (25 000 hommes - 5% de
l'armée de Dioclétien dans l'antiquité). La situation militaire ne sera
clairement dépassée qu'à l'époque napoléonienne.
Pour
Saint-Just: "Le monde est vide depuis les Romains ; et leur mémoire le remplit,
et prophétise encore la liberté".
La
parenthèse romaine. La chute de Rome s'amorce quand l'élite
romaine très éclairée a perdu le contrôle politique de son empire, et les
peuples sont seulement retournés à leur état antérieur avant la prospérité
inédite apportée par la pax Romana.
Le
cas de l’Angleterre ou de la Gaulle montre un effondrement total quand Rome se
retire, et illustre à quel poids Rome, malgré la violence de ses conquêtes ou
d'excès ponctuels, était avant tout un protecteur plus qu'un oppresseur.
En
Germanie, il n'y avait ni ville, ni usage de l'écriture et
de monnaie avant le IIIe siècle. C'est véritablement la
préhistoire. En gaulle, avant Caesar, on vivait sous la théocratie des
druides qui avaient interdit l'écriture et dictaient les lois et les jugements.
Les prêtes feront un peu prêt la même chose au début du moyen-âge en se
réservant l’écriture et le savoir et en dominant les princes (jusqu’à Phillipe
le Bel au XIVe siècle en France et la réforme protestante au XVe siècle).
Idem pour les tortures Jules Caesar racontre dans sa Guerre des Gaules
" [Vercingetorix] détermine les incertains par l'énormité des
châtiments ; un délit grave est puni par le feu et par toute espèce de tortures
; pour les fautes légères il fait couper les oreilles ou crever un oeil, et
renvoie chez eux les coupables pour servir d'exemple et pour effrayer les
autres par la rigueur du supplice." On observe une aggravation de l'usage
de la tortures particulièrement barbares réapparaissent au IVe siècle avec les
empereurs chrétiens.
Sur le critère de l'IDH (indice de développement humain), il n'y a pas photo.
La civilisation gréco-romaine était très avancée par rapport à l'europe du nord
qui était encore préhistorique. Aujourd'hui c'est l'inverse, il n'y a pas de
problème à reconnaitre que l’Allemagne est plus avancée aujourd'hui que
l'europe du sud.
L'empire romain n'est pas une
dictature fasciste: Rome c'était juste la civilisation contre la barbarie.
"quels que soient les préjugés en
faveur des Barbares, la réflexion accordera toujours aux Romains les avantages,
non-seulement de la science et de la raison, mais aussi de la justice et de
l’humanité." Gibbon
Les Goths eux admiraient la supériorité de Rome et admettaient ne pouvoir
fonder un état avec le caractère belliqueux des Goths: "mon plus sincère
désir est aujourd’hui de faire en sorte que la postérité reconnaissante loue le
mérite d’un étranger qui employa la valeur des Goths, non pas à renverser, mais
à défendre l’Empire Romain et à maintenir sa prospérité "
Adolphe roi des Goths cité en 412 par Orose.
Quelques réactions :
Peter Brown est dénoncé par Bryan Ward Perckins qui le traite de
"Gourou".
Alan Cameron est combattu par Stéphane Ratti
Hitler et le fascisme furent une résurgence de la barbarie antique que combattait Rome.
- D'être guidés par des instincts bestiaux/brutaux plus que
par la Raison.
- De pratiquer des atrocités (sacrifices humains/tortures
horribles...).
- De piller au lieu de commercer. D'être incapable de
contractualiser par le respect du droit. Hostile au commerce et ne respectant
pas ses propres traités, dans l'idéologie nazi l'Aryen ne doit pas acheter, il
peut prendre ; il ne doit pas payer, ni contractualiser, il doit voler (Les
nazis et l'argent : au coeur du IIIe Reich | ARTE - 29-32 min).
- de vivre en tribus guidés par le dictat arbitraire d'un chef /
d'un roi au lieu de vivre sous le règne du droit universel dans une république.
Les
principaux reproches que les Romains font aux barbares se
retrouvent donc dans la doctrine nazi/fasciste, qui est issue des
contre-lumières et qui remonte en fait aux racines profondes et anciennes de
l'Europe moyenâgeuse barbare ? (voir par
exemple Evola, Autodéfense).
Le débat
politique contemporain: l'antiquité tardive.
Il y a trois points de vue sur l'histoire
de la chute de Rome.
- le point de vue
classique (qui accuse les chrétiens)
- le point de vue chrétien de droite (qui accuse les
barbares)
- le point de vue chrétien de gauche (pro-barbare) qui prône l'égalitarisme civilisationnel
et qui nie l'évènement. "l'antiquité tardive".
Le point de vue chrétien a désormais
remplacé le point de vue classique dans les milieux universitaires. Cette
trahison n'est pas arrivée par une réaction droitière mais par la trahison des
Lumières via la gauche postmoderne. On a une illustration de l'esprit de notre
époque où les postmodernes ennemis de la Raison se sont alliés avec l'aile
gauche du christianisme et les anciens marxistes.
Pour ces gauchistes, il n'y
a pas de sens de parler de chute de Rome car il y a égalité des civilisations.
La gauche postmoderne, décolonialiste et immigrationistes, nie les invasions
barbares ou leur portée au nom du relativisme culturel. Cette position utilise
la notion « d’antiquité tardive » initialement développée par des auteurs
pro-chrétiens pour dédouaner le christianisme de la chute de Rome (Peter Brown,
Henri-Irénée Marrou, Alan Cameron, M-F Baslez…).
Pour les partisans du relativisme culturel, la comparaison de ceux
civilisations n’est pas possible car selon eux les critères de vérité sont
internes à chaque culture, donc leur idéologie du relativisme et de
l’égalitarisme généralisé contient déjà en soi la conclusion que la chute de
Rome n’a jamais eu lieu. On voit que leurs présupposés idéologiques leur empêchent
de voir la vérité.
Alors qui a raison ? Le débat n'est pas tant sur
des faits historiques sur lesquels on se base. On est un peu près d'accord sur
les faits bruts mais pas sur leur interprétations. Le vrai débat n'est pas
entre historiens, mais il est philosophique.
Philosophie et histoire. Toute analyse et jugement historique repose
donc d'abord sur des jugements moraux et philosophiques a priori. Par
conséquent, derrière les débats historiques comme la cause de la chute de Rome), se
cache en fait généralement un débat philosophique de fond. Prétendre
parle d'histoire objectivement pour tout le monde sans dévoiler sa position
philosophique est absurde. Moi, je ne me cache pas, je suis un rationalise et
oui cela ne peut que diffère du point de vue chrétien sur la question.
- Machiavel, Montaigne, Voltaire, Rousseau, Gibbon, Renan, Nietzche et plein d'autres...
- c'est-à-dire les humanistes de la renaissance et les Lumières
- cela renoue avec ce que disait déjà les païens dans l'antiquité
- cette thèse a été soutenue par plusieurs grands historiens.
- et c'est le point de vue de ceux qui abordent aujourd'hui la question scientifiquement (les archéologues).
Ainsi, notre rapport à l'histoire de Rome est un révélateur de notre appartenance civilisationnelle. Aujourd'hui, cette dérive en dit moins sur Rome que sur nous-même. Les valeurs Romaine ont inspiré les élites occidentales depuis la Renaissance. Quand la version de l'histoire qui prévalait depuis 1000 ans en Occident est désormais complètement niée et a fait un 180°C complet, on est en droit de se demander si cette trahison n'est pas l'un des signes d'un changement de civilisation. La rupture est consommée par rapport à l'esprit qui prévalait en Occident depuis la Renaissance. Oui je crois que notre rapport à l'histoire de Rome est un révélateur. Pour moi qui suis plus proche des anciens que de mes contemporains, aider à prendre conscience de cette situation déplorable, c'est se mettre en capacité de mieux résister et de créer les conditions propices à une Renaissance des idées classiques contre les irrationalistes des deux bords, parfois opposés, mais parfois aussi alliés et qui dominent ensemble aujourd'hui contre nous, les véritables héritiers de la grandeur de la Rome antique.
Hommage à la Rome éternelle
"quel empire, en effet, comparer au tien ? Vainqueurs de leurs
voisins, les Mèdes n'ont uni leur territoire qu'à celui des Assyriens ; les
rois puissants des Parthes, les souverains de Macédoine n'ont dominé due
successivement. Et ce n'est pas qu'à ta naissance tu aies pu disposer de plus
de courages, de plus de bras ; mais tu as été plus prudente et plus sage. Des
guerres justement entreprises, ta modération pendant la paix ont fait briller
ta gloire et mis le comble à la puissance. Tu es moins grande par ta royauté
même que par la conduite qui t'en a rendue digne ; tes actions surpassent
encore tes magnifiques destinées. Entreprendre de compter tes gloires attestées
par tant de trophées, ce serait vouloir nombrer les étoiles. Tes temples
resplendissants éblouissent nos yeux étonnés : telle doit être la demeure même
des dieux."
le gaullois Rutilius en 417.
Comparaison avec le déclain actuel par Majorianus
L'Europe de l'Ouest est-elle le nouvel Empire Romain de l'Ouest
Empire Romain vs Rome Aujourd'hui